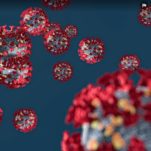L’automatisation, entre promesses non tenues et réalités contrastées
 Introduction au dossier du numéro 24-25
Introduction au dossier du numéro 24-25
Stephen BOUQUIN
La pandémie de Covid-19 a exacerbé la crise du travail, de production et de reproduction sociale. Si elle a rendu visibles les travailleurs des activités essentielles, elle a également renforcé les pouvoirs des entreprises de technologie numérique et accéléré la numérisation des activités de travail. Google, Apple et Salesforce construisent des logiciels de traçage des contacts. Palentir remporte des dizaines de contrats avec les départements de la santé et des services sociaux aux États-Unis et à travers l’Europe. Zoom permet aux jeunes d’étudier en distanciel et aux cadres de travailler de la maison. Netflix, Hulu et Twitch offrent des divertissements. Care.com aide les parents et les enfants à chercher des baby-sitters et des aides-soignants à domicile. Uber et Lyft sont disponibles pour ceux qui veulent échapper aux transports publics tandis qu’Instacart permet d’éviter les magasins. Amazon a embauché des centaines de milliers de travailleurs supplémentaires pour préparer et livrer les commandes réalisées en ligne, tout en continuant à vendre une grande partie de sa puissance de calcul. En effet, près de la moitié du cloud public mondial fonctionne sur Amazon Web Services, ajoutant 85 milliards de dollars à la fortune personnelle de Jeff Bezos depuis janvier 2020. Les multinationales du numérique sont devenues bien plus que des sociétés monopolistiques, elles fournissent des infrastructures sociales clés et se sont impliquées dans des réarrangements de notre vie quotidienne.
Face au développement fulgurant de ce que Cédric Durand appelle le « techno-féodalisme du numérique » (Durand, 2020), il faut néanmoins raison garder. Le robot-coursier Kiwi, qui effectue la livraison de repas sur les campus états-uniens, est en réalité guidé à distance à partir du Guatemala[1]. Il est vrai que les technologies numériques jouent un rôle de premier plan dans la mondialisation des échanges et qu’elles propulsent de nouvelles firmes multinationales, mais sans être en mesure de conjurer les crises économiques récurrentes, comme le démontrent l’éclatement de la bulle Internet en 2001, la crise financière de 2008-2010; ni de sortir de la stagnation économique déjà présente bien avant le déclenchement de la pandémie. Les chemins de fer, le moteur électrique ou l’automobile n’en étaient pas capables non plus. C’est pourquoi il est important de considérer les innovations technologiques et l’automatisation non comme une « variable indépendante », mais comme une « variable dépendante », déterminée par les logiques d’ensemble du système social capitaliste.
Promesses non tenues
Dans un essai intitulé Voitures volantes et taux de profit en déclin [2], l’anthropologue David Graeber, décédé récemment, se posait la question de savoir pourquoi le monde tel qu’il se l’imaginait lorsqu’il était encore un enfant était devenu celui que nous connaissons. Il ne faisait pas référence aux « mensonges sociaux » – comme l’éthique méritocratique que l’on inculque aux enfants – mais plutôt à la promesse générationnelle d’un avenir radieux grâce aux révolutions technologiques et scientifiques. Pour celles et ceux qui ont grandis dans les années 1960, marcher sur la Lune n’était que le prélude de la conquête de l’espace et chacun s’imaginait l’an 2000 comme un monde bouleversé par la science et la technique. Vingt ans après l’an 2000, on est loin du compte…
«Mais où sont les voitures volantes ? Où sont les champs de force, les faisceaux tracteurs, les lasers, les nacelles de téléportation, les traîneaux anti-gravité, les tricordeurs, les drogues d’immortalité, les colonies sur Mars et toutes les autres merveilles technologiques que tout enfant grandissant du milieu à la fin du XXe siècle supposait exister dans un futur proche ? Même les inventions qui semblaient prêtes à se réaliser – comme le clonage ou la cryogénie – ont fini par trahir leurs nobles promesses. Que leur est-il arrivé ? Certes, nous sommes bien informés des merveilles des ordinateurs, comme s’il s’agissait d’une sorte de compensation inattendue mais, en réalité, nous n’avons même pas réussi à conduire l’informatique au point de progrès auquel les scientifiques des années 1950 s’attendaient au niveau de ce que nous avons atteint maintenant. Nous n’avons pas d’ordinateurs avec lesquels nous pouvons avoir une conversation intéressante, ni de robots capables de promener nos chiens ou de sortir nos vêtements de la machine à laver. […] En réalité, l’âge présent correspond autant aux espoirs et attentes que prévalaient il y a cinquante ans que la vie de la famille Pierrafeu correspond à l’âge de pierre… »
Pour Graeber, le déclin des innovations technoscientifiques s’explique aisément. La recherche scientifique est devenue un champ de bataille entre « professionnels de l’autopromotion, en compétition perpétuelle », ce qui réduit d’autant l’émulation et l’échange de savoirs indispensables aux découvertes scientifiques. D’autre part, depuis les années 1970, l’investissement dans la recherche est passée de technologies associées à la possibilité d’avenirs différents à des technologies appliquées mobilisables par le complexe militaro-industriel sinon dans la course aux profits. En d’autres termes, la recherche scientifique fondamentale a été marginalisée par effet combiné d’une compétition croissante, du militarisme et du principe de rentabilité. On pourrait sans doute nuancer les choses. Dans beaucoup de pays, les chercheurs continuent à servir le « bien commun ». Inutile aussi de penser le passé comme un âge d’or puisque dans les années 1930 ou 1950, le pouvoir du complexe militaro-industriel se faisait sentir aussi …
En revanche, là où Graeber se trompe véritablement, c’est quand il considère la révolution cybernétique a été appréhendé de la même manière par tout le monde, et ce y compris les penseurs critiques, d’inspiration marxiste notamment. Ainsi, selon Graeber, y compris l’économiste marxiste Ernest Mandel annonçait dans les années 1970 que l’humanité se situait sur le seuil d’une troisième révolution technologique « aussi profonde que la révolution agraire ou industrielle, dans laquelle les ordinateurs, les robots, les nouvelles ressources énergétiques et les technologies informationnelles remplaceraient le travail industriel, conduirait à la fin du travail et nous réduirait tous au rôle de designers et d’informaticiens bardés de visions folles sur ce que les usines cybernétiques devraient produire ».
Or, c’est bien l’inverse qui est vrai car dès 1972, Mandel reconnaît certes au capitalisme d’avoir su assurer une croissance prolongée depuis la seconde mondiale, mais rejette l’idée que cette situation puisse se prolonger indéfiniment grâce à l’innovation technoscientifique[3]. Il critique les thèses de l’époque annonçant une automatisation complète en expliquant que celle-ci est impossible dans un cadre capitaliste, notamment parce qu’elle implique une suppression des profits tirées de la prestation de travail que les systèmes automatisés ne peuvent générer. Plus tard, dans un texte paru en 1986, Mandel approfondit son analyse en expliquant combien l’automatisation réduira le travail socialement nécessaire sans être en mesure d’abolir le travail en tant que tel :
« Nous avions déjà indiqué, dans le Capitalisme du troisième âge, que sous le capitalisme, l’automation complète, l’introduction de robots sur grande échelle sont impossibles car elles impliqueraient la disparition de l’économie de marché, de l’argent, du capital et des profits. Dans une économie socialisée, la robotique serait un merveilleux instrument d’émancipation humaine. Elle rendrait possible la semaine du travail de 10 heures. Elle donnerait aux hommes et aux femmes tout le temps nécessaire à l’autogestion de l’économie et de la société, au développement d’une individualité sociale riche pour tous et toutes. Elle permettrait la disparition de la division sociale du travail entre administrateurs et administrés, le dépérissement rapide de l’Etat, de toute coercition ou violence entre les êtres humains.» (Mandel, 1986)
La vision rétrospective de David Graeber n’est donc pas exempte de critique tant il est vrai qu’il mesure le « retard » technologique à l’aune de l’imaginaire de la science-fiction ou du point de vue de la doxa officielle. Quoi qu’il en soit, notre présent n’est pas celui des colonies sur Mars, ce qui n’empêche nullement un Elon Musk de répéter à profusion que les inventions permettant de voyager dans l’espace sont sur le point d’être concrétisées… Un cran au-dessous de ces rêveries techno-futuristes, nous retrouvons le retour des discours annonçant l’avènement de l’ère des robots. En effet, récemment, plusieurs ouvrages développant une telle narration sont devenus des best-sellers aux Etats-Unis : The Second Machine Age, d’Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee (2014), ou encore The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment, de Martin Ford (2016).
Dans le monde des cabinets conseils, de McKinsey, du MIT ou de la Banque mondiale, les analyses des experts convergent pour considérer qu’un emploi sur deux serait directement menacé par la robotisation. Ces analyses catastrophistes nous ont conduits en 2018, en tant que collectif éditorial des Mondes du Travail, à programmer un dossier sur la question de l’automatisation au sens large, c’est-à-dire en y intégrant la robotisation, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies numériques.
Au vu de l’ampleur des changements en cours et de la vigueur avec laquelle l’automatisation est présentée comme inéluctable, il est de salubrité publique de remettre en cause la doxa politico-médiatique en faisant le tri entre la mythologie futuriste et ce qui relève de la réalité concrète. C’est le premier objectif du dossier auquel s’ajoute une raison d’être non moins importante : il ne suffit pas d’être sceptique devant les mythes futuristes pour mieux comprendre les changements en cours. Pour avancer dans ce sens, il faut mettre à nu les logiques qui déterminent l’automatisation et l’innovation technologique. Ceci implique aussi de sortir du cadre de l’étude des situations de travail et d’élargir le questionnement au niveau du système social dans son ensemble, ce qui n’est pas chose aisée… Mais peut-on se satisfaire d’explications partielles ?
La tentation du déterminisme technologique
Tant du côté des économistes que des sociologues, la tentation du déterminisme technologique semble irrépressible. Pour la majorité des économistes, (néo)classiques ou hétérodoxes, il existe une tendance systématique à considérer l’innovation produit et l’innovation du procès de production comme étant propulsés par la concurrence et compétition sur le marché. William Baumol résume parfaitement ce schéma de lecture :
« Le mécanisme du marché réalise son efficacité à travers l’adaptation aux désirs des consommateurs en favorisant des avantages compétitifs qui fournissent une profitabilité plus élevée aux firmes plus efficaces. La firme qui laisse ses concurrents faire usage de produits et de process innovants subira une perte de profitabilité. Elle devra innover ou mourir.» (Baumol, 2002, p. 15).
Joseph Schumpeter, lecteur assidu de Karl Marx, de Friedrich Nietsche comme de Werner Sombart, s’est fait connaître comme le théoricien de l’innovation. Pour Schumpeter, « l’ouragan perpétuel » de la destruction créatrice crée les bases d’une nouvelle période de croissance économique où les innovations technologiques jouent un rôle clef, à côté des innovations-produit et organisationnelles qui interagissent en se renforçant pour former des « grappes d’innovations ».
« L’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d’organisation industrielle – tous éléments créés par l’initiative capitaliste. […] L’ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives, depuis l’atelier artisanal et la manufacture jusqu’aux entreprises amalgamées telles que l’U.S. Steel, constituent d’autres exemples du même processus de mutation industrielle – si l’on me passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de “destruction créatrice” constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s’y adapter » (Schumpeter, 1943 [1951], p. 106-107.
Le doute est permis quant au caractère universel de l’analyse schumpeterienne. Toutes les innovations ne détruisent pas et ne remplacent pas les activités qui les ont précédées – le vélo inventé en 1980 n’a rien détruit – et le mouvement de l’innovation demeure hétérogène dans l’espace et dans le temps, aux antipodes son approche évolutionniste. L’innovation connaît aussi des échecs, et se situe parfois à contretemps de l’évolution conjoncturelle macro-économique. Cela étant, l’idée de la destruction créatrice continue d’avoir un très large écho, mais c’est peut-être d’abord dû à son pouvoir performatif.
Du côté de la sociologie, force est de constater que cette la fascination pour la technique forme une sorte de « tropisme » conjoncturel. Ainsi, au cours des années 1950-1960, les travaux de Pierre Naville, de Georges Friedmann et d’Alain Touraine abordaient tous à leur manière la question du changement technologique alors en cours, que ce soit sous l’angle de l’impact sur les relations de travail, sur la qualification, la rémunération ou l’organisation du travail.
Selon le schéma historico-descriptif élaboré par Alain Touraine dans L’Évolution du travail ouvrier aux usines Renault (1955), la phase A se caractérisait par une industrie de fabrication mobilisant un savoir-faire professionnel. Initiée au début de l’ère industrielle, elle était alors en train de s’effacer pour laisser la place à la phase B qui correspond à la production de grandes séries, mobilisant des machines spécialisées et un travail parcellisé déqualifiant. Cette phase serait par la suite supplantée par la phase C, avec des systèmes de fabrication semi ou pleinement automatisés, nécessitant avant une intervention qualifiée de surveillance et de maintenance. Pour Touraine, l’évolution générale de la phase A à la phase C correspond au passage d’un système professionnel qui repose sur l’autonomie professionnelle de l’ouvrier qualifié de fabrication à un système technique de travail défini par la priorité accordée à un système technique d’organisation sur l’exécution individuelle du travail.
Ce schéma historico-descriptif fut critiqué par d’autres qui, à l’instar de Pierre Naville, analysaient l’automation à partir de dynamiques contradictoires. Ainsi, l’automatisation, qui induit une dissociation (séparation) croissante entre opération et opérateur, peut non seulement déqualifier les salariés mais aussi les libérer des contraintes inutiles d’un savoir-faire professionnel devenu caduc, avec, comme conséquences, la possibilité d’une requalification, d’une polyvalence et d’une plus grande liberté de « circuler » dans le processus de production. L’automation permet également de dissocier le temps-machine du temps de travail humain, ce qui facilite (en théorie) une réduction massive du temps de travail comme l’a montré William Grossin (1967). Mais cette dissociation expose également le travail humain à des automatismes sociaux tels que le flux tendu ou la flexibilité temporelle et contractuelle. Pour Naville, si la technologie demeure subordonnée au rapport salarial, elle fait partie intégrante des relations de travail avec des rapports de force qui déterminent leur évolution.
Avec le recul de plus d’un demi-siècle, plusieurs choses sont à observer. Tout d’abord le fait que les situations de travail des phases A, B et C sont encore présentes aujourd’hui. Dans certains secteurs, comme la robinetterie ou l’aéronautique, le travail à façon et les petites séries exigent toujours des interventions d’opérateurs professionnels expérimentés qui contrôlent le procès de travail. Les industries qui correspondent à la phase B, comme le secteur automobile, mobilisent encore du travail parcellisé et répétitif, même si l’automatisation de certaines activités – peinture, tôlerie – s’est fortement étendue. D’un point de vue global, la phase B est toujours présente, mais une large fraction de ces activités ont été délocalisées vers les pays à bas salaires. Quant au travail qui correspond à la phase C, s’il a connu un développement depuis la fin du XXe siècle, il ne s’est nullement généralisé – y compris dans les pays anciennement industrialisés. Remarquons aussi que le travail à contenu technologique élevé (pour résumer, celui des ingénieurs, des techniciens, des développeurs et des ouvriers hautement qualifiés) ne s’est nullement émancipé de la tutelle du rapport salarial, contrairement à ce que Touraine avait envisagé (Touraine, 1965 ; 1969).
Des travaux de Pierre Naville, on peut dire que les potentialités cachées de l’automatisation ne sont pas réalisées puisque la division du travail est restée globalement inchangée tandis que la flexibilisation s’est imposée contre la réduction du temps de travail. Naville n’excluait pas l’éventualité d’une régression sociale, ce le poussait à poursuivre la rédaction d’écrits plus militants comme en témoigne le recueil d’articles à propos de l’action ouvrière contre le régime gaulliste (Naville, 1964) ou encore sa participation à l’ouvrage édité par la CFDT intitulé Les dégâts du progrès. Les travailleurs face au changement technique (CFDT, 1977).
A la fin des années 1970, les sociologues du travail réinvestissent la question de la modernisation technologique en reprenant les analyses des économistes de l’école de la régulation. Voyant dans l’épuisement du régime d’accumulation la raison de la crise économique, bon nombre d’entre eux, à l’instar de Michel Aglietta (1976) et Robert Boyer (1986), se sont mis à la recherche d’un nouveau modèle productif, source d’une nouvelle ère de prospérité. Rétrospectivement, attendre des nouvelles technologies et du travail post-taylorien qu’ils favorisent un nouveau compromis relève d’une dérive techniciste, doublée d’une myopie historique. Car, si compromis il y a eu durant la période de l’après-guerre, il n’était ni programmé ni prévisible [4] et on peut se demander pourquoi ce serait le cas par la suite ? Le retournement des années 1970 correspond autant à la chute de la profitabilité – due à la saturation des débouchés et à l’importance des concessions faites au salariat mobilisé – et conduit à l’inversion des rapports de force, grâce au chômage notamment. Aujourd’hui, après trois décennies de restructuration « néolibérale » de la condition salariale, il faut bien admettre qu’un « nouveau compromis » n’a jamais vu le jour et que le maintien de la profitabilité du capital à un niveau suffisamment élevé représente le premier principe structurant des transformations que l’on a connues.
Au début des années 1990, le questionnement sociologique s’est davantage focalisé sur l’étude des organisations et des entreprises, en laissant quelque peu dans l’ombre l’analyse critique des changements technologiques et leur impact sur les relations de travail. Il est vrai que les transformations qui s’appliquaient alors étaient d’abord de nature organisationnelle et managériale, pensons à l’éclatement de l’entreprise, le développement de la sous-traitance ou encore la montée du management par projet, autre manière de subdiviser le procès de travail afin de le recomposer sur des bases plus conformes à la culture d’entreprise et la corporate governance. Vers la fin de cette décennie, le regard sociologique s’est recentré sur les phénomènes de précarisation de l’emploi et de dégradation des conditions de travail. Au lieu de continuer à espérer le retour de la prospérité grâce à l’innovation technologique, il a bien fallu reconnaître la persistance voire la recrudescence des pénibilités dans le travail (Gollac, Volkoff, 1996 ; Baudelot et al., 2003; Coutrot, 1998) et les bénéfices que l’on pouvait tirer d’une précarisation de segments entiers du salariat, notamment grâce au retour de l’armée de réserve industrielle (Bouquin, 2006)[5].
Certains auteurs, en particulier se revendiquant de l’approche « opéraïste » (Moulier-Boutang, 2008 ; Negri et Vercelone, 2008), ont vu dans la montée en puissance du travail cognitif l’émergence d’une société de la connaissance. Suivant une lecture évolutionniste, le mouvement d’automatisation serait amené à se généraliser à l’ensemble des activités simples jusqu’au point où il ne resterait plus que le travail cognitif et créatif comme activités résiduelles non automatisables. Et puisque les travailleurs « possèdent » sur le plan cognitif « les moyens de produire », le travail cognitif était en mesure de résister organiquement à la subsomption [6].
Ironiquement, cette vision optimiste a commencé à perdre beaucoup de crédibilité lorsque le travail s’est vu être exposé au fonctionnement prédateur d’un capitalisme hautement informationnel, il y a de cela une dizaine d’années environ. Les technologies du numériques permettent la traçabilité de l’activité de chacun (navigation embarquée, la signature du « faire » au travail) mais déterminent aussi la mise au travail via le capitalisme de plateformes et les algorithmes. Forcément, le regard sur les technologies de l’information et de la communication est redevenu critique et il a bien fallu admettre combien ces dispositifs techniques permettent de soumettre des travailleurs « ubérisés » à la logique de valorisation.
Depuis lors, le numérique et l’informatique ne sont plus investis d’espoirs émancipateurs, mais se retrouvent au contraire appréhendés comme étant des outils d’asservissement et de régression sociale. Après le techno-futurisme optimiste est venu le temps du techno-pessimisme avec les technologies dystopiques d’asservissement…
Or, l’évolution historique et sociale finit toujours par contredire le déterminisme technologique, tant sur le versant des espoirs naïfs que du côté des craintes teintées de techno-phobie [7]. Certes, la modernisation technoscientifique est loin d’être neutre. Elle est effectivement une arme tenue en main par le management et elle sert un double objectif que sont l’amélioration de la profitabilité des capitaux investis et celui de l’amélioration de la performance du travail humain. Cela, on le sait depuis les travaux de Marx sur la question du machinisme. Mais reconnaître cette vérité signifie aussi que les innovations technologiques ne sont pas à même de supprimer l’antagonisme capital-travail, puisqu’elles en incarnent une des dimensions. Il est par conséquent tout aussi « vrai » qu’elles ne font que déplacer l’antagonisme capital-travail à un autre niveau. Les outils technologiques, même conçus avec l’impératif d’augmenter le rendement du travail vivant – notamment en surveillant de près son engagement – sont toujours à double tranchant. Ces outils facilitent aussi, pour ceux qui savent les manier, l’organisation collective, ils accélèrent les flux de communication tout en ayant un effet corrosif sur les rapports de pouvoir, ne serait-ce qu’en révélant la verticalité de ceux-ci, alors que leur usage pourrait « horizontaliser les échanges et contribuer à démocratiser les rapports sociaux[8].
Cette lecture dialectique des innovations, qui fut privilégiée par Jean Lojkine (1992) dans ses analyses de la révolution informationnelle, permet d’entrevoir un potentiel disruptif puisqu’elle facilite des échanges directs et contribue au développement d’une expertise collective indispensable à la démocratisation des rapports sociaux, notamment dans la sphère du travail.
Un chantier permanent
A rebours d’une analyse réductionniste marquée par le déterminisme technologique, il nous semble urgent d’élargir la perspective en prenant en compte un certain nombre de leçons historiques et sociologiques qu’il convient de confronter aux réalités contemporaines.
De manière générale, on peut dire que les découvertes, les trouvailles et les innovations sont autant le fruit du hasard que d’une nécessité historiquement située (Kuhn, 1962 ; Feyerabend, 1975). Comme le rappelle judicieusement Yuval Noah Harari (Harari, 2015), dans l’Egypte antique, il existait forcément un lien entre les crues du Nil, le solstice, l’agriculture, le développement des mathématiques et l’astronomie. Une découverte scientifique ne trouve pas nécessairement une application immédiate. Ainsi, bien avant à James Watt, des dizaines d’inventions mobilisaient déjà l’énergie à vapeur, notamment l’éolipyle d’Héron d’Alexandrie au premier siècle après J.-C. De la même manière, Charles Babbage inventa la machine à calculer bien avant l’ordinateur tandis que l’Arpanet, prédécesseur d’Internet, fut développé en pleine guerre froide pour faire face au risque d’explosion nucléaire, près de quarante ans avant sa diffusion massive. L’application des découvertes scientifiques répond à des besoins réels tout en étant marquée par les rapports sociaux en vigueur. Le cas de la recherche génétique l’illustre parfaitement, initiée pour des raisons médicales, elle s’est étendue pour servir de plus en plus la cause d’une marchandisation du vivant.
Dans le système social capitaliste, contrairement aux thèses dominantes en économie, l’innovation est d’abord le symptôme de limites éprouvées dans le cycle d’accumulation qui représente une réponse circonstanciée visant à prolonger son mouvement perpétuel (Smith, 2000 ; 2020). La tradition critique en sociologie, que l’on retrouve chez Pierre Dubois (1978)[9] et de façon plus systématique chez Jean-Marie Vincent (1987), considère l’innovation technologique comme loin d’être neutre puisqu’elle répond à des finalités à la fois économiques et politiques. Comme le machinisme en son temps, le numérique a pour but, au-delà de la réduction des coûts et d’une combinaison optimale des moyens et des fins, « de soumettre plus complètement les travailleurs en les dépouillant de la force sociale qu’ils développent dans la coopération » [10]. Si on ne peut conférer aux transformations techniques du travail un rôle explicatif en soi ne signifie pas que la technique ne serait que la manifestation d’un déterminisme socio-économique. « La technique représente un rapport de rapports, une suite de processus apparemment autonomes dans leur objectivité instrumentale, mais liés à la dynamique du capital et du travail dans leurs mouvements profonds » (Vincent, 1987, p. 66). Les rapports de production ne se heurtent pas à la technique – puisque celle-ci est une de leur manifestation –, mais bien aux forces productives humaines asservies :
« Dans la marche forcée de l’accumulation, le capital tend à se développer de façon illimitée, c’est–à–dire sans tenir compte des limites qui lui sont opposées par les hommes au travail et les relations que ces derniers doivent établir avec leur environnement en fonction d’une production en progression quasi continue. […] Pour faire face aux crises qu’il engendre, le capital est amené à nier les obstacles en utilisant la technique pour briser les résistances humaines et matérielles, dans le but de faire reculer sans cesse les frontières du monde qui peut être mis en valeur » (Vincent, ibid.).
Dans un monde dominé par la logique de valorisation, la technologie est à la fois combinaison des moyens et des fins, recherche du moindre coût et mise en place de rapports socialement conditionnés entre les agents et les conditions de la production sociale.
Par conséquent, la technologie n’a plus grand-chose à voir avec ce pourquoi elle se donne – mise à jour des modes d’utilisation des ressources matérielles et cognitives – car elle impose une relation au monde objectif dans un contexte de subordination d’une partie de la société à cette relation.
Depuis Marx, nous disposons de l’outillage analytique qui permet de comprendre que l’automatisation répond à la nécessité de substituer le travail vivant par du « travail mort » (les machines) afin de rétablir ou maintenir la profitabilité du capital. Nous pouvons historiquement vérifier que les technologies cherchent également à briser les résistances et les oppositions sociales des collectifs de travail (Dubois, 1978 ; Noble, 1978 ; Gartman, 1986). Nous savons également (Mandel, 1972 ; 1986) que cette automatisation ne va pas éliminer le travail vivant mais expulser une fraction de celui-ci, tout en exigeant d’être compensée en termes de coûts croissants des capitaux fixes par une intensification du travail et le développement de formes d’accumulation primitive. L’automatisation va donc générer en son sein comme dans sa périphérie le développement d’un travail non automatisé, exposé bien souvent à des formes de surexploitation avec des salaires inférieurs au standards sociaux en vigueur.
Ce notamment grâce à ces fondements théoriques que le concept du digital labor ou du micro-travail a vu le jour[11]. Nous avons consacré une large partie du grand entretien avec Antonio A. Casilli à cette approche étayée de manière approfondie dans le livre En attendant les robots (Casilli, 2019). Dans les services, l’automatisation coïncide avec le transfert d’un travail vers le client, l’usager que l’on fait travailler gratuitement, tandis que l’automatisation des modes de communication via les révolutions informationnelles correspond l’émergence du « produsager » du micro-travail[12]. Il faut, pour compléter le tableau, ne pas oublier de mentionner la permanence d’un vaste volume de travail manuel d’assemblage dans les pays à bas salaires comme l’illustre l’existence de méga-usines de Foxconn employant près de 400 000 ouvriers rien que dans la ville de Shenzhen et entièrement dédié à la production de microcomposants [13].
Précisons que le dossier que nous publions dans ce numéro peut se lire comme une invitation à conduire des recherches (inter)disciplinaires qui approfondiront certains aspects traités partiellement tout comme un appel à investir des questionnements « écosystémiques » abordant de manière transversale des phénomènes comme la pandémie du Covid-19 ou la crise écologique.
Le dossier s’ouvre avec un premier article de Stephen Bouquin L’automatisation, une arme de destruction massive de l’emploi ?, qui met en évidence le caractère disparate de l’automation. L’idée que l’automatisation est une arme de destruction massive des emplois est un leurre, sinon une fausse menace qui sert à faire peur. En effet, malgré les discours alarmistes, la robotisation demeure très limitée tandis que l’Intelligence artificielle n’arrive pas à tenir ses promesses. Au final, c’est d’abord la numérisation tant du travail que du hors-travail qui s’est développée de manière fulgurante et dont l’efficacité dans la collecte et le traitement d’informations est indéniable.
Les plateformes de travail et service représentent en quelque sorte la quintessence de la numérisation. Il est donc important de mieux connaître leur fonctionnement du point de vue des travailleurs « ubérisés». L’article de Daniela Leonardi, Emiliana Armano, Annalisa Murgia, intitulé Plateformes numériques et formes de résistance de la subjectivité précaire. Le cas de Foodora montre que des grains de sable peuvent enrayer la machine. Chercheuses en sociologie, elles ont étudié les interactions sociales que structure une plateforme de livraisons de repas. Basée sur une co-recherche, l’enquête offre des clés de compréhension à partir d’une double réalité, à la fois virtuelle et matérielle, qui se territorialise au travers des conditions de livraisons et de leur rémunération. Les résultats de l’enquête montrent que l’expérience de travail des livreurs-coursiers combine non seulement une flexibilité contrainte, mais aussi des résistances aux formes de contrôle et d’assujettissement, et ce y compris avec des conflits ouverts qui dépassent la dimension interpersonnelle.
Dans un troisième article Les innovations technologiques, une avancée pour l’égalité hommes-femmes ?, Haude Rivoal montre comment, dans « les usines du futur » que sont les entrepôts de logistique, les innovations technologiques jouent un rôle majeur dans le maintien d’une hégémonie de la figure du travailleur masculin. Malgré la féminisation de l’encadrement intermédiaire, la division du travail et la répartition des métiers demeurent fortement marquées par les rapports sociaux de genre. La baisse de la pénibilité physique que certains dispositifs permettent se combine avec une hausse de l’intensité du travail, favorisant le maintien d’un monopole masculin.
À la suite de cet la, nous publions le compte rendu d’une enquête sur le développement du micro-travail en France Quel statut pour les “petits doigts” de l’intelligence artificielle ? Présent et perspectives du micro-travail en France, de Clément Le Ludec, Elinor Wahal, Antonio A. Casilli et Paola Tubaro. En questionnant la nature de ces activités, les auteur.e.s apportent une réponse sociologique en identifiant celles-ci au digital labor également appelé micro-travail. Ce micro-travail, déjà évoqué dans le grand entretien avec Antonio A. Casilli, représente une activité sociale souvent invisibilisée mais qui produit néanmoins, à peu de frais sinon gratuitement, de la valeur captée par les géants du Net et leurs petits cousins qui fournissent et commercialisent des données nécessaires à la poursuite de l’automatisation. Les auteur.e.s mettent en évidence combien ce micro-travail est socialement régressif et combien il impose une subordination aux micro-travailleurs. La question de statut permet aussi de proposer une série de régulations qui devraient limiter et encadrer le développement de ces nouvelles formes de captation et de mobilisation de valeurs créées par le travail.
L’entretien avec Sophie Binet, cosecrétaire de l’Ugict-CGT, sur le développement du télétravail et du numérique en général, permet d’étendre le champ de vision à l’action collective et au monde syndical. Il apporte des éléments d’information sur le télétravail pendant la période de confinement. Pour Sophie Binet, il est évident que le patronat a désormais compris qu’il pouvait avoir intérêt à voir le télétravail se diffuser. Mais il n’est pas le seul car les salariés, cadres et techniciens sont également demandeurs de plages en télétravail, notamment pour échapper à open space et pour maîtriser davantage leur engagement dans le travail. Le numérique est certainement un outil de contrôle, mais il peut aussi servir au combat syndical, de la syndicalisation à l’action collective. Le mouvement syndical ne peut continuer à l’ignorer et devrait investir pleinement le numérique comme un terrain de lutte et de revendications.
La deuxième partie du dossier rassemble plusieurs articles qui apportent des éléments de compréhension historiques ou théoriques. De Matthew Cole nous publions une traduction de Machines intelligentes. Une synthèse historique publié en 2018 par le think tank Autonomy[14]. Dans cet article, Matthew Cole expose une synthèse de l’histoire des machines intelligentes, à la fois au niveau de l’imaginaire scientifique qui les sous-tend qu’au niveau des différentes manières imparfaites de concrétiser celles-ci. Les dernières évolutions de l’IA recèlent des possibilités de simulation de l’intelligence humaine dont on ne peut encore préjuger. Pour Matthew Cole, un fil rouge relie l’IA aux premières tentatives de construire un automate et ce fil rouge est tout aussi prométhéen dans son ambition que positiviste dans sa manière d’appréhender la science ; ce qui peut déboucher sur le meilleur et comme le pire.
Matteo Pasquinelli nous invite à revenir sur les origines du General Intellect chez Marx. Dans cet article initialement publié dans la revue Radical Philosophy (hiver 2019), Pasquinelli déconstruit ce concept souvent mobilisé par les auteurs de la tradition opéraïste. Contrairement aux idées reçues, la notion de General Intellect, que l’on retrouve uniquement dans le « Fragment sur les machines » publiés dans les carnets de notes qu’on appelle communément les Grundrisse, est loin d’avoir cette capacité explicative presque « magique » de l’évolution du capitalisme et elle représente encore moins une sorte de prophétie cachée à propos de son dépassement. Pour Matteo Pasquinelli, le General Intellect représente d’abord une étape dans le développement de la pensée de Marx, qui exprime sa compréhension du machinisme, ses liens avec la division du travail et ensuite la reconnaissance de « l’intellectualisation » croissante du travail lorsque celui-ci s’automatise. Le problème de la mesure et de la quantification de ce travail intellectualisé demeure non résolu à ce jour, ce qui ne signifie pas forcément que le management ne cherche pas à mettre en place de outils numériques cherchant à le contrôler et à rendre son évaluation mesurable.
Le dossier serait resté incomplet sans un retour critique sur les travaux de Pierre Naville, et en particulier l’ouvrage Vers l’automatisme social ?, consacré à la question de l’automatisation. Dans Travail, techniques automatisées et nouvelles aliénations sociales Pierre Naville et l’automation, Sébastien Petit revient sur la place croissante des machines dans les espaces sociaux et dans les situations de travail. Dans les années 1960, Pierre Naville abordait cet enjeu et proposait une contribution majeure à l’analyse d’un système productif qui incarne au plus haut point cette expansion généralisée des techniques automatisées et de l’automation. L’article permet de revenir sur les recherches de Naville ayant trait à l’automation en mettant en lumière à la fois les éléments centraux de son analyse et le cadre sociologique qu’il a construit pour situer la mise en rapport du travail et des techniques dans le capitalisme contemporain.
Le dernier papier du dossier, intitulé L’automatisation et ses dérives technicistes, de Paul Santelmann, exprime un point de vue informé par une longue expérience de terrain sur le plan de la formation professionnelle des cadres et des ingénieurs. A l’évidence, l’automatisation n’est pas une question nouvelle et il faut continuer à considérer celle-ci comme un volet essentiel de la négociation collective, ce qui implique une capacité des salariés et de leurs représentants à s’emparer de cet enjeu. En France, les représentations des innovations technologiques s’inscrivent dans une vision rigide et technocratique de la division du travail. Ainsi l’automatisation et la robotisation sont généralement appréhendées sur la base de modèles macro-économiques qui privilégient une approche par l’emploi au détriment de l’analyse du travail réel. Selon Paul Santelmann, il faut continuer à poser la question des différentes formes d’automatisation possible en analysant ce qu’elles disent du sens des innovations technologiques : « Le débat n’est pas que technique, il concerne la façon dont le travail s’organise en lien avec la place que l’Etat concède à la démocratie sociale et à la négociation collective. » Sa contribution exprime une critique des innovations technologiques conduites sous l’égide de conceptions court-termistes du « progrès » technique qui se sont structurées dans l’économie dirigée de l’après-guerre, une période marquée par une « gestion » de la main-d’œuvre porteuse de nombreuses discriminations – immigrés, femmes, jeunes. Il est regrettable que les tendances rationalistes et technicistes aient dominé les transformations du travail, dévitalisé les cultures professionnelles et tenu à l’écart le système démocratique qui s’y est souvent résigné.
Bibliographie
Aglietta M. (1976), Régulation et crises du capitalisme, Paris, Calmann-Lévy.
Alaluf M. (1986), Le Temps du labeur. Formation, emploi et qualification en sociologie du travail, Bruxelles, ULB.
Baudelot C., Gollac M. (2003), Travailler pour être heureux. Le bonheur et le travail en France, Paris, Fayard.
Baumol W. (2002), The Free Market Innovation of Machine: Analyzing Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, 318 p.
Bouquin S., « Précarité et segmentations sociales comme facteur de régulation des marchés du travail », P. Cours-Salies et S. Le Lay (coord.), En bas de l’échelle, Toulouse, Erès, 380 p., pp. 256-285.
Boyer R. (1986), La théorie de la régulation : une analyse critique, Paris, La Découverte, 142 p.
Brynjolfsson E, McAfee A. (2014), The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company.
Casilli A. A. (2019), En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 395 p.
CFDT (1977), Les Dégâts du progrès. Les travailleurs face au changement technique, Paris, Seuil, 316 p.
Coriat B. (1976), Science, technique et capital, Paris, Seuil, 1976.
Coriat B. (1979), L’Atelier et le Chronomètre : essai sur le taylorisme, le fordisme et la production de masse, Paris, Christian Bourgois, 1982 ; 1994.
Coriat B. (1990), L’Atelier et le Robot : essai sur le fordisme et la production de masse à l’âge de l’électronique, Paris, Christian Bourgois ; 1994.
Corsani A. (2020), Chemins de la liberté. Travail entre autonomie et hétéronomie, Paris, Croquant, p. 294.
Coutrot T. (1998), L’Entreprise néo-libérale, une nouvelle utopie capitaliste ?, 281 p.
Dubois P (1978), « Techniques et division des travailleurs », in Sociologie du travail, 1978, pp. 174-191.
Dujarier M.-A. (2008), Le Travail du consommateur. De McDo à eBay, Paris, La Découverte, 246 p.
Durand C. (2020), Technoféodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 264 p.
Durand J.-P. (1993), Vers un nouveau modèle productif, Paris, Syros.
Feyerabend P. (1975), Contre la méthode, esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, Seuil, 1988.
Ford M. (2016), The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment, Londres, OneWorld Publications.
Fournier P., Lomba C., Muller S. (2014), Les Travailleurs du médicament. L’industrie pharmaceutique sous observation, Toulouse, Erès, 350 p.
Frey C.B., Osborne M. A. (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?, Université d’Oxford.
Freyssenet M. (1977), La Division capitaliste du travail, Paris, Savelli.
Fuchs C., Sevignani S. (2013), « What Is Digital Labour? What Is Digital Work? What’s their Difference? And Why Do These Questions Matter for Understanding Social Media? », in Triple C, vol 11 n° 2 (2013) ; https://doi.org/10.31269/triplec.v11i2.461.
Gaborieau D. (2017), « Quand l’ouvrier devient robot, Représentations et pratiques ouvrières face aux stigmates de la déqualification », in L’Homme & la Société n° 205 pp. 245-268.
Gartman D. (1986), Autoslavery. The Labor Process in the American Automobile Industry, New York, 1986.
Gollac M., Volkoff S. (1996), « Citius, altius, fortius. L’intensification du travail», in Actes de la Recherche en sciences sociales, 1996, n° 114, pp. 54-67.
Graeber D. (2015), Bureaucratie. L’utopie des règles, Paris, LLL, 307 p.
Grossin W. (1967), Le Travail et le Temps. Horaires, durées, rythmes. Préface de Pierre Naville, Paris, Anthropos.
Harari Y ., (2015), Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin Michel, 512 p.
Kern, H, Schumann M. (1986), La fin de la division du travail, Paris, MSH.
Kuhn T .S. (2008), La Structure des révolutions scientifiques [« The Structure of Scientific Revolutions »], Paris, Flammarion, coll. « Champs / 791 », trad. Laure Meyer, 1re éd. 1962, 284 p.
Lojkine, J. (1992), La Révolution informationnelle, Paris, PUF, 304 p.
Mandel E. (1976 [1972]), Le Troisième Age du capitalisme, 3 vol., réédité Paris, éditions La Passion, 1997, 559 p.
Mandel E., (1986), « Marx, la crise actuelle et l’avenir du travail humain », in Revue Quatrième Internationale n° 20, mai 1986, en ligne http://www.ernestmandel.org/new/ecrits/article/marx-la-crise-actuelle-et-l-avenir
Marx K. (1975), Le Capital. Critique de l’économie politique, livre III, section III, Editions sociales, 1975.
Moulier-Boutang Y. (2002), « Capitalisme cognitif et nouvelles formes de codification du rapport salarial », in Carlo Vercellone (sous la dir. de) Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute, 2002, pp. 305-319.
Moulier-Boutang Y. (2008), Le Capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation, Paris, éditions Amsterdam, 320 p.
Naville P. (1964), Questions du socialisme – La classe ouvrière et le régime gaulliste, Paris, EDI, 484 p.
Negri A., Vercellone C., « Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif », in Multitudes, vol. 32, n°1, 2008, pp. 39-50.
Noble D. (1977), America By Design., Oxford, 384 p.
Noble D. (2011[1984]), Forces of Production: Social History of Industrial Automation, Aldine Transaction, 444 p.
Noble D. (2016), Le Progrès sans le peuple, traduit de l’anglais par Colette Izoard, Agone, ( 1re édition 1993), Marseille, Agone, 237 p.
Penn R. (1990), Class, Power, and Technology, Cambrigde University Press, 1990.
Sauvy A. (1980), La Machine et le Chômage : les progrès techniques et l’emploi, Paris, Dunod/Bordas, 1980, 320 p.
Schumpeter J. (1951 [1943]), Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot.
Smith T. (2000), Technology and Capital in the Age of Lean Production: Marxian Critique of the New Economy, State of University of New York Press, 199 p.
Tony Smith (2020), How Capitalism Stiffles Innovation, in Tribune, https://tribunemag.co.uk/2020/08/how-capitalism-stifles-innovation
Touraine A. (1955), L’Evolution du travail ouvrier aux usines Renault, thèse sous la direction de G. Friedmann.
Touraine A. (2017 [1966]), La Conscience ouvrière, Paris, Seuil, 213 p.
Touraine A., Durand C., Pecaud D. (1965), « Les travailleurs et les changements techniques : une vue d’ensemble des recherches », in vol. 2 des Relations industrielles et la politique de main-d’œuvre, OCDE, 182 p.
Vincent J.-M. (1987), Critique du travail. Le faire et l’agir, Paris, PUF, 267 p.
Yang, Chan J., Lizhi X. (2015), La machine est ton seigneur et ton maître. (Analyses, enquêtes et témoignages sur la vie des ouvriers des usines chinoises de Foxconn, qui la perdent à fabriquer iPhone, Kindle et autres Playstation pour Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nokia, Sony, etc.). Marseille, Agone, 110 p.
[1] Sur le robot-coursier Kiwi faussement autonome, voir https://thehustle.co/kiwibots-autonomous-food-delivery/
[2] David Graeber, Bureaucratie. L’utopie des règles, Paris, LLL, 2015, p. 304 ; version originale publiée en ligne en 2012 https://thebaffler.com/salvos/of-flying-cars-and-the-declining-rate-of-profit.
[3] Ernest Mandel, Spätkapitalismus, thèse de doctorat soutenue en 1972 sous la direction d’Elmar Altvater à l’Université libre de Berlin, et publiée en anglais en 1975 sous le titre Late Capitalism et publié en français sous le titre de Le Troisième Age du capitalisme (1976).
[4] Contrairement aux thèses de l’école de la régulation, le socle de droits sociaux et l’Etat providentiel que l’on a connus dans les pays de l’Ouest européen étaient d’abord la résultante d’un compromis imprévu et improbable, tant entre capital et travail qu’entre bloc capitaliste fragilisé de l’intérieur et bloc bureaucratique soviétique consolidé après la victoire sur le nazisme. Si le régime d’accumulation fordien était devenu caduc et dysfonctionnel, le nouveau régime d’accumulation laissait peu de place au compromis et s’avère plutôt fondé sur un approfondissement des inégalités et une précarisation de la condition salariale.
[5] Si la surpopulation relativesur le marché du travail représente un intervalle qui correspond au transfert d’emplois d’un secteur à l’autre, comme le défend la théorie du déversement d’Alfred Sauvy (1980), le chômage structurel permet, quant à lui, d’obtenir par la contrainte des hausses de productivité tout en freinant la progression des salaires. C’est pourquoi Marx voyait dans l’armée de réserve un moyen permettant de contrecarrer la baisse de la profitabilité qui pouvait à son tour ralentir l’innovation technologique. Voir Marx (1975, p. 225-278). Pour la période récente, voir Mateo Alaluf (1986), Le Temps du labeur, pp. 161-227 et pp. 269-288 ; ainsi que Stephen Bouquin (2006) « Précarité et segmentations sociales comme facteurs de régulation des marchés du travail » (pp. 256-285), Pierre Cours-Salies P. et Stéphane Le Lay (2006).
[6] Pour un bilan (auto)-critique de l’approche post-opéraïste sur le travail cognitif, voir Antonella Corsani (2020).
[7]. Au XIXe siècle, les syndicalistes révolutionnaires craignaient les grandes manufactures, véritables bagnes de travail. Au XXe siècle, les grandes usines étaient devenues les bastions d’un syndicalisme certes moins révolutionnaire mais, pendant un certain temps au moins, beaucoup plus effectif aussi.
[8] Ainsi bon nombre de mobilisations sociales, parfois insurrectionnelles comme en Egypte en 2011 ou au Chili en 2019, utilisent massivement les réseaux sociaux. Internet et la téléphonie mobile rendent les informations plus accessibles, ce qui provoque une contre-offensive visant à diffuser de fausses informations, à restreindre la circulation des images ou à surveiller de près les contenus échangés.
[9] Pierre Dubois, «Techniques et division des travailleurs », in Sociologie du travail, 1978, pp. 174-191.
[10] Jean-Marie Vincent, Critique du travail. Le faire et l’agir, Paris, PUF, 1987, p. 65.
[11] Pour une généalogie des conceptualisations variées du micro-travail et du digital labor, voir Fuchs et Sevignani (2013).
[12] . Voir notamment les travaux de Marie-Anne Dujarier (2008).
[13] . Voir Yang, Chan J., Lizhi X. (2015), La machine est ton seigneur et ton maître. (Analyses, enquêtes et témoignages sur la vie des ouvriers des usines chinoises de Foxconn, qui la perdent à fabriquer iPhone, Kindle et autres Playstation pour Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nokia, Sony, etc.), Marseille, Agone, 110 p.
[14] Autonomy.work