Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du Travail
Ce billet réunit plusieurs textes rédigés à la mémoire de Stephen Bouquin. …
Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du TravailLire la suite »
Ce billet réunit plusieurs textes rédigés à la mémoire de Stephen Bouquin. …
Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du TravailLire la suite »
par Samia Moucharik*. (publié initialement dans le n°6 de la revue Les Mondes du Travail (septembre 2008).
Résumé : Cet article propose une analyse des usages d’un concept de « classes populaires » dans les études sur les subjectivités politiques contemporaines. Il apparaît que ce concept inscrit ces études dans une continuité avec le classisme, supposant que les subjectivités politiques relèvent toujours d’une problématique de la conscience sociale, qui se déduit à la fois de l’appartenance à un groupe et d’une vision antagoniste de la société. De plus, ce concept permet une objectivation des subjectivités grâce à la définition d’un rapport spécifique à la politique, caractérisé notamment par la domination et la dépossession. L’objectivation des subjectivités posant un cadre a priori aux enquêtés ainsi que le maintien des analyses dans la continuité classiste ou dans les décombres de la classe ouvrière obligent alors à interroger les résultats d’enquêtes menées sur les subjectivités politiques après la « classe ouvrière ».
Le concept de « classes populaires » connaît depuis les années 1990 un succès grandissant dans les études portant sur les représentations et les subjectivités politiques [1]. Il devient une des principales clés d’interprétation pour analyser le vote aux élections de 2002, et ce, autant pour expliquer le résultat du FN que la perte d’audience du PS [2].
Le succès de ce concept peut surprendre dans la mesure où il est à la fois revendiqué et controversé, y compris par ceux qui l’utilisent. Ainsi, « classes populaires » est présenté comme une notion d’usage difficile, présentant un caractère éminemment flou (Collovald et Sawicki, 1991 : 7-19) et cumulant deux notions elles-mêmes polysémiques et connotées idéologiquement (Rey, 2006 : 547-559). Certes, la critique réflexive fait partie intégrante du « raisonnement sociologique », néanmoins, il est remarquable que ces caractérisations ne conduisent pas à sa disqualification [3].
Les raisons de ses usages se trouvent dans la nécessité pour les sciences sociales de renouveler leurs catégories après la disqualification de celle de « classe ouvrière » – constatée et admise dès les années 1980. Plus précisément, le concept de « classes populaires » permet, après celui de « classe ouvrière », de recomposer un groupe à partir de ses subjectivités politiques. À l’instar de « classe ouvrière », il assure la fonction de désignation objective du groupe par l’identification des subjectivités qui seraient propres à ce groupe.
Néanmoins, la substitution de « classes populaires » à la « classe ouvrière » ne peut être analysée comme ayant lieu entre deux concepts de même statut. « La notion de « classe ouvrière » a été un concept politique ayant du sens pour les ouvriers eux-mêmes, et plus largement pour l’ensemble des classes populaires, pour lesquels la « classe ouvrière » constituait une référence subjective et politique. Les sciences sociales se sont donc appropriées un concept subjectivé en politique pour analyser les formes de pensée, les représentations politiques de cette classe [4]. En revanche, le concept de « classes populaires » se présente comme une catégorie strictement sociologique, dépourvue de toute dimension subjective pour ceux qu’il désigne. Nous verrons qu’il se présente comme une catégorie d’objectivation des subjectivités. Le renversement consistant à utiliser désormais un concept qui ne se présente pas comme à la fois objectif et subjectif, mérite d’être analysé car il comporte des implications problématiques fondamentales dans l’approche des subjectivités politiques contemporaines. Il pose notamment la question du statut et des modalités des enquêtes. Les enquêtes prennent-elles comme point de départ un cadre posé par un concept a priori, ou bien un cadre laissant ouverte l’exploration des subjectivités contemporaines. Trancher cette question est décisif pour repérer la bascule subjective que constitue la péremption de la catégorie de « classe ouvrière », tant du côté des subjectivités politiques qu’au niveau des sciences sociales. Pour ce faire, je propose de débuter la réflexion par l’analyse des enjeux théoriques du concept de « classe » qui se trouve au croisement des sciences sociales, de la politique et des subjectivités politiques [5]. Il sera alors possible de mieux saisir comment « classes populaires » permet d’identifier certes de nouvelles subjectivités apparues après la « classe ouvrière », mais comment celles-ci sont contraintes par un cadre posé a priori.
1 – « Classe » : un concept total aujourd’hui réduit à sa seule dimension politique
« Classe » un « concept total » à la jonction de la politique, des sciences sociales et des subjectivités politiques
Le concept de « classe » occupe une place à part dans la production sociologique en France. La sociologie s’est en effet appropriée un concept politique relevant de la théorie marxiste pour en faire son concept central explicatif de la société et de l’Etat. « Classe » est considéré alors comme un « concept total » produisant une sociologie générale (Dubet, 2003 : 71-80) rendant compte de « phénomènes sociaux totaux » (Bihr et Pfefferkorn, 2004 : 37-53). Il permet en effet d’analyser aussi bien la nature des groupes constituant la société – des « classes sociales » adossées aux rapports de production – que la structuration des différentes classes sous l’égide du conflit – « lutte des classes » – ou de l’alliance. Il rend également compte des subjectivités politiques à partir du concept de « conscience de classe ».
La notion de « classe » se situe donc à la jonction de la théorie politique marxiste et du paradigme scientifique dominant qui s’est imposé entre la fin des années 1940 jusque dans les années 1970 [6].
Sa place centrale dans la sociologie française s’explique historiquement par le fait que celle-ci se constitue après 1945 à partir d’études sur les ouvriers (Chapoulie, 1991 : 321-364). Qu’ils aient été proches du PCF ou non, les premiers sociologues développent des démarches d’enquêtes établies sur des questionnaires, des observations ou des entretiens. Une autonomie critique est ainsi assurée par l’élaboration de telles enquêtes (Simon, 2006 : 115-119), qui révèlent un point central : « classe » a du sens, non seulement en politique, pour les sciences sociales, mais également pour les ouvriers [7]. Ainsi, Guy Michelat et Michel Simon peuvent mettent au point dans les années 1960 une méthodologie d’enquête sur les subjectivités politiques des ouvriers appréhendées à partir d’elles-mêmes, et non à partir de démarches conceptuelles ou normatives de type marxiste. Leur grande enquête menée en 1966 procède par « entretiens non-directifs » qui lèvent les dangers d’une imposition problématique ou d’une « clôture projective »[8]. Elle établit chez des ouvriers une « organisation symbolique » politique de type classiste, y compris chez ceux qui n’ont pas nécessairement recours au vocable de « classe ». Leurs représentations, loin d’être le simple redoublement de leur expérience ouvrière, reposent sur une « vision du monde social et du champ politique organisée à partir de la conscience de se situer partir de là eux-mêmes du « côté ouvrier » – ce qui induit un système de représentations organisé autour de l’appartenance et des oppositions de classe » (Michelat et Simon, 2004). Le concept de « classe » se situe donc précisément à la jonction de la politique, des sciences sociales et des subjectivités politiques telles qu’elles sont mises au jour par des enquêtes. C’est en ce sens que pour ma part je le définis comme un « concept total ».
2 – La mise en cause sociologique du concept de « classe ouvrière » contemporaine de sa disqualification politique
A partir des années 1970, le concept de « classe » fait l’objet d’une révision critique qui a pour but de rompre avec la vision centrée sur le noyau des ouvriers professionnels. Des études pointent ainsi, parmi l’ensemble que constitue la classe ouvrière, les singularités subjectives des ouvrières et des ouvriers étrangers ou jeunes, la plupart étant des ouvriers spécialisés[9].
Cette révision critique explique sans doute le changement de statut que connaît le concept. En effet, il voit sa pertinence scientifique renouvelée par la mise en lumière de l’hétérogénéité du groupe. Dans le même temps, il s’éloigne de la conception politique marxiste dominante développée par le PCF, qui en fait une catégorie politique « essentialisée » glorifiant les ouvriers professionnels (Molinari, 1995 : 337-343). Ainsi, comme le note Claude Dubar, « classe », jusque-là « concept sociologique de base », non marqué » doit « être longuement justifié et “ autonomisé” par rapport au système conceptuel principal dont il faisait partie » (Dubar, 2003: 35-44).
Les années 1980 voient surgir une contestation du concept de « classe » dans les sciences sociales. Ainsi, des enquêtes aussi diverses que celles menées par les auteurs du Mouvement ouvrier (Touraine et al., 1984) ou par Sylvain Lazarus (Lazarus, 1986), montrent que la vision des ouvriers à propos de la société et de l’usine n’est plus structurée par la notion de « classe ouvrière ». Ce contexte politique indique lui aussi des éléments plaidant pour l’analyse d’une telle rupture dans les subjectivités politiques des ouvriers. Une désaffection à l’égard de la CGT et du PCF commence à partir des années 1970 pour s’accélérer tout au long de la décennie 1980 [10]. Le contexte politique pèse bien entendu dans les débats et discussions propres aux sciences sociales, mais la disqualification du concept de « classe » s’opère d’abord par des enquêtes. Si Michel Verret amorce sa réflexion en constatant l’implosion du projet politique porté par la « classe ouvrière », son analyse porte essentiellement sur l’éclatement puis la segmentation sociologique du groupe ouvrier (Verret, 1999). Sans ignorer cette nouvelle séquence politique, Jean-Pierre Terrail (Terrail, 1990), Olivier Schwartz (Schwartz, 1990) ou bien encore Stéphane Beaud et Michel Pialoux (Beaud et Pialoux, 1999) concluent de la même manière à la fin de la classe ouvrière au terme d’études sociologiques auprès des ouvriers – même s’il faut préciser que cette fin est interprétée de manière distincte. Le concept de « classe » apparaît alors disqualifié tant d’un point de vue politique, que dans les sciences sociales que du point de vue des subjectivités politiques révélées par les enquêtes.
3 – La réhabilitation de « classe » au nom de sa seule dimension politique[11].
Dans les années 1990, quelques chercheurs viennent rompre l’unanimisme concernant la fin de l’idée de la « classe ouvrière » d’une manière singulière. Ils ne le font pas à partir d’enquêtes, mais ils engagent la discussion sur les implications problématiques liées à la dimension politique du concept de « classe ouvrière ». La prééminence donnée au caractère politique – précisément idéologique – ne considère plus le concept dans sa triple dimension, oblitérant la question des subjectivités politiques. Le titre d’un article de Roger Cornu pourrait résumer cette position : « la classe ouvrière n’est plus ce qu’elle n’a jamais été » (Cornu, 1995 : 345-353). Selon lui, la dimension idéologique qui aurait pesé sur l’usage du concept de « classe ouvrière » doit être prise en compte pour réévaluer les travaux passés. Il serait alors possible d’évaluer les changements que connaît aujourd’hui la classe ouvrière sans risque d’erreurs imputables à une mythification passée de cette dernière. Cette position est également adoptée par Florence Weber qui s’attache à lire des travaux contemporains concluant à la fin de l’idée de la classe ouvrière (Weber, 1991 : 179-189). Elle considère Le monde privé des ouvriers d’Olivier Schwartz et Destins ouvriers. La fin d’une classe ? de J.-P. Terrail comme des analyses biaisées du fait de l’emprise idéologique sur le concept, héritée de la période historique antérieure. Ces deux recherches témoignent à son sens du « sentiment diffus d’un travail intellectuel de « deuil de classe » en mettant la lumière sur ce qui individualise les ouvriers. L’analyse de Florence Weber a pour enjeu de réexaminer le concept de « classe ouvrière », considéré dans ses rapports entre sciences sociales et politique, en menant une double investigation sur le passé et le présent. Or, le repérage au présent des biais propres à la séquence précédente conduit, d’une part, à s’exposer à de nouvelles illusions rétrospectives et présente, d’autre part, une conséquence problématique majeure. Dans la mesure où la thèse de la fin de l’idée de la classe ouvrière est examinée non pas au regard de la période actuelle et à partir d’enquêtes, mais en considérant la dimension idéologique du concept, Florence Weber inscrit nécessairement ses analyses dans une problématique du changement et non dans une problématique plus large admettant des ruptures et de l’inédit. Face à ce qui apparaît nouveau, elle invoque comme explication une mauvaise « visibilité » passée comme actuelle des ouvriers (Pialoux et Weber, 2002), rendant, à mon sens, périlleuse la mise au jour de nouvelles subjectivités.
Les subjectivités politiques ne sont également pas prises en compte dans la défense du retour des analyses en termes de « classe » – et non plus de « classe ouvrière » – telle que cette défense apparaît au début des années 2000. Le concept de « classe » est ici aussi appréhendé dans ses dimensions scientifique et politique. Ainsi, pour les tenants de cette position, cette double dimension permet de saisir le « refoulemen » ou l’effacement du concept de « classe » dans les sciences sociales (Chauvel et Schultheis, 2003, 17-26 ; Dubar, 2003 : 35-44). Le concept constitue en quelque sorte un indicateur des rapports entre les sciences sociales et les organisations politiques et l’Etat, puisque la disqualification scientifique du concept de « classe » est expliquée par son abandon effectué par les sciences sociales. A contrario, ces mêmes sociologues défendent la restauration du concept de « classe » en invoquant des arguments politiques. C’est le cas de Louis Chauvel pour qui les analyses en termes de « classe » permettent de contrer ce que le discours de la fin des classes tend à annihiler intellectuellement et politiquement. Mais la question des subjectivités demeure le point aveugle de ses analyses. Chez d’autres sociologues, les subjectivités sont réduites au statut de discours, comme c’est le cas chez Claude Dubar. Pour celui-ci, « classe » ne correspond pas à une catégorie de pensée, mais à une notion relevant d’un discours que les gens reprennent ou pas, selon précisément la force politique de ce discours (Dubar, 2003 : 35-44). Il exclut de fait la possibilité d’une réelle autonomie de pensée chez les personnes interrogées.
La dissociation entre le caractère opératoire du concept de « classe » dans les sciences sociales et les subjectivités est affirmée de manière précise par François Dubet (Dubet, 2003 : 71-80). Il défend l’usage de ce concept en tant que « notion intellectuelle et politique » venant en renfort d’une dimension sociologique qu’il juge trop faible. Cet apport provient du fait que « classe » « désigne la présence et la force des mécanismes de domination sociale », inscrivant de ce fait les analyses dans une problématique de la domination.
« L’expérience des acteurs » peut être ainsi expliquée par la sociologie à partir de cette problématique portée par le concept de « classe », là où les propos recueillis en entretiens n’évoquent pas la présence de formes de pensée ayant la domination en leur cœur. Ce concept impose clairement une grille de lecture dans l’interprétation des entretiens et donc des subjectivités politiques.
Les sciences sociales envisagent le concept de « classe » dans un rapport dual entre science et politique, entraînant deux conséquences majeures. La première est que les problématiques s’inscrivent dans une continuité classiste, puisque les subjectivités ne sont pas présumées en rupture malgré la disqualification de la catégorie de « classe ouvrière ». La seconde, liée à la première, est que les subjectivités politiques sont mises sous le joug de ces problématiques que je nomme « néo-classistes ». Le concept de « classes populaires » s’inscrit pleinement dans ce cadre.
4 – « Classes populaires » : un concept « néo-classiste » et non-subjectivé
Une substitution de « classes populaires » à « classe ouvrière » sous le signe d’une continuité.
Le concept de « classes populaires » maintient une problématique classiste afin d’aborder les subjectivités politiques. Cette interprétation ne se déduit pas seulement du maintien du terme de « classe ». Les auteurs apportent eux-mêmes des clarifications sur la substitution de « classes populaires » à « classe ouvrière », qui ne se résume pas pour eux à un changement terminologique. Ces clarifications permettent de mesurer une partie des enjeux théoriques du concept de « classes populaires ». Florence Weber établit ainsi clairement une continuité entre les deux concepts, puisque « classes populaires » prendrait en charge les brouillages de la catégorie de « classe ouvrière » dus à sa dimension idéologique (Pialoux et Weber, 2002: 10-21). « Classes populaires » permettrait selon elle de dépasser la « visibilité » usurpée d’une partie des ouvriers – les ouvriers professionnels des « bastions industriels » – incarnant la « classe ouvrière » aux yeux des chercheurs. Cette mauvaise « visibilité » aurait vampirisé les études sur l’ensemble que constituent les « classes populaires ». En quelque sorte, Florence Weber appelle à un remplacement de « classe ouvrière » en tant que catégorie idéologiquement investie par celui de « classes populaires » qui ne le serait pas. Ce remplacement ne correspond pas à la nécessité de prendre en compte de nouvelles subjectivités apparues. Annie Collovald et Frédéric Sawicki appellent également au remplacement de « classe ouvrière » par « classes populaires » tout en développant un autre rapport entre les deux concepts (Collovald et Sawicki, 1991 : 7-19). « Classe ouvrière » jouait, jusqu’à sa disqualification, le rôle de prescripteur en matière de subjectivités politiques auprès des autres auprès des autres membres des classes populaires – englobant paysans, employés. De ce fait, le concept de « classes populaires » semble avoir un statut particulier chez ces deux auteurs.
D’une part, il est posé comme intangible, d’autre part, sa subjectivation s’opère via une autre catégorie. À présent, il est dans l’attente d’une subjectivation portée par une nouvelle catégorie qui correspondrait à de nouveaux représentants, à de nouveaux prescripteurs. L’appel à la recherche de « représentants » autres que les « porte-parole traditionnels » induit alors la mise au jour d’une nouvelle catégorie dont les ressorts théoriques sont identiques à ceux de « classe ouvrière ». La fin de la « classe ouvrière » formulée par eux comme une « destruction symbolique du groupe de référence » ne conduit pas à la possibilité de nouvelles formes de subjectivités politiques chez les membres de ce groupe, puisque ces subjectivités sont présentées comme seulement déstabilisées.
Quelque soient les modalités dans lesquelles sont pensées les rapports entre « classe ouvrière » et « classes populaires » [12], Ce dernier concept suppose que les subjectivités politiques portées antérieurement par le concept de « sont inchangées ». En cela, on le qualifiera de néo-classiste ». Ainsi il reconduit l’idée d’un antagonisme de classe et il se substitue terme à terme à « classe ouvrière » pour porter cette idée (Rey, 2066 :547-559). Le concept « classe ouvrière » représente un autre ancrage « classiste, à savoir l’idée que les subjectivités politiques puissent toujours être référées aux conditions objectives d’existence. Ainsi, la mise au jour d’une conscience populaire » chez les agents de la RATP telle qu’elle est menée par Olivier Schwartz constitue une illustration de ce cadre « néo-classiste » pour analyser les subjectivités politiques (Collovald et Schwartz, 2066 :50-55), cette forme de conscience se déduit, comme la conscience de classe, à la fois de l’appartenance à un groupe et également d’une vision antagoniste de la société, opposant deux groupes, « le peuple » et les « classes supérieures ». Il s’agit pour Olivier Schwartz d’un schéma dichotomique entre « eux /nous », « classique dans monde ouvrier et dans les classes populaires inédit, construit non plus sur un schéma dual mais « triangulaire » car tourné à la fois contre les plus hauts et les plus bas », il le fait reposer sur la même problématique, l’antagonisme étant déplacé au sein même des classes populaires. Un tel dispositif classiste, même s’il reste ouvert à la nouveauté, contraint O. Schwartz à mettre au jour des formes de consciences calquées sur la conscience de classe.
Cette catégorie de « conscience populaire » appelle immanquablement à une autre réserve théorique d’importance. Lorsque la conscience de classe s’amarrait à une catégorie – la « classe ouvrière » –, subjectivée par ceux qui s’en réclamaient, il n’en est rien pour le concept de conscience populaire. Dans la mesure où « peuple » n’est nullement une catégorie subjective permettant de penser la politique, le concept de « conscience populaire » est entièrement construit par le chercheur [13].
La mise au jour du concept de « classes populaires » répond en fait à deux options liées entre elles. La première est le maintien d’une vision classiste des subjectivités politiques. La seconde est la construction exclusivement scientifique d’un concept. Cette construction est à l’origine de l’absence de renouvellement des dispositifs d’enquête sur les subjectivités contemporaines qui, seul, ouvrirait à la mise au jour de nouvelles catégories, nécessairement subjectivées par les membres des classes populaires.
5 – « Classes populaires » : un concept a priori, construit indépendamment des enquêtes et des enquêtés.
Le concept de « classes populaires » engage une identification des subjectivités politiques présentes dans le groupe, à partir de critères objectifs et posés par le chercheur. À ce titre, il est investi de la fonction d’opérateur de ces subjectivités considérées comme inhérentes au groupe. C’est le cas précisément avec l’idée d’un rapport à la politique posé comme « pratique culturelle » propre au groupe (Collovald et Sawicki, 1991: 7-19). Selon A. Collovald et F. Sawicki, ce rapport émane d’un groupe subissant « domination » et « dépossession » (Collovald et Schwartz, 2006 : 50-55) [14] et il est supposé intangible et définitionnel. La définition que proposent les deux auteurs du rapport à la politique spécifique aux classes populaires comprend plusieurs traits. D’abord, il se distingue par une « indifférence » à la politique assimilée à un domaine intellectuel. Le vote est ensuite posé comme désinvesti politiquement. Enfin, les classes populaires ont un besoin impérieux d’être représentés pour « saisir » les enjeux politiques et être « saisis » dans l’espace parlementaire (Collovald et Schwartz, 2006 : 50-55). On remarquera que ces traits sont non seulement repérés a priori, mais qu’en outre, ils sont négatifs, se caractérisant par une absence ou un manque par écart avec une norme établie par le chercheur.
Ce sont ces considérations sur le « rapport à la politique des classes populaires » qui guident l’enquête que mènent Céline Braconnier et JeanYves Dormagen sur les comportements électoraux dans un quartier de Saint-Denis entre 2002 et 2006 (Braconnier et Dormagen, 2007). « Le rapport à la politique spécifique aux classes populaires » est le cadre à partir duquel s’élaborent leurs hypothèses en même temps qu’il est le cadre dans lequel s’effectuent leurs analyses. De ce fait, les traits repérés prennent le statut de définitions offrant à la fois les hypothèses et les conclusions directement inscrites dans la grille de lecture choisie. Une réponse à la question « gauche et droite veulent dire quelque chose ? », formulée par un de leurs interlocuteurs, « cela ne veut rien dire » est analysée à partir de la thématique de l’incompréhension et de l’incompétence réputées propres aux groupes populaires. La réponse donnée n’est nullement considérée comme un résultat, à savoir que ces deux catégories propres à l’espace politique et qui ont pu avoir du sens précédemment, n’en ont plus aujourd’hui pour cet interlocuteur. Une perspective optant pour la mise au jour des catégories contemporaines propres aux personnes interrogées aurait quant à elle, pris pour point de départ de l’analyse la réponse de l’interlocuteur en l’envisageant comme le signe d’une contemporanéité à explorer. Au contraire, C. Braconnier et J.-Y identifient le rapport à la politique en terme de « compétence politique », à savoir la capacité à interpréter le monde social dans les catégories et les schèmes de pensée produits par l’espace politique. Ce faisant, ils considèrent que la « politisation typique des milieux populaires » se présente « a minima dans la mesure où elle ne s’accompagne, pas d’une très grande attention pour la vie politique et les campagnes électorales, pour les subtilités de l’offre et de ses variations, et va d’ailleurs fréquemment avec une certain indifférence ». L’ « indidifférentisme »» est présenté par C. Braconnier et J.-Y Dormagen comme « traditionnellement très répandu » dans « les territoires populaires». Ce qui explique pourquoi, selon eux, les groupes populaires ont un tel besoin d’être encadrés politiquement – les chercheurs font référence à l’époque où la présence de militants du PCF était à l’origine d’un fort taux de mobilisation électorale dans le quartier. Le fait que les élections ne soient pas envisagées « comme un moyeu permettant d’obtenir ne serait-ce qu’une légère amélioration de leurs conditions d’existence » est analysée comme l’indice d’une « indifférence » et non, une nouvelle fois, pour ce qui est énoncé, à savoir l’expérience concrète que les élections ne changent rien à la vie quotidienne.
Partir d’une conception définitionnelle du « rapport à la politique » « en milieu populaire » mène donc les deux chercheurs à analyser leurs entretiens dans une logique d’illustration et de vérification de leurs hypothèses qui, à mes yeux, ne laisse aucune place à la subjectivité des personnes interrogées. L’enquête a davantage une fonction de validation de leurs hypothèses que pour but de révéler de nouvelles subjectivités politiques après la fin de la « classe ouvrière ».
La construction a priori de l’objet d’étude que constitue « le rapport à la politique spécifique aux « classes populaires » induit cette forme d’enquête ayant pour enjeu l’illustration. Cette manière de procéder est antithétique d’une recherche portant sur les représentations et les subjectivités politiques. En effet, ce type de recherche appelle à des enquêtes d’exploration dans la mesure où les subjectivités ne peuvent par définition être présupposées. L’objet à étudier ne peut se construire que dans l’enquête elle-même et les entretiens (Duchesne, 1996 : 189-206) et (Lazarus, 2001 : 389-400).
En outre, des enquêtes d’exploration s’avèrent d’autant plus nécessaires dans la mesure où la séquence dans laquelle nous nous trouvons est encore aujourd’hui caractérisée comme l’après « classe ouvrière », quand s’impose pour elle-même.
6 – La fonction d’homogénéisation des « classes populaires » et l’ethnicisation des analyses
La mise au jour d’une conscience ethnique afin d’homogénéiser les « classes populaires ».
Comme je l’ai montré précédemment, le concept de « classes populaires » inscrit les analyses portant sur les subjectivités politiques dans un double cadre. Le premier cadre est celui de la déstructuration de la « classe ouvrière » et de ses conséquences. Le second est celui de l’identification d’un rapport à la politique spécifique à ce groupe. Outre l’assise à ces deux cadres, le concept de « classes populaires » assure la fonction d’homogénéisation du groupe, fonction tenue auparavant par la « classe ouvrière ».
La combinaison de ces deux cadres et de cette dernière fonction pro duit des analyses en termes d’ethnicisation ou de racialisation des subjectivités politiques. Ce type d’analyses est notable dans les études portant sur le vote et plus encore sur « les émeutes de novembre 2005 ». Il ne s’agit pas pour moi de contester de telles conclusions – une telle contestation devrait en effet s’appuyer sur des enquêtes approfondies –, mais de montrer comment elles découlent du double cadre problématique et de la fonction d’unification du groupe assurée par le concept de « classes populaires ».
Les analyses établissant un « vote ethnique » menées par C. Braconnier et J.-Y. Dormagen (Braconnier et Dormagen, 2007) illustrent la présence de cette combinaison. Ainsi, c’est en postulant comme caractéristique propre aux classes populaires, une attention privilégiée à « l’hexis corporelle » qu’ils identifient les votes pour la candidate des Radicaux de Gauche en 2002 et celui pour la liste Europalestine en 2004 comme étant des « votes ethniques ». Les classes populaires auraient besoin que leurs candidats leur ressemblent, faisant de leurs votes des votes identitaires. Je repère ici la même opération intellectuelle que celle décrite plus haut à propos de l’« indifférentisme » à la politique, à savoir que la qualification de ces votes procède d’une interprétation également menée à partir d’un trait établi a priori, ici « l’hexis corporelle ».
De plus, en considérant que les subjectivités politiques contemporaines découlent de la désaffiliation classiste, les deux chercheurs envisagent comment s’opère une restructuration des subjectivités sur les « décombres de l’ancienne identité de classe ». On comprend alors que pour C. Braconnier et J-Y Dormagen, une identité de classe affaiblie appelle au renforcement d’une autre identité qui vient se substituer à la première ou la concurrencer dans l’explication des ressorts du rapport à la politique via le vote. La qualification de vote ethnique est portée par la problématique de la déstructuration de la classe ouvrière.
Cette qualification est également portée par l’entreprise d’unifier les subjectivités politiques éclatées. C’est ainsi que l’on peut comprendre pourquoi le vote pour le Front national est rangé dans la catégorie du vote ethnique.
Il répond lui aussi à une « entreprise de promotion identitaire dans des milieux populaires en perte de repères collectifs. Cette symétrie entre ces votes est très discutable, et d’ailleurs les deux politistes prennent soin de ne pas les confondre. Si C. Braconnier et J.-Y Dormagen classent ces trois votes dans la même catégorie, c’est pour répondre à leur entreprise d’homogénéiser les subjectivités politiques des classes populaires après la « classe ouvrière », ici sous la règle du vote « ethnique ».
Ma réserve est suscitée par le fait que le double cadre soutenant le concept de « classes populaires », la déstructuration de la « classe ouvrière » et la spécification a priori du rapport à la politique produit ce type de conclusions. Celles-ci permettent d’assurer une homogénéisation du groupe d’un point de vue subjectif. Mais là aussi, cette homogénéisation est le fait des chercheurs, ne procédant pas des subjectivités révélées par les enquêtes.
Une « rupture d’intelligibilité » nécessitant un autre cadre que la déstructuration de la classe ouvrière Le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière est encore utilisé pour analyser les subjectivités des jeunes habitants des banlieues après les « émeutes de novembre 2005 ». Comme pour le vote, il produit des analyses en ternies d’ethnicisation ou de racialisation des subjectivités. L’analyse de Robert Castel publiée dans un numéro spécial des Annales consacré aux émeutes en fournit une illustration (Castel, 2006 : 777-808). Selon R. Castel, les jeunes, en tant que membres des classes populaires, ont vocation à être encadrés politiquement et à bénéficier de supports de type classiste. En l’absence de ceux-ci, une conscience « ethno-raciale » voit le jour et compense une conscience sociale en déshérence.
Cette interprétation, par son caractère surprenant de la part d’un sociologue ayant toujours opté pour des analyses en termes d’appartenance sociale, est révélatrice d’un mouvement affectant plus largement les sciences sociales en France. L’illégitimité qui frappe la problématique d’ethnicisation ou les réticences qu’elle provoque au sein d’une sociologie fondée sur la question sociale sont en voie d’être dépassées. Non pas tant par le nombre de recherches adoptant cette problématique, que par le fait précisément que des chercheurs ayant toujours considéré les subjectivités en termes d’appartenance sociale envisagent désormais une ethnicisation – ou une racialisation – des subjectivités.
L’articulation entre conscience sociale et conscience ethnico-raciale telle qu’elle est opérée par R. Castel ou encore S. Beaud et M. Pialoux (Beaud et Pialoux, 2006 : 72-90) donne une nette prééminence à la conscience sociale – à la différence de Didier Fassin et d’Eric Fassin qui n’établissent aucune hiérarchie entre les deux types de conscience (Fassin et Fassin, 2007). Mais quelle que soit la conception de cette articulation, ces auteurs s’accordent sur l’enjeu repéré lors des « émeutes de novembre 2005 ». Cet enjeu pourrait être indiqué par le titre interrogatif de l’ouvrage De la question sociale à la question raciale ? Les « émeutes de novembre 2005 » constituent un « événement » tel que le conçoivent Alban Bensa et Eric Fassin (Bensa et Fassin, 2002 : 5-20) en ce qu’elles induisent une « rupture d’intelligibilité », nécessitant alors des changements de cadres intellectuels. Pour y faire face, les sciences sociales se doivent de renouveler leurs problématiques afin de prendre en compte les nouvelles subjectivités présentes chez les classes populaires. Et la « rupture d’intelligibilité » consiste chez de nombreux chercheurs à articuler les deux types de conscience.
Or, une « rupture d’intelligibilité » ne peut être considérée comme telle que si elle ne reconduit pas le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière en vigueur depuis les années 1980, et qui, à mon sens, est inadéquat pour analyser les subjectivités actuelles. Ce cadre est pourtant celui auquel ont recours Stéphane Beaud et Michel Pialoux pour étudier les subjectivités des ouvriers depuis les années 1980. Ainsi, dans Retour sur la condition ouvrière qui retrace leurs enquêtes menées dans les années 1980 et 1990, ils analysent les tensions racistes au sein des ouvriers ou la montée du vote pour le FN en tant que symptômes de la décomposition du groupe ouvrier (Beaud et Pialoux, 1999). Et c’est encore à partir de ce cadre qu’ils analysent une émeute survenue à Montbéliard en 2000 (Beaud et Pialoux, 2003). C’est toujours ce même cadre qui est utilisé par Stéphane Beaud en compagnie d’Olivier Masclet dans un article publié après les émeutes (Beaud et Masclet, 2006 : 809-843). Cette reconduction pour analyser les subjectivités des jeunes des classes populaires à la suite des « émeutes de novembre 2005 » soulève une question : ce cadre est-il encore justifié trente ans après sa mise au jour ?
L’article publié par Stéphane Beaud dans Les Annales après les « émeutes de novembre 2005 » offre des éléments de réponse, en témoignant d’une avancée notable des analyses ethnico-raciales chez cet auteur qui a toujours défendu des analyses en termes de conscience sociale (Beaud et Pialoux, 2006 : 72-90). Cette avancée est à mettre pleinement sur le compte du cadre de la déstructuration de la classe ouvrière. Comme l’indique le titre, « Des “marcheurs” de 1983 aux “émeutiers” de 2005. Deux générations sociales d’enfants d’immigrés », ils comparent deux générations d’« enfants d’immigrés » selon leurs socialisations. Lorsque la « génération des beurs » est fabriquée par une période politique, la « génération des cités » l’est par une « longue période de crise sociale ». A priori, il pourrait leur être reproché de faire un tel rapprochement entre une socialisation de nature politique et une socialisation sociale. À mon sens, cette distinction n’est qu’apparente, camouflant l’intérêt des deux auteurs pour une socialisation politique qui se caractérise précisément par une socialisation par défaut. En effet, les jeunes sont présentés comme appartenant à la « génération des cités » dans la mesure où ils sont dépourvus de « supports politiques et symboliques ». Et c’est bien le cœur de leur analyse. S. Beaud et O. Masclet notent la concomitance entre le processus de « désouvriérisation » et la « construction d’une conscience plus “raciale” que sociale chez les enfants d’immigrés maghrébins » – l’apparition d’une conscience « raciale » est promue par le développement d’une « mémoire immigrée », qui renvoie précisément à une identification à des origines nationales ou religieuses.
L’analyse que proposent Stéphane Beaud et Olivier Masclet témoigne de deux partis-pris qui ne relèvent nullement d’une « rupture d’intelligibilité ». En effet, ils maintiennent les hypothèses et les conclusions dans le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière. Quant aux nouvelles formes de conscience ethnique ou raciale mises en lumière, elles découlent de ce cadre, puisqu’elles sont présentées comme des subjectivités de substitution. Notons enfin, qu’elles ne sont pas mises au jour par des analyses d’entretiens.
Pour conclure provisoirement
L’évaluation du concept de « classes populaires » tel qu’il est utilisé dans les études sur les subjectivités politiques doit se mener à partir de l’examen des problématiques portées par ce concept. L’attention doit se porter plus précisément sur la manière avec laquelle a été envisagée la disqualification de la catégorie qu’il remplace, celle de « classe ouvrière ». En l’occurrence, si cette disqualification a obligé les sciences sociales à se défaire du vocabulaire marxiste, elle n’a pas conduit à une « rupture d’intelligibilité » dans la conception des formes de pensée et des représentations politiques présentes dans les classes populaires. Cette analyse témoigne à mon sens de l’oubli d’une des dimensions de la catégorie de « classe » qui n’était pas seulement une catégorie politique et scientifique, mais qui était également subjectivée par les personnes interrogées. Or, « classes populaires » est un concept construit et objectivé par les chercheurs en vue d’analyser les subjectivités politiques contemporaines. Ce faisant, les études menées à partir de ce concept imposent une clôture problématique qui empêche de voir émerger d’éventuelles nouvelles formes de subjectivité classiste. Et cette mise au jour ne peut procéder que par des catégories révélées par des enquêtes d’exploration. C’est pour cette raison que l’évaluation de « classes populaires » doit se mener également à la lumière de sa mise à l’épreuve par les enquêtes. Or, celles-ci témoignent, nous l’avons montré, d’une démarche consistant à analyser les subjectivités à partir d’un concept objectivé par les chercheurs, une démarche qui consiste davantage en une projection de leurs raisonnements scientifiques que dans une interprétation des subjectivités de classe. La critique effectuée en 1983 par Pierre Bourdieu à propos de « milieux populaires » (Bourdieu, 1983 : 98-105) peut à mon sens être appliquée à celle de « classes populaires ». Ces notions renseignant davantage sur les intérêts des chercheurs que sur les subjectivités politiques contemporaines.
BIBLIOGRAPHIE
Beaud, S., Pialoux, M. (1999), Retour sur la condition ouvrière, Fayard, Paris.
Beaud, S., Pialoux, M. (2003), Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Fayard, Paris
Beaud, S., Pialoux, M. (2006), « Racisme ouvrier ou mépris de classe ? Retour· sur une enquête de terrain », in Fassin, D., Fassin, E. (éd.), De la question sociale à la question raciale?, La Découverte, Paris, pp. 72-90.
Beaud, S., Masclet, O. (2006), « Des marcheurs de 1983 aux émeutiers de 2005. Deux générations sociales d’enfants d’immigrés », in Annales, n°4, pp. 809-843.
Bensa, A., Fassin, E. (2002), « Les sciences sociales face à l’événement», in Terrains, n°38, pp. 5-20.
Bihr A., Pfefferkorn, R. (2004), « Du système d’inégalités aux classes sociales », in: Bouffartigue, P (éd.), Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, La Dispute, Paris.
Bourdieu, P (1983), « Vous avez dit “populaire” ? », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°46, pp. 98-105.
Braconnier C., Dormagen, J.-Y (2007), La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Gallimard, Paris.
Castel, R. (2006), « La discrimination négative. Le déficit de citoyenneté des jeunes de banlieue», in Annales, n°4, pp. 777-808.
Chapoulie, J.-M. (1991), « La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe ouvrière », in Revue française de sociologie, n°32, pp. 321-364.
Chauvel, L., Schultheis, F. (2003), « Le sens d’une dénégation : l’oubli des classes sociales en Allemagne et en France », in Mouvements, n°26, pp. 17-26.
Collovald, A, Sawicki, F. (1991), « Le populaire et le politique. Quelques pistes de recherche en guise d’introduction », in Politix, n° 13, pp. 7-19.
Collovald, A, Schwartz, O. (entretien avec) (2006), « Haut, bas, fragile, sociologies du populaire », in Vacarme, n°37, pp. 50-55.
Cornu, R. ( 1995), « Nostalgie du sociologue : “La classe ouvrière n’est plus ce qu’elle n’a jamais été”», in : Deniot, J., Dutheil, C. (éd.), Métamorphoses ouvrières, L’Harmattan, Paris, pp. 345-353.
Dubar C. (2003), « Sociétés sans classes ou sans discours de classe ?», in Lien social et Politiques, n°49, pp. 35-44.
Dubet, F. (2003), « Que faire des classes sociales ? », in Lien social et Politiques, n°49, pp. 71-80.
Duchesne, S. (1996), « Entretien non-préstructuré, stratégie de recherche et étude des représentations. Peut-on faire l’économie de l’entretien “non-directif” en sociologie?», in Politix, n°35, pp. 189-206.
Fassin, D., Fassin, E. (éd.), (2006), De la question sociale à la question raciale ?, La Découverte, Paris.
Lazarus, S. (éd) (1986), Etude sur les formes de conscience et les représentations des OS des usines Renault, CNRS-RNUR, rapport dactylographié.
Lazarus, S. (2001), « Anthropologie ouvrière et enquêtes d’usine : état des lieux et problématique», in Ethnologie française, n°87, pp. 389-400.
Michelat, G., Simon, M. (2004), Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures et réalignements, Presses de Sciences Po, Paris.
Molinari, J.-P (1995), « L’idéalisation communiste de la classe ouvrière », in Deniot, J., Dutheil, C. (éd.), Métamorphoses ouvrières, L’Harmattan, Paris, pp. 337-343.
Pfefferkorn, R. (2007), Inégalités et rapports sociaux. Rapports de classes, rapports de sexes, La Dispute, Paris.
Pialoux, M., Weber F. (2002), « La gauche et les classes populaires. Réflexion sur un divorce », in Mouvements, n°23, pp. 10-21.
Rey, H. (2006), « Des classes populaires (presque) invisibles », in : Beaud, S., Confavreux, J., Lindgaard, J. (éd.), La France invisible, La Découverte, Paris, pp. 547-559.
Schwartz, O. (1990), Le monde privé des ouvriers, PUF, Paris.
Schwartz, O. (2005), « Quelques réflexions sur la notion de classes populaires », in Au fil du travail des sciences sociales (cycle de conférences), http: //socio.ens-lsh.fr/conf/conf_2005_1 l_schwartz.php
Simon, M. (2006), « Mais comment peut-on être persan ? », in Nouvelle Fondation, n°3-4, pp. 115-119.
Terrail, J.-P (1990), Destins ouvriers. La fin de la classe ouvrière ?, PUF, Paris.
Touraine, A, Wieviorka, M., Dubet, F. (1984), Le mouvement ouvrier, Fayard, Paris. Verret, M. (1999), Le travail ouvrier, L’Harmattan, Paris.
Weber F. (1991), « Nouvelles lectures du monde ouvrier : de la classe aux personnes », in Genèses, n°6, pp. 179- 189.
* Samia Moucharik fut doctorante en anthropologie à l’université de Paris 8 au moment de la rédaction de cet article publié en dans le n°6 de la revue Les Mondes du Travail
[1] Cf. les deux numéros de Politix en 1991 sur les liens entre le politique et « populaire ».
[2] Lefebvre, R., Sawicki, F. (2007), « Pourquoi le PS ne parle-t-il plus aux catégories populaires », in Mouvements, n°50, pp. 24-32.
[3] Cette position doit trouver sa généalogie dans un article de Pierre Bourdieu datant de 1983, dans lequel il conteste précisément la rigueur de « milieux populaires » en la présentant comme une « notion à extension indéterminée » qui « doit ses vertus mystifîcatrices, dons la production savante, ou fait que chacun peut, comme dons un test projectif en manipuler inconsciemment / l’extension pour l’ajuster à ses intérêts, à ses préjugés ou à ses fantasmes sociaux » (Bourdieu, 1983 : 98-105).
[4] Mon propos porte exclusivement sur « classe » en tant que concept permettant d’analyser les subjectivités politiques, et non comme paradigme sociologique plus large expliquant la stratification sociale, les comportements et rapports sociaux.
[5] Par-là, je désigne les subjectivités politiques des personnes appartenant objectivement aux classes populaires. Afin de ne pas postuler le fait que les subjectivités politiques se déduisent de l’appartenance sociale à un groupe, j’utiliserai l’expression de « subjectivités politiques ».
[6] Je renvoie à (Pfefferkorn, 2007) qui 1’appelle précisément combien la sociologie française « de Halbwachs à Bourdieu » est classiste.
[7] Il ne s’agit pas néanmoins pour les chercheurs d’affirmer un animisme au sein de la classe ouvrière, comme en témoigne Dogan, M. (1962), « Les clivages politiques de la classe ouvrière », in Hamon L. (éd.), Les nouveaux comportements politiques de la classe ouvrière, PUF, Paris.
[8] Le principe de ce type d’entretien est de « transférer du chercheur à l’enquêté l’initiative de l’exploration A partir d’une consigne initiale, on cherche à mettre la personne interrogée en situation d’explorer tout ce qui, dans son horizon propre, est associé à ce stimulus de départ, et de définir par conséquent elle-même son champ d’investigation » (Michelat et Simon, 2004).
[9] Cf. Kergoat, D. ( 1987), Les ouvrières Le Sycomore, Paris; Minces, J. ( 1974), Les travailleurs étrangers, Le Seuil, Paris ; Dumont ; J-P ( 1973), La fin des OS?, Mercure de France, Paris. Cet intérêt doit être rapproché de leur visibilité plus grande à la suite des grèves de 1968. Cf. Vigna, X. (2007), L’insubordination ouvrière dans les années 1968. Essai d’histoire politique des usines, PUR, Rennes.
[10] Cf Gougou, F. (2007), « Les mutations du vote ouvrier sous la V’ République », in Nouvelles Fondations, °5, pp, 15-20.
[11] A été également menée une réhabilitation de « classe » en tant que concept analysant la stratification sociale, Sa pertinence est défendue en vue de saisir les inégalités sociales ainsi que l’existence de conflits entre classes. Cf Bouffartigue P. (dir) (2004), Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, La Dispute, Paris et (Pfefferkorn, 2007).
[12] Modalités exposées ici sans souci d’exhaustivité mais avec celui de l’exemplarité.
[13] Qui se réfère à Hoggart. R ( 1970), La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Ed. de Minuit, Paris, dont la première édition anglaise date de 1957 et porte un titre à bien égard très différent : The Uses of literacy et porte sur la permanence d’une culture ouvrière classiste dans le contexte des médias de masse et d’émergence de la société de consommation.
[14] 14. Ce qui est remarquable, c’est que les travaux de Richard Hoggart et de Pierre Bourdieu sont invoqués dans la définition de ce rapport à la politique. Ainsi, les travaux du premier sont utilisés pour asseoir la thèse d’une indifférence à la politique, alors qu’ils datent des années 1950. Ce faisant, le rapport à la politique des classes populaires est supposé a-historique.
Par Stéphen Bouquin
Les classes sociales semblent devenus des « objets transitionnels » pour la sociologie : soit on évoque la honte d’appartenir à la classe ouvrière (Beaud, Pialoux), soit il est question de transfuges (vers le haut), soit on est amené à découvrir par le biais d’une auto-analyse biographique la dureté de l’existence ouvrière (Joseph Ponthieux) soit on décrit une culture ouvrière et populaire peu à même de nourrir une identité de classe à laquelle peut s’identifier. Lorsque les classes sociales sont au centre d’un colloque ou de réflexions collectives, comme par exemple le congrès de l’AFS à Aix (août 2019), le sens commun sociologique penche presque inévitablement vers une sociologie des stratifications sociales, qu’elles soit de nature culturaliste ou objectiviste-positiviste centré sur les modes de consommation, les goûts culturels, l’absence de patrimoine et le faible niveau de revenu etc. Je n’irais pas jusqu’à dire que ces aspects sont négligeables, loin s’en faut. Mais une question demeure silencieuse dans la plupart des analyses sociologiques, à savoir la l’appartenance de classe du point de vue des sujets eux-mêmes. Est-elle si négligeable au point où l’identité de classe portée par les membres de groupes sociaux est d’aucun intérêt pour la sociologie ?
Certes, « nous sommes le peuple » est une identité subjective très puissante lorsque des mobilisations se développent. Mais en dehors des périodes de mobilisations sociales (comme par exemple contre la réforme des retraites) une telle rhétorique populiste reste extrêmement perméable à l’ethnocentrisme. Owen Jones (2011) a montré comment en Angleterre les Chavs (jeunes urbains faiblement scolarisés et d’origine modeste) étaient d’abord un stigmate porté par les jeunes du monde ouvrier et comment cette identité est devenue un contre-stigmate ( “We are the chavs !”), affirmant une identité collective plébéienne ou prolétarienne contemporaine. Mais Owen Jones constatait aussi aussi que cette affirmation identitaire « classiste » est principalement blanche et bien éloignée de la culture ouvrière de la jeunesse des années 1960-1970, période pendant laquelle la jeunesse ouvrière blanche et jamaïcaine des Docklands ou des villes industrielles du centre de l’Angleterre se mélangeait tant au niveau des contre-cultures musicales que des milieux de travail.
En France, on n’évoque plus la classe ouvrière mais plutôt les classes populaires. Si la définition de la classe ouvrière fut pendant longtemps marquée par un ouvriérisme délibéré porté par le PCF, qui en réclamait être l’unique représentant, l’ouvriérisme que d’autres courants portaient en bandoulière perdait sa force d’appel au fur et à mesure que la désindustrialisation progressait et que défaites syndicales et politiques s’accumulaient.
Depuis les années 2000, la sociologie prenant les classes subalternes pour objet ont troqué la notion de classe ouvrière par celle de « classes populaires ». Il s’agit pour l’essentiel d’un substitut nominal à une « classe ouvrière » telle qu’elle était définie comme par un marxisme orthodoxe français qui était calquée sur la catégorisation socioprofessionnelle étatiste de l’INSEE (les cols bleus, les travailleurs productifs, les manuels, masculins). Cette définition restrictive laissait de côté les travailleurs des services « improductifs », essentiellement des femmes, ainsi que les employés, les cadres, techniciens ou ingénieurs (« cols blancs ») qui feraient désormais partie des « classes moyennes ». Or, une telle analyse stratificationniste et culturaliste est beaucoup trop statique et ne peut pas être appropriée par ceux qui appartiennent ce groupe social. Dit autrement, si les « classes populaires » existent, qui s’en revendique ? Si les « classes populaires » existent « en soi », peuvent-elles devenir des classes « pour soi » ? Lorsqu’elles le font, c’est surtout en mobilisant le registre discursif populiste identitaire, comme les « français de souche » par exemple.
Un second problème non résolu est le fait que les classes forment des groupes sociaux qui se positionnent toujours par rapport à d’autres. C’est la question du « nous » et du « eux » comme l’avait bien formulé Richard Hoggart dans The Uses of literacy (mal traduit qui est plus avec un titre La culture du pauvre qui n’a rien à voir avec le contenu).
Lorsqu’on est assigné appartenir au classes populaires, l’enjeu premier est de ne plus y appartenir, d’accéder à la propriété, que les enfants fassent des études supérieures et gagnent bien leur vie. Bref, l’enjeu est de monter sur l’échelle sociale et les conduites sociales comme les imaginaires sociaux s’organisent autour d’une « lutte des places » au lieu de s’inscrire dans un antagonisme de classe qui n’a pas disparu au demeurant puisque la « lutte des classes » se mènent aussi et surtout par la classe dirigeante.
On oublie souvent que la définition de la classe laborieuse ou du prolétariat proposée par Marx est négative : la classe des travailleurs regroupe les personnes qui ne possèdent pas les moyens de production et qui sont dès lors contraints de travailler pour subvenir à leurs besoins. La conscience d’appartenir à une même classe subalterne a toujours fluctué ; elle est la résultante d’une situation objective partagée et des mobilisations en opposition « contre ceux d’en haut ».
Les travaux d’Edward P. Thompson et d’Antony Giddens permettent de renouer avec une analyse des classes qui fonctionne sur le plan analytique et qui fait sens sur le plan discursif et subjectif. Pour Anthony Giddens, la classe laborieuse (working class) est formée par un processus de structuration double, à la fois objectif et subjectif. Les frontières de classe (mobilité sociale) ou les caractéristiques socio-économiques (revenus, type d’habitat) et culturelles (loisirs, capital culturel, capital social, habitus, etc.) comptent mais pas autant que l’expérience des mobilisations, des conflits sociaux et une mémoire collective portée par les organisations syndicales ou politiques. Pour Giddens tout comme pour Marx, l’identification subjective (le « nous ») est déterminante et se fonde sur une réalité vécue et sur la compréhension d’une adversité et un conflit d’intérêts. Ce conflit d’intérêt ne concerne pas seulement le travail salarié, le partage des gains de productivité et de la « valeur ajoutée » mais aussi la protection sociale, les services publics et notamment la qualité des services de santé, le logement etc.
En évoquant ab nauseam les classes populaires, la sociologie a – sans doute inconsciemment et involontairement – contribué à affaiblir les ressources subjectives de dignité et de fierté, et dilué le sentiment d’injustice dans un magma populiste fut-il de gauche. On doit à Chantal Mouffe et Ernesto Laclau d’avoir élaboré l’armature théorique et conceptuelle où l’antagonisme du peuple contre la caste a effectivement permis de mobiliser en Amérique Latine les masses paupérisées par 20 ans de néolibéralisme. Mais en Amérique Latine, el pueblo est bigarré et multiracial tandis que l’oligarchie est en général très blanche… La transposition de cette approche populiste en Espagne par Pablo Iglesias et Podemos a fonctionné pendant un certain temps mais son élan s’est brisé sur le mur du réalisme et les couches moyennes qui ont vu leur condition se détériorer.
En Europe, les contours des groupes sociaux à mobiliser vont bien au-delà des « classes populaires » mais intègrent des secteurs du salariat grandement fragilisés comme comme des travailleurs hors-statut. Or, l’enjeu discursif et politique est justement de reconstruire une communauté d’intérêts, un « nous » à la fois inclusif et antagoniste sur des bases qui ne laissent pas le champ libre au populisme de droite, nativiste et raciste. Comme le disait Descartes « mal nommer les choses, c’est apporter du malheur au monde »… Bien les nommer, c’est se donner les moyens d’y voir plus clair, ce qui est sans doute aussi une précondition pour agir plus efficacement.
Au vu des discussions stratégiques à gauche, en rappelant combien certains instrumentalisent la classe ouvrière des « périphéries» (pensons aux interventions de Fabien Roussel ou de François Ruffin) en l’opposant à des groupes sociaux des quartiers populaires des métropoles urbaines fortement marqués par les migrations des anciennes colonies, il nous semblé utile de republier un article de Samia Moucharik critique de la notion de “classes populaires”, d’une grande qualité argumentative que nous avons publié en 2008 dans un numéro N° 6 avec un dossier sur classes laborieuses, orientation politiques et militantes, et qui n’a pas pris une ride, faut-il le souligner.
_____________________
Références
Giddens Anthony et Held David. (1982), Classes, Power and Conflict, University of California Press, 640p. ISBN, 9780520046276
Thompson Edward Palmer (1988 [édit. orig. 1963]) La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Seuil
Jones Owen (2011), Chavs. The demonization of the working class, Verso, 352p.
Ponthus J. (2019), À la ligne. Feuillets d’usine, Folio276p.
Hall Stuart et Jefferson Tony (sous la dir. de), Resistance Through Rituals : Youth Subcultures in Post-War Britain, Routledge, Londres – New York, 2003 (1re éd. : 1976).
It is with regret that we announce the cessation of publication of the journal Les Mondes du Travail. The Editorial Board has been involved in an internal conflict that has dragged on for several months over the past year. This conflict developed in a context marked by a weakening of our financial base and an accumulation of organizational problems. Although the coordination of the dossiers was taken on collectively, the secretarial work and subscriber management continued on a voluntary basis, which is indicative of a lack of institutional support, even though the journal has gained in recognition and visibility since 2019.
It also has to be said that the field of scientific publishing has undergone profound changes over the last years or so. The number of online journals has exploded and their organizational economy is based, for the most part for french language, on the Revues.org platform publishing online more than 670 different journals, if not on the Cairn pay portal publishing more than 550 journals. Obviously, the publication of a scientific journal has gained in ‘exchange value’ from the point of view of the economics of the academic field and (fairly precarious) careers, but it is also undeniable that its ‘use value’ is being steadily eroded.
The race to ‘publish or perish’ is generating an inflationary spiral in which the quantity of articles published outweighs their quality and breeds mediocrity. Generally speaking, the overall content of a journal is far less important than the multitude of articles that can be consulted separately and that will feed Chat GPT which will producing paraphrases helpful to write quickly a set of articles that will probably be published one or two years later, if so. This whole inflationary competitive climate which is propelled by the neoliberal university and its growing managerialist culture generates a kind of self-harming disease (cfr. the concept of auto-immunic pathology used by J. Derrida), producing the opposite that it pretends to achieve. Of course, in such a context, the search for coherence is evacuated, the availability for true dialogue between researchers becomes minimalist and critical positions or analysis that does not cope with mainstream doxa in social sciences are discarded or pushed towards self-censorship. By taking this decision, we definitely won’t be part of the problem…
However, despite the headwinds, we have managed to maintain an open and critical approach regarding work, labour, employment relations, as well as collective action for almost 18 years, with 30 issues published to date. But it has to be said that such an approach is difficult to sustain without support of structures such as research units. Knowing that the organizational culture of the world of academic research is more and more based upon free labour delivered by precarious ph.d students and post-docs, and since we do not want to move on that road, it seemed preferable to cease publication of the journal and redeploy our resources towards objectives and projects in line with the principles that presided over the launching of the journal in 2006. The individual and institutional subscriptions registered for the year 2024 will therefore come to an end with issue 31, due for a printed publication before end of 2024.
In the meantime, we are setting up a new platform for multilingual publication, editing and critical research connected to the real world and dealing not only with labour and work but with all interlinked urgent issues such as authoritarianism, democracy, the degradation of urban life, political economy, the war on nature and on life. This platform which will be made public when issue 31 will be printed. In the coming months we will also publish on this website the english translation of the most interesting articles and interviews such as those with Michael Burawoy, Dave Lyddon and Martin Kuhlman, Moshe Postone, Oskar Negt, Ewan Gibbs, Ake Sandberg, Robert Karasek, Antonio Casilli, Michel Lallemant and Michèle Riot-Sarcey, Fernando Urrea-Giraldo, Jorge Cabrita, Danièle Kergoat, Laurent Vogel, Anselm Jappe and Danièle Linhart.
Two steps back, one step forward!
For the executive board of the editing structure “Les Mondes du travail – association Loi 1901”
Stephen Bouquin, Denis Blot, Pascal Depoorter, Nathalie Frigul, Alain Maillard.
Global overview of visitors and pages visited
| When | Unique Visitors | Pages visited |
| Today (22/10/2024) | 11 | 16 |
| Yesterday (21/10/2024) | 115 | 349 |
| Last week | 754 | 1 374 |
| Last 30 days | 2 702 | 5 292 |
| Last 60 days | 4 131 | 8 861 |
| Last 90 days | 5 247 | 11 381 |
| Last 12 months | 16 964 | 34 319 |
| This year (Jan 2024-Today) | 15 725 | 32 413 |
| Last year (2023) | 26 523 | 54 935 |
| Total since 2020 | 94 397 | 203 820 |
| Issue and theme of dossier | Coordinators | number of downloads of pdf version (total amount 32,634) |
| N°31 – The future of work: challenges and critique (October 2024) | Marie-Anne Dujarier and Olivier Frayssé, | Paper only |
| N°30 – Labour, collective bargaining and industrial disputes: what recompositions? (September 2023) | Sophie Béroud and Jérôme Pélisse | 794 |
| N°29 – Work and ecology (March 2023) | Alexis Cuckier, David Gaboriau and Vincent Gay | 2,825 |
| N°28 – Varia (July 2022), | collective | 2,196 |
| N°27 – Periphéries, the role of work in the production of space (December 2021), José Caldéron, 2766 | José Caldéron | 2,766 |
| N°26 – Working in pandemic times (June 2021) | Rachid Bouchareb, Nicolas Cianferoni, Nathalie Frigul, Marc Loriol, | 2,983 |
| N°24-25 Automation in question (November 2020) | Stéphen Bouquin | 2156 |
| Hors série – Mobilizations and strikes (February 2020) | Stéphen Bouquin | 3,450 |
| N°23 – Utopias of work (November 2019), | Séverin Muller | 1,386 |
| N°22 – Writing about work (January 2019) | Marc Loriol | 876 |
| N°21 – Racial discriminations at work (May 2018), | Rachid Bouchareb | 898 |
| N°20 – International Trade unionism (October 2017) | Anne Dufresne and Corinne Gobin | 546 |
| N°19 – Work and disabilities (March 2017) | Françoise Piotet | 788 |
| N°18 – Working upon the oceans (September 2016) | Jorge Munoz | 597 |
| N°16-17 – Work and and non-working time (December 2015) | Marc Loriol and Françoise Piotet | 779 |
| N°15 – Varia (April 2015) | collective | 624 |
| N°14 – Geographical mobilities and labour (March 2014) | Alain Maillard | 592 |
| N°13 – Humor at work (June 2013) | Marc Loriol | 1,452 |
| N°12 – Labour and collective action in times of crisis (November 2012) | Jean Vandewattyne, and Mélanie Guyonvarc’h | 1,203 |
| N°11 – Varia (February 2012) | collective | 417 |
| N°9-10- Informality and labour (June 2011) | Stéphen Bouquin and Isabel Georges | 776 |
| N°8 – Social work and care (April 2010) | Pascal Depoorter and Nathalie Frigul | 567 |
| N°7 – Work and migrations (June 2009) | Alain Maillard and Denis Blot | 528 |
| N°6 – Labouring classes, political orientations and militant activism (September 2008) | Stephen Bouquin | 759 |
| n°5 – Miseries and splendors of working in non-profit associations (January 2008) | Mathieu Hély and Maud Simonet | 561 |
| n°3-4 – Work, Labour and social conflits (May 2007) | Pascal Depoorter, Isabelle Farcy, Thomas Rothé | 859 |
| n°2 – Fragmented social temporalities and work (September 2006) | Alain Maillard | 471 |
| n°1 – Labour relations, social rights and trade-unions in SME’s (January 2006) | Stephen Bouquin | 785 |
Sommaire n°31 (parution septembre 2024)
Téléverser le grand entretien et l’introduction au dossier du n°31
1 – Grand entretien
« L’histoire de la prévision du futur du travail est, pour l’essentiel, l’histoire d’experts qui se sont trompés de manière spectaculaire… »
Grand entretien avec Ursula Huws réalisé par Olivier Frayssé
2 – Dossier Le futur du travail : critiques et enjeux
Introduction au dossier
Marie-Anne Dujarier, Olivier Frayssé
Les discours (des) dominants sur le « Futur du travail » : mimétisme, conservatisme et impensés
Marie-Anne Dujarier
Retour vers le « Future of Work » : un débat mondial toujours plus déconnecté des réalités du Sud global
Cédric Leterme
Les fictions utopiques et dystopiques comme discours sur l’avenir du travail
Olivier Frayssé
« Ils n’ont pas introduit les machines pour augmenter les profits, ils l’ont fait pour nous virer » Code 8, les superhéro·ïne·s et l’avenir du travail
Daniel Koechlin
Le discours sur le « futur du travail » comme dispositif managérial. Le cas d’une grande entreprise tertiaire
Scarlett Salman
Le « Future of Work », une ressource discursive stratégique pour les nouveaux intermédiaires du travail
Yannick Fondeur
Automatisation de façade et travail invisibilisé en arrière-boutique: des discours sur le futur du travail aux dynamiques numériques dans les entrepôts logistiques
Mathieu Hocquelet
Discours sur l’avenir du travail dans le secteur de la santé au Royaume-Uni
Louise Dalingwater
3 – Contrechamp
Que sait-on du travail ? Beaucoup trop ! Voir bien peu de choses …
Stéphen Bouquin
Au-delà de la coercition, du consentement et du conflit dans le process de travail
Sarah Nies
De la coercition au consentement dans la théorie du process de travail
Paul Thompson
Notes à propos de l’exploitation illimitée dans les process de travail capitalistes
Heide Gerstenberger
4 – Notes de lecture
Sophie Bernard (2023), UberUsés : Le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal, Paris, PUF, 301p.
(Rachid Bouchareb)
Franck Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel et Emmanuel Renault (s. dir.) (2022), Histoire philosophique du travail, Paris, Vrin (« Histoire de la philosophie »), 408p.
Franck Fischbach et Emmanuel Renault (textes réunis et introduits par) (2022), Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité, Paris, Vrin (« Textes clés »), 372p.
(Etienne Bourel)
Olivier Alexandre (2023), La Tech : Quand la Silicon Valley refait le monde, Éditions du Seuil, 560 p.
(Virgínia Squizani Rodrigues)
Par Stéphen Bouquin
La crise inflationniste de trois dernières années représente un tournant majeur pour des centaines de millions de travailleurs. Dans beaucoup de pays, les salaires ne sont plus ajustés automatiquement à l’inflation. Tant que celle-ci variait de 1,5 à 2,5%, l’érosion du pouvoir d’achat pouvait facilement être contrecarrée par une négociation collective ajustant les salaires à l’évolution du coût de la vie. Dans ce premier article d’une trilogie, je propose d’analyse plus détail l’ampleur de la perte de pouvoir d’achat que représente une hausse inflationniste lorsque celle-ci est non-contrecarrée par des mesures adéquates. Dans le deuxième volet, je présenterai en détail le cas de la Belgique, seul pays qui connaît encore un système d’indexation automatique des salaires. Dans un troisième article, je reviendrai sur l’ampleur de la paupérisation salariale comme phénomène social et les moyens de la combattre en considérant que ce phénomène -– tout comme la précarisation – est ni inéluctable ni irréversible.
1 – Un choc inflationniste inattendu
Au cours de l’année 2022, selon les calculs de l’Institut Syndical Européen (ETUI)[1], les dépenses les plus élémentaires, comme l’énergie, les biens alimentaires, le logement ou les frais de transports, ont augmenté jusqu’à quatre fois plus vite que les salaires. Certes, le salaire horaire moyen a également augmenté de 4,4% mais le taux d’inflation s’élevait à 9,2 % pour l’UE[2].
Les salaires réels, qui fournissent la seule information pertinente sur l’évolution des rémunérations après la prise en compte de l’inflation, ont dès lors subi un recul important dans tous les États membres de l’UE.
Cette situation n’avait rien à voir avec la « stagflation » des années 1970 puisque les bénéfices nets des entreprises ont augmenté et que le taux de marge s’est maintenu à des niveaux élevés dans la plupart des pays. C’est en réponse à cette situation que des économistes ont évoqué la greedflation [3], fondée sur l’existence de surprofits, de rentes monopolistique et d’une hausse des prix liée à la spéculation.
La question des surprofits, de taux de marge qui se sont maintenus à des niveaux élevés malgré la pandémie est loin d’être anodine mais je préfère la traiter ultérieurement dans un autre article spécialement dédié à cet aspect.
Dans ce premier article, je pense indispensable de mettre d’abord la focale sur les effets de la hausse inflationniste des dernières années. Je commencerai par présenter quatre graphiques qui parlent en grande partie pour eux-mêmes. Le premier montre l’évolution de l’inflation moyenne dans l’UE. Le deuxième montre l’inflation cumulée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2023. Le troisième graphique montre l’évolution des salaires réels que je propose d’affiner présentant l’ampleur de la baisse des salaires réels suivant les secteurs d’activités et au niveaux de qualification.
Fig. 1 – Evolution annuelle du taux d’inflation dans l’UE (janvier 1997- juin 2023)
Lecture : La hausse inflationniste se concentre sur la période T4 2021 et T12023.
Fig. 2 – Taux d’inflation cumulée sur la période (T4 2021 et T12023)
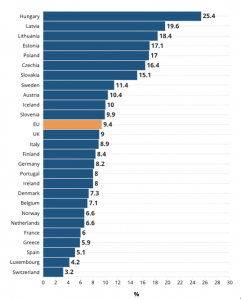
Fig. 3 – Evolution des salaires réels (horaires) du T1-2022 au T1-2023
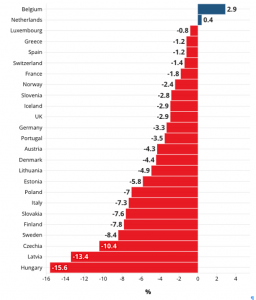
Mais il est probable que le choc inflationniste n’ait pas eu les mêmes effets selon les profils d’emploi (niveau de qualification), les secteurs d’activité (permettant ou non un ajustement des salaires à l’évolution du coût de la vie) ou encore la capacité des organisations syndicales d’imposer par la négociation collective un rattrapage rapide qui bloque en quelque sorte la chute de salaires réels.
Figure 4 – Evolution des salaires horaires réels par secteur d’activité / niveau moyen de rémunération entre T1-2022 et T1-2023
On peut observer que dans certains pays, les secteurs d’activités ont amorti le choc inflationniste différemment. En France, l’indexation automatique du salaire minimum a certainement protégé les bas salaires ou les niveaux de qualification inférieurs. En Espagne, en Allemagne et en Grèce, les bas salaires ont également moins souffert d’une perte du pouvoir d’achat et les salaires réels ont donc été protégés par des ajustements à la hausse des montants.
La tendance globale est néanmoins clairement identifiable : le choc inflationniste s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat et une baisse du « salaire réel » de l’ordre de 4 à 5 % en moyenne avec des reculs plus importants de 7-8 ou 10% dans certains pays. Ces variations sont avant tout le produit de mesures limitant la hausse des prix ou d’une compensation spontanée ou impulsée des salaires.
L’hémorragie du pouvoir d’achat semble avoir été arrêtée en 2023 même si l’Institut syndical européen constate que les salaires réels ont continué à se tasser de 0,8% en moyenne au deuxième trimestre 2023 (par rapport au même trimestre de 2022). [4]
Mais l’inquiétude demeure. Pour la secrétaire générale de la CES, Esther Lynch : « Les syndicats ont obtenu des augmentations salariales indispensables qui ont protégé nos membres des pires effets de la crise du coût de la vie provoquée par les profits des entreprises. Mais il y a trop d’échappatoires qui permettent aux entreprises d’esquiver les négociations collectives. Notre constat est sans appel : deux ans après le début de la crise inflationniste, le pouvoir d’achat des travailleurs n’a toujours pas été correctement rétabli. »[5]
Pour Esther Lynch, cette situation est non seulement à l’origine de la misère de millions de travailleurs et de leurs familles, mais pousse les économies vers une nouvelle récession. « Nous avons désespérément besoin de mettre plus d’argent dans les poches des travailleurs, qui le réinvestissent dans l’économie locale, au lieu de laisser les ultra-riches empiler des milliards sur leurs comptes offshore. À l’approche des prochaines élections européennes, nous demandons à nos 45 millions de membres de voter pour des partis qui donneront aux travailleurs le pouvoir d’obtenir des augmentations de salaire justes et équitables. »
Le ralentissement de l’érosion des salaires réels est avant tout le résultat d’une inflation moindre, passant de 12% en octobre 2022 à 4% vers la fin de l’année 2023. Toutefois, aucun signe invite à croire qu’un mouvement de rattrapage salarial aurait commencé. Même si la BCE et la Commission Européenne évoquent une hausse moyenne des salaires de 5,9 % en 2023 pour la zone euro, cette augmentation est loin de compenser la baisse des salaires réels enregistré au cours de l’année précédente. Pour les économistes du WSI de la Hans Böcklerstiftung, il ne fait aucun doute que sur une base cumulée, de 2021 à 2024, les salaires réels ont enregistré un recul net de 5 à 7%, excepté pour la Belgique, qui apparaît de ce fait comme une « anomalie ». J’y reviendrai dans un deuxième article spécifiquement dédié au système d’indexation automatique belge.
Dans l’immédiat, je pense utile de signaler que même les hautes sphères de la Commission européenne demeurent très prudents quant à l’éventualité d’un rattrapage salarial dans les années à venir. En effet, le rapport Labour Markets and wage development in 2023 (publié début 2024 sous la responsabilité de la DG ‘Emploi et Affaires sociales et inclusion’) constate que « les pertes de salaires réels qui ont été enregistrées depuis la fin de 2021 pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages et continuent à faire des ravages (sic). La détresse financière des travailleurs s’est accrue de manière significative et le taux de privation matérielle et sociale de l’ensemble des travailleurs a augmenté considérablement.» (re-sic). En même temps, le constat est fait que « le choc social provoqué par la crise inflationniste a été moins brutal que les effets provoqués par la crise financière de 2007-2008, notamment grâce à la résilience des marchés de l’emploi et à l’efficacité de la réponse à la crise au niveau de l’UE et au niveau national ». Les rédacteurs du rapport observent plusieurs tendances qui paraissent des plus inquiétantes :
Fig. 5 – Evolution annuelle des salaires nominaux et réels pour la zone euro (2000-2022)
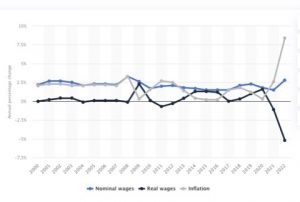
L’Italie est le pays qui incarne le mieux le basculement d’une stagnation à baisse des salaires. Toutefois, la France n’est pas en reste – surtout depuis 2017 – car il apparaît que les salaires réels y subissent une érosion significative que même l’augmentation du Smic, pourtant indexé sur l’inflation, ne semble pas en mesure de contrecarrer.
Fig. 6 – Evolution annuelle du salaire moyen en France (2015-2023). (Salaire Moyen Par Tête – SMPT)

S’il est vrai que les données d’Eurostat, de la BCE, de l’OCDE ou de la Banque Mondiale ne sont pas toujours homogènes, les variations statistiques ne contredisent nullement les traits fondamentaux que nous avons identifié ici. En effet, globalement le diagnostic est le même : après avoir subi une décennie de modération salariale, les années récentes se caractérisent par une baisse des salaires réels, de 4 à 5%, parfois jusqu’à 10 ou 15%. Mais, il faut le souligner également, il existe une pays – la Belgique – où le salariat dans son ensemble échappe à cette tendance lourde.
Certes, « l’anomalie » que représente le cas belge n’est pas de nature à pouvoir inverser la tendance globale, mais son cas révèle qu’il est possible de protéger le pouvoir d’achat tout en préservant une certaine vigueur économique. En effet, l’indexation automatique des salaires et des minima sociaux ne s’est pas traduit par une inflation supérieure ni une baisse de la compétitivité des entreprises mais a plutôt soutenu l’activité économique, ce qui s’est traduit par une croissance du PIB de 1,4% là où les pays tels que l’Allemagne ou la France se trouvent en situation de quasi-récession.
Pour les éditorialistes du Financial Times, sans doute le porte-voix le plus lucide du monde de la finance, il ne fait aucun doute que la compression des salaires et l’érosion du pouvoir d’achat sont des facteurs qui nourrissent l’atonie économique générale initiée par la grande récession de 2008. La « polycrise » – une notion quelque peu évasive qui désigne le caractère systémique de la crise du capitalisme – est donc également et avant tout une crise du modèle néolibéral.
Fig. 7 – Salaires moyens à prix constant et devise locale, indexés sur le niveau de l’année 2000.

De toute évidence, ce modèle néolibéral de croissance propulsé par la mondialisation des échanges et une financiarisation croissante n’est plus à même de générer une croissance (non soutenable au demeurant) ni de garantir une prospérité à de larges secteurs de la population. Ceci est vrai pour les classes laborieuses comme pour certains secteurs des couches moyennes. Bien sûr, les revenus du capital ne s’en tirent pas trop mal – c’est le moins que l’on puisse dire – mais pour les catégories socio-professionnelles qui tirent leurs revenus du travail (à dominance salarié, sinon « indépendant » ou lié à des activités économiques à petite échelle), les temps sont de plus en plus durs. Ce diagnostic mériterait certainement d’être affiné, en intégrant par exemple l’importance du patrimoine immobilier ou des revenus du capital tirés de placements car elles préservent les anciennes et nouvelles générations d’un déclassement vers le « monde d’en bas ».
La tempête inflationniste, même si elle fut passagère – ce qui est loin d’être certain au vu de la crise écologique et des tensions géopolitiques croissantes – a fonctionné comme un accélérateur des inégalités sociales qui sont reflètent, in fine, des inégalités de classe … C’est pourquoi, si jamais il fallait représenter la société visuellement, je commencerai par dessiner une forme qui ne ressemble pas à un losange mais plutôt à une poire dont le haut est en train de grossir tandis que le milieu se contracte et que la moitié inférieure se gonfle tout en s’affaissant …
Pour comprendre le processus de régression sociale actuellement en cours, il ne suffit plus d’évoquer le « déclassement social », un terme fort usité par certains sociologues – de quelle classe vers quelle autre classe sociale ? – ni de se lamenter sur la panne de l’ascenseur social mais commencer par reconnaître que de larges secteurs de la population subissent un processus de «(re)prolétarisation » tant sur le plan objectif que subjectif. Sur le plan objectif car l’accès à la propriété, sans apport de patrimoine, tend à devenir impossible pour de larges secteurs tandis que au niveau de l’emploi, l’insécurité socio-professionnelle augmente. Sur le plan subjectif, cette « involution» correspond effectivement à un sentiment de « déclassement» sauf qu‘il n’est pas toujours facile de comprendre que l’appartenance à la classe moyenne était fondé sur une illusion… En l’absence de mobilisation sociale collective, cette dévolution se traduit forcément par une compétition féroce pour maintenir son rang ou son statut sinon pour tenter de gravir péniblement l’échelle sociale dans une compétition où les perdants sont bien plus nombreux que les gagnants. Le rpocessus de (re)prolétarisation a également pour effet de transformer les interactions sociales à une incessante « lutte des places », avec des orientations sociales qui tendent à devenir de plus en plus utilitaristes, avec des individus-compétiteurs qui adhèrent ou se résignent à jouer le jeu de l’auto-valorisation permanente avec tout la dévalorisation des autres que cela implique.
Forcément, la société des individus en compétition permanente est également source de frustrations et de ressentiments. Pour ces groupes sociaux qui ne comprennent pas pourquoi leur condition est menacée ni comment la dégradation de leur condition sociale pourrait être freinée, il est évident que l’anxiété et l’exaspération doit trouver un exutoire. Cela explique aussi pourquoi les discours «rétropiques » qui agitent l’espoir d’un retour de l’âge d’or de la prospérité fondé sur l’ethnocentrisme et un rejet raciste et classiste des plus vulnérables est en train de gagner une audience de masse.
Si jamais la tonalité de ces propos serait trop idéologique, je conseille vivement la lecture de quelques données objectives comme par exemple l’indice Gini. L’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte de l’ampleur des inégalités sociales (revenus et patrimoine). Variant entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême), les inégalités sont d’autant plus profondes que l’indice de Gini est élevé. Proche de zéro, nous aurions une société très égalitaire (inexistente) ; au-dessus de 0.25 ou 0.30, les inégalités existent mais sont jugulées tandis qu’au-delà de 0.35, la société devient réellement inégalitaire. Dit autrement, les écarts de condition sociale sont de plus en plus profonds et les distances sociales à enjamber de plus en plus grandes.
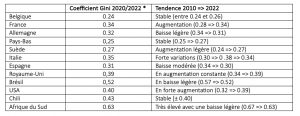
Ce bref aperçu montre plusieurs choses qu’il me semble important de rappeler en ces temps où la démoralisation et le pessimisme l’emportent trop facilement. Primo, il est faux de dire que le « modèle social européen » a vécu. Pour preuve, dans certains pays, les inégalités reculent, notamment grâce au maintien d’amortisseurs sociaux. Secundo, globalement, le modèle social européen résiste plutôt bien aux turbulences (crise financière, récession et pandémie). En même temps, l’état social est « mal fichu » et en situation de détresse financière. Pensons aux soins de santé particulièrement mal en point dans certains pays ; aux services publics sous-financés donnant lieu à une baisse de qualité des services rendus à la population ; à la crise que traverse les systèmes éducatifs ou encore aux manquements des systèmes de protection sociale avec un accès restrictif aux revenus de remplacement très souvent insuffisants face aux besoins réels. Il faudrait mentionner aussi l’ampleur des besoins sociaux insatisfaits que les citoyens ne pourront jamais, avec les faibles revenus ou le travail mal rémunéré auxquels ils ont encore accès, prendre en charge par eux-mêmes : logements insalubres ou hors de prix ; dégradation de la santé après des années de travail, services sociaux spécifiques en termes d’éducation ou de prise en charge humaine des ainés, etc. Le chantier est vaste et je n’en ferais pas l’inventaire ici…
Je terminerai simplement en rappelant que des reculs sociaux, il y a eu auparavant et que rien n’est perdu. C’est pourquoi j’aborderai dans le second volet de cette série la question de la paupérisation salariale et les modes d’y répondre, en plaçant la focale sur quelques pays très différents dont la trajectoire paraît particulièrement riche d’expériences.
(Rome-Paris 29 mai-2 juin 2024)
Annexe : évolution des salaires nominaux et des coûts de la vie pour l’année 2022.
[1] WSI Report No. 86e, July 2023, WSI European Collective Bargaining Report – 2022 / 2023 – Institute of Economic and Social Research (WSI) of the Hans Böckler Foundation
[2] En réalité, la chute du pouvoir d’achat fut encore plus grande lorsqu’on prend en compte l’augmentation des coûts de la vie les plus essentiels. Les données pour tous les États membres de l’UE sont fournies dans le tableau publiée en annexe de cet article.
[3] contraction de « greed » (vénalité) et inflation
[4] https://www.etuc.org/en/document/end-cost-living-crisis-increase-wages-tax-profits
[5] https://www.etuc.org/en/pressrelease/report-pay-still-not-keeping-prices
Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, parle souvent d’un renouveau de l’humanité sur d’autres planètes. Un atelier d’écriture de science-fiction avec des travailleurs d’Amazon s’est organisé autour de l’objectif d’imaginer comment la vie pourrait être différente ici même sur Terre, dans un monde sans les grands patrons comme Bezos.
Par Xenia Benivolski, Max Haiven, Sarah Olutola et Graeme Webb
Les exigences d’Amazon à l’égard de ses 1,5 million d’employés sont tristement célèbre. Les travailleurs des entrepôts doivent suivre une cadence de travail imposé par un management algorithmique mobilisant l’intelligence artificielle (IA) pour maximiser leur rendement, en s’appuyant sur le fonctionnement des robots d’usine. Ceci produit une situation om un régiment de travailleurs, de chauffeurs-livreurs et de sous-traitants de livraison font la course pour atteindre les quotas assignés par le « borg » ou, dit autrement l’automate. A côté de cela, vous avez l’esclavage numérique où les micro-travailleurs rivalisent pour être payés quelques centimes de plus pour des microgigs sur la plateforme Mechanical Turk (MTurk). Même les cols blancs de haut rang font état d’une impitoyable culture d’entreprise où les employés sont astreint à porter le fardeau de la « satisfaction du client ».
De fait, on nage en pleine science-fiction dystopique dans laquelle des conditions de travail de plus en plus insupportables ravagent des pans entiers de classe laborieuse et où un management panoptique écrase leur auto-détermination. Évidemment, tout cela n’a qu’une seule finalité, à savoir la maximisation des profits d’un multimilliardaire dont la richesse est déjà incompréhensiblement illimitée.
Mais le fondateur emblématique d’Amazon, Jeff Bezos, qui en est aujourd’hui le président exécutif, présente son entreprise aux clients et aux actionnaires sous un jour bien différent. Ce geek féru de science-fiction ressemble de plus en plus à un ange exterminateur venu du futur, qui bouleverse des secteurs à faible rentabilité tels que la logistique, pour investir le secteur des soins de santé, des médias tout comme les biens de consommation digne d’une épicerie, des services web à la littérature. Tout ceci nous dit une chose : Amazon incarne une forme de capitalisme qui ne se contente pas d’exploiter les travailleurs dans le présent, mais qui est déterminé à coloniser l’avenir lui-même.
Mais, confrontés à des pressions sur leur lieu de travail, les travailleurs commencent à s’organiser contre l’empire d’Amazon. Aux États-Unis, l’action réussie du syndicat Amazon Labor Union à Staten Island a provoqué une onde de choc et encouragé d’autres initiatives. Entre-temps, d’autres syndicats, comme Amazonians United se concentrent moins sur l’obtention d’une reconnaissance en tant qu’interlocteur que sur le renforcement du pouvoir d’agir des travailleurs à la base. Au Royaume-Uni et en France, plusieurs grèves ont perturbé le fonctionnement d’Amazon. En Allemagne, les efforts déployés par les travailleurs migrants pour organiser des comités d’entreprise indépendants ont permis d’obtenir des résultats concrets. De nouvelles coalitions mondiales, dont Make Amazon Pay, Amazon Workers International et Athena relient les luttes des travailleurs à d’autres luttes dans le monde entier, ainsi qu’à la société civile et aux structures militantes.
Pourtant, trop souvent, nous sommes tellement focalisés sur les luttes immédiates de la classe laborieuse que nous négligeons de poser les grandes questions : quel futur voulons-nous pour toutes celles et ceux qui sont contraints de travailler pour gagner leur vie ? La course spatiale des magnats que sont Richard Branson, Elon Musk et Jeff Bezos reçoit une attention médiatique permanente et révèle l’influence profonde de la science-fiction comme ressource symbolique dans la construction d’une image de marque.
Pour le savoir, nous avons, au cours des derniers mois, développé un projet d’écriture collaborative avec les travailleurs d’Amazon autour de fictions spéculatives sur « le monde après Amazon ». À l’heure actuelle, une quinzaine de travailleurs écrivent des nouvelles de 2 500 mots que nous publierons sur papier et en ligne et qui seront disponible également sous forme de podcast. Nous espérons une diffusion virale, où les travailleurs nouent un dialogue ensemble pour déployer leur potentiel créatif. Chez Amazon et au-delà, il s’agit du droit des travailleurs de reprendre en main leur avenir l’avenir et d’imaginer un horizon différents que celui d’une dystopie devenue réalité.
L’histoire de l’entreprise Amazon
Il y a à peine une génération, la science-fiction était souvent considérée comme une affaire de losers et de ringards qui osaient imaginer que le monde pouvait être différent, ou qui tentaient d’imaginer la fin dystopique du capitalisme. Mais depuis l’aube du nouveau millénaire, le genre est passé des marges de la société au centre de l’imaginaire capitaliste. Il ne s’agit pas seulement de la démultiplication des épopées de science-fiction au cinéma et à la télévision, alimentée par l’imagerie générée numériquement. Il faut bien constater la montée en puissance des entreprises technologiques avec à leur tête des milliardaires qui se glorifient eux-mêmes et qui se considèrent comme des acteurs à part entière de la société ou des héros d’un opéra spatial, bouleversant les conventions au nom de l’avenir radieux de l’humanité.
La course spatiale privée entre Richard Branson, Elon Musk et Jeff Bezos révèle non seulement la richesse obscène que le capitalisme a placée entre les mains de ces visionnaires auto-proclamés, mais aussi l’influence profonde de la science-fiction en tant que genre. C’est à la fois une source d’inspiration personnelle pour eux et une source de relations publiques séduisantes qui insistent sur le fait que ces figures messianiques iront audacieusement là où aucun ploutocrate n’est allé auparavant.
Les biographies et les interviews de Bezos révèlent son amour particulièrement intense pour la science-fiction. Ses collègues font état de sa collection massive de romans SF. On dit avec certitude qu’il a modelé son apparence et son style de leadership sur l’emblématique capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek : The Next Generation, une série qui l’a également amené à envisager d’appeler sa société MakeItSo.com, d’après la phrase d’accroche emblématique du commandant Picard. Bezos est même crédité d’avoir à lui seul sauvé la (fascinante) série de science-fiction The Expanse d’un seul coup de crayon, en ordonnant au Studios Amazon d’acheter les droits et de prolonger la franchise assiégée. Cette décision était d’autant plus ironique que la série mettait l’accent sur la rébellion de la classe laborieuse et sur les méchants chefs d’entreprise.
Au-delà des goûts personnels, la science-fiction a été un élément essentiel de la vision d’entreprise d’Amazon. Bon nombre des inventions les plus célèbres d’Amazon, de la reconnaissance vocale Alexa à ses entrepôts robotisés, s’inspirent de thèmes directement tirés de livres de science-fiction et de la télévision. Le slogan « have fun, work hard, make history » (s’amusez-vous, travaillez dur et écrivez l’histoire), qui figure sur les murs de la quasi-totalité des installations d’Amazon, témoigne de sa priorité optimiste à transformer le monde, même si la grande majorité des travailleurs ne connaîtront jamais que la partie où ils travaillent dur. La rhétorique futuriste, qui a émaillé la célèbre lettre annuelle de Bezos aux actionnaires alors qu’il était encore PDG de l’entreprise, a contribué au succès d’Amazon auprès des investisseurs. Cette richesse a été utilisée pour financer le fantasme techno-utopique d’un milliardaire qui se voyait comme le « grand perturbateur » et le pionnier de l’avenir.
Ce qui est en jeu, c’est une sorte de storytelling d’entreprise, qui va au-delà de la propagande grossière et s’efforce d’exploiter l’imagination. Comme tant d’autres entreprises, Amazon se présente comme surfant sur la vague de l’avenir, répondant à la force implacable et positive du marché capitaliste par l’innovation et l’optimisme. De telles histoires exonèrent proprement l’entreprise et ses bénéficiaires des conséquences de leurs choix pour les travailleurs et leur monde.
Ils s’appuient sur un récit dominant qui insiste sur le fait que la « technologie » et les « marchés » sont des forces neutres et imparables. Ces histoires soigneusement entretenues ont également alimenté le second rêve de Bezos de propulser audacieusement l’humanité dans les étoiles, laissant derrière soi la planète Terre comme une sorte de musée vivant ou de réserve naturelle. Bezos, ses acolytes comme ses rivaux se présentent comme des visionnaires incompris, appelés par la science et le progrès à investir les richesses que le marché bienveillant leur a accordées dans des projets lunaires qui défient les priorités terrestres (comme, par exemple, payer un salaire décent aux travailleurs).
Les rêves utopiques de ploutocrates comme Bezos reposent sur une dystopie pour les travailleurs – et pour le monde qu’il entend laisser derrière lui sur les ruines de la Terre.
Lors de la presse conférence de tenue après son voyage de 2021 vers une orbite proche à bord de la fusée de sa société privée Blue Origin, Bezos a remué le couteau dans la plaie en remerciant du fond du cœur « chaque employé d’Amazon et chaque client d’Amazon » en rajoutant sur le ton de la plaisanterie « C’est vous qui avez payé pour tout cela ».
La suggestion ne pourrait être plus claire : les rêves utopiques des ploutocrates comme Bezos reposent sur une dystopie pour les travailleurs et pour le monde qu’il entend laisser derrière lui sur les ruines de la Terre. Quel sera l’avenir des travailleurs qui ont produit leur richesse ? Aurons-nous notre mot à dire pour façonner l’avenir ? Ou sommes-nous destinés à nous battre pour les ressources d’une Terre détruite ou à extraire des astéroïdes pour alimenter des empires galactiques ? Comment pouvons-nous récupérer le pouvoir de l’imagination de la science-fiction pour la classe laborieuse ?
Science-fiction prolétarienne
Au XIXème siècle, les fondateurs de la fiction spéculative, comme Mary Shelley, Jules Verne et H. G. Wells, appartenaient souvent à l’intéllentsia bourgeoise ou à la classe moyenne. Pourtant, ils ont été profondément inspirés et façonnés par cette période de la lutte des classe. Le conte de Frankenstein, qui met en garde contre l’emballement de la science, a par exemple été influencé par les soulèvements luddites contre les machines dans l’Angleterre natale de Shelley, alors que la classe laborieuse de ce pays commençait à prendre conscience de son identité collective et de son rôle historique.
Metropolis de Fritz Lang, l’un des premiers films de science-fiction, tourne autour d’un soulèvement ouvrier et d’une libération par les machines. En Union soviétique, la science-fiction a été développée comme un genre approprié (bien que potentiellement subversif) pour refléter le potentiel de libération des travailleurs de la modernité sous le socialisme d’État. De l’autre côté du rideau de fer, les écrivains occidentaux se sont tournés tout au long du XXème siècle vers la science-fiction comme moyen d’explorer d’autres mondes pour les travailleurs au-delà de l’opposition binaire Est/Ouest, notamment des romancières féministes comme Marge Piercy, Octavia Butler et Ursula K. Le Guin. À la fin du siècle, des théoriciens de la littérature critique comme Fredric Jameson et Darko Suvin ont noté que, loin d’être une simple distraction abrutissante et commercialisée, le genre offrait un point de vue unique sur le monde capitaliste.
 Dans la plupart des cas, c’est l’écrivain, en tant que travailleur spécialisé, qui se voit attribuer le monopole de l’imagination, chargé d’imaginer un monde que lectorat va découvrir. Cependant, l’avenir étant de plus en plus accaparé par le capital, les organisateurs de mouvements sociaux ont constaté que l’écriture de fictions spéculatives était aussi un moyen d’améliorer les conditions de vie de la population dans le sens où elle a cette capacité à surmonter les impasses de l’imagination, un monde après le capitalisme, ou dans ce cas-ci un monde après Amazon.
Dans la plupart des cas, c’est l’écrivain, en tant que travailleur spécialisé, qui se voit attribuer le monopole de l’imagination, chargé d’imaginer un monde que lectorat va découvrir. Cependant, l’avenir étant de plus en plus accaparé par le capital, les organisateurs de mouvements sociaux ont constaté que l’écriture de fictions spéculatives était aussi un moyen d’améliorer les conditions de vie de la population dans le sens où elle a cette capacité à surmonter les impasses de l’imagination, un monde après le capitalisme, ou dans ce cas-ci un monde après Amazon.
Parmi ces efforts, les plus célèbres sont ceux d’Adrienne Maree Brown et de Walidah Imarisha. Octavia’s Brood d’Adrienne Maree Brown et Walidah Imarisha, une série coéditée de nouvelles écrites par des community organizers (des activités de comités de quartier ou de mobilisations sociales). Inspirées par Octavia Butler, qui a donné son nom au livre, les nouvelles ont été créées à partir d’histoires développées lors d’une série d’ateliers organisés par les éditeurs à l’occasion de la conférence des médias alternatifs à Détroit. Pour les éditeurs, l’organisation des personnes exploitées et opprimées est déjà une forme de fiction spéculative:
Lorsque nous parlons d’un monde sans prison, d’un monde sans violence policière, d’un monde où tout le monde a de la nourriture, des vêtements, un abri, une éducation de qualité, d’un monde sans suprématie blanche, sans patriarcat, sans capitalisme, sans hétéro-sexisme, nous parlons d’’un monde qui n’existe pas à l’heure actuelle. Mais rêver collectivement d’un monde qui n’existe pas encore signifie que nous pouvons commencer à le construire.
Pour Brown et Imashira, reprendre le pouvoir d’envisager d’autres avenirs est, en soi, une forme d’organisation communautaire. Dans un monde capitaliste qui marchandise la culture et le divertissement, le fait de réunir des gens pour écrire et partager leurs écrits n’est pas seulement digne, mais souligne également que la forme de la société est trop importante pour être laissée aux politiciens et aux entreprises. C’est particulièrement vrai pour les groupes qui, historiquement et aujourd’hui, ont été exclus de tout droit de regard sur leur avenir ou celui de la société, notamment les femmes et les personnes racialisées et issues de la classe ouvrière.
Une politique similaire visant à amplifier les voix de la marge a également inspiré l’école d’écriture ouvrière (Worker Writers School ou WWS) qui rassemble des travailleurs (principalement, mais pas exclusivement, à New York) et les aide à écrire des haïkus (petits poèmes) qui ont été publiés sous forme de recueils. Pour le poète Mark Nowak, qui est à l’origine du projet, encourager l’écriture ouvrière ne consiste pas seulement à célébrer les piquets de grève ou s’imaginer faire la révolution. Il s’agit aussi de réfléchir aux éléments banals de la vie prolétarienne, aux petits actes de solidarité, aux luttes des travailleurs dans le domaine du care et de la reproduction sociale : le foyer, la famille, la communauté.
WWS ne se concentre pas que sur la science-fiction et montre le pouvoir radical de l’imagination qui se manifeste lorsque les travailleurs ne se contentent pas de lire des mots inspirants, mais se réunissent pour écrire et ainsi reprendre en main le pouvoir de construire le monde et l’avenir. Il ne s’agit pas de trouver un succès commercial ou littéraire individuel, mais de retrouver une dignité et une capacité de s’imaginer un changement social et une lutte commune.
Nous avons vu comment des entreprises comme Amazon illustrent amplement le pouvoir de la narration capitaliste dans l’idiome de la science-fiction. Reste à savoir comment les travailleurs peuvent-ils réclamer et réinventer cette capacité imaginaire ?
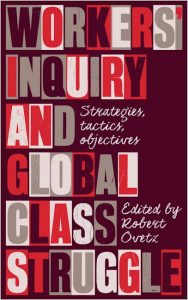 Renouer avec la méthodologie de l’enquête ouvrière
Renouer avec la méthodologie de l’enquête ouvrière
Les initiatives que nous avons mentionnées sont importantes, mais elles ne sont pas les premières du genre. Au XIXème siècle, Karl Marx et Friedrich Engels ont encouragé leurs collègues communistes à envoyer des questionnaires aux travailleurs pour connaître, depuis l’atelier, la réalité des travailleurs sur le lieu de production. Il ne s’agissait pas seulement pour les intellectuels de découvrir les principales luttes et tensions auxquelles les travailleurs étaient confrontés. Dans un monde capitaliste qui marchandise la culture, le fait de réunir des gens pour écrire n’est pas seulement une source de fierté et de dignité, mais souligne également que la forme d’écriture à propos de la société est trop importante pour être laissée aux politiciens, aux entreprises ou aux intellectuels dotés d’un capital culturel.
Dans les années 1950 et 1960, des syndicalistes dissidents de Detroit, luttant contre le conservatisme et la complaisance des syndicats envers le racisme mobilisé par les entreprises pour diviser les travailleurs ont relancé cette méthode d’enquête sur les travailleurs. Ils ont créé des espaces pour publier les commentaires des travailleurs sur leur expérience quotidienne de l’exploitation et de l’organisation du travail, qui étaient autrement rendus invisibles, même par les publications syndicales traditionnelles. Ces témoignages des travailleurs de la ville de Détroit également appelée Motor City ont également fait leur chemin jusqu’en Italie.
Ces écrits ont catalysé une nouvelle vague de radicalisme parmi les intellectuels et les travailleurs, qui s’efforçaient de faire face aux développements industriels sismiques de villes comme Turin et aux nouvelles formes de militantisme ouvrier qui émergeaient dans les ateliers. Au-delà du contrôle ou de l’influence du parti communiste italien ou de ses responsables syndicaux, les organisateurs ont encouragé les travailleurs à étudier, à discuter et à écrire sur leurs luttes, afin d’honorer et de reconnaître les travailleurs en tant qu’intellectuels et d’établir de nouvelles relations de solidarité à la base.
L’enjeu de toutes ces approches sur l’enquête ouvrière est la conviction que les travailleurs de base, dont les corps et les esprits sont exploités par le capital, peuvent avoir accès à des connaissances sur le capitalisme qui dépassent même les plus brillants théoriciens ou les analyses sociologiques du capitalisme. En aidant les travailleurs à se réapproprier le pouvoir de raconter et d’analyser leurs histoires, de réfléchir à leurs vies et à leurs luttes, un espace est créé où de nouvelles perspectives radicales peuvent émerger. Cela est particulièrement vrai dans les moments où le capitalisme se transforme rapidement et radicalement, comme ce fut le cas à Détroit ou à Turin dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Lorsqu’elles sont révélées, ces idées peuvent aider les travailleurs à surmonter les limites des formes de lutte traditionnelles. Elles permettent aux travailleurs de mieux reconnaître la capacité d’adaptation du capitalisme – et de voir qu’ils changent également en réponse à ce dernier ou en le rejetant. Facilité par le partage en ligne des technologies, ce potentiel n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. L’enquête ouvrière a pour objectif de fournir les outils qui permettront à la classe ouvrière de se voir se transformer.
Cette approche peut-elle servir de catalyseur à une nouvelle génération afin qu’elle développe ses propres formes de lutte – en utilisant à la fois des techniques traditionnelles et innovantes ?
Au-delà de la dystopie capitaliste
Notre projet Worker as a futurist (le travailleur comme penseur du futur) redonne la capacité d’une pensée spéculative aux travailleurs, au nom de la compréhension de quelque chose de nouveau sur le capitalisme et de la lutte pour quelque chose de différent. Nous avons mobilisé ces travailleurs pour qu’ils imaginent au travers de l’écriture leur propre avenir, face aux imaginaires cultivés par Amazon qui voient les techno-dominateurs dominer le monde et les étoiles.
Grâce au financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, notre équipe d’universitaires, d’enseignants, d’écrivains et d’activistes a pu payer des travailleurs d’Amazon (magasiniers, chauffeurs, rédacteurs, travailleurs MTurk, etc.) pour participer à une série d’ateliers d’écriture et de séances d’information visant à renforcer les compétences.
Dans chacun de ces forums en ligne, nous avons été rejoints par des experts de la science fiction, d’Amazon et des luttes des travailleurs. À la fin de cette série de sessions, les participants ont été encouragés à rédiger les histoires qu’ils voulaient raconter sur « Le monde après Amazon ». Ce projet est soutenu par un podcast basé sur des interviews de militants syndicaux, d’artistes, d’auteurs et de penseurs qui contestent le monde qu’Amazon est en train de construire et se battent pour des avenirs différents.
Le projet Worker as Futurist vise à créer un espace et à partager du temps libre pour que les travailleurs puissent exercer et échanger à propos de leurs mondes imaginatifs. L’enjeu n’est pas seulement la dignité des travailleurs en tant qu’âmes créatives et expressives, mais aussi l’avenir que nous construirons collectivement.
Nous devons envisager l’avenir que nous voulons afin de nous mobiliser et de nous battre ensemble pour lui, plutôt que de céder cet avenir à ceux qui voudraient faire des étoiles leur propre bac à sable. C’est dans le processus d’écriture et de partage de l’écriture que nous pouvons prendre conscience de quelque chose que nos corps de travailleurs savent mais que nous ne pouvons pas articuler ou exprimer autrement. Le travailleur de base – cible de l’exploitation quotidienne, forcé de construire l’utopie de son patron – peut avoir crypté en lui la clé qui lui permettra de détruire son monde et d’en construire un nouveau.
Article publié par Jacobin
traduction de l’anglais par S. Bouquin
par Salvo Leonardi
Depuis quelque temps, le syndicalisme étatsunien est en pleine effervescence. Il est plein d’énergie et d’optimisme. Après des décennies de revers, de défaites et de déceptions, le monde du travail aux États-Unis semble avoir emprunté une autre voie, modifiant le registre idéologique et les pratiques organisationnelles de l’ancien syndicalisme d’entreprise, appelé business unionism et très accommodant avec les directions d’entreprise, pour passer à l’offensive. Cela se fait sur la base d’une réorientation tactique et stratégique qui, depuis quelques années, est au centre de l’action syndicale, sous la bannière d’un syndicalisme de mobilisation sociale (movement unionism), bien plus combatif en organisé par en-bas, dont nous avons nous déjà eu des échos, par exemple dans le domaine de l’organizing et du renouveau syndical, comme celui initiée par la fédération SEIU [1] qui a formé d’abord la coalition Change to win, qui s’est réorganisé ensuite comme Strategic Organizing Centre regroupant de quatre fédérations syndicales de secteur[2].
UNE NOUVELLE PHASE
L’année 2023 marque un tournant avec plus d’un demi-million de travailleurs américains qui se sont mis en grève, obtenant des augmentations de salaire de 6 à 7% en moyenne. Les récentes victoires retentissantes contre les trois géants de l’automobile (Ford, General Motors et Stellantis) – suivi par la reconnaissance syndicale dans l’usine de Volkswagen à Chattanooga, Tennessee et qui se prolongera très probablement par des percées équivalentes chez Daimler-Mercedes et Toyota, reflète la combativité croissantes des travailleurs des états du Sud qui sont restés pendant longtemps marqués par une culture antisyndicale et des divisions raciales. Citons aussi la paralysie imposée par les acteurs et les scénaristes, jusqu’à la victoire, dans le monde d’Hollywood contre l’application de l’intelligence artificielle ; la syndicalisation de 10 000 salariés employés dans les 400 cafés Starbucks ; la reconnaissance syndicale obtenue par les travailleurs d’Amazon de Staten Island (New York) ainsi que celle des chauffeurs d’UPS dans plusieurs états ; l’augmentation de 25 % des salaires dans la restauration rapide en Californie ; les nombreuses victoires parmi les enseignants et le personnel de soins, sont la démonstration de ce changement d’époque en faveur du monde du travail.
Ce retour en force du syndicalisme trouve son origine dans l’action soutenue menée par le réseau de militants syndicaux initié par le journal mensuel de Labor Notes. Né en 1979, à l’initiative d’un groupe de militants syndicaux et de la gauche radicale socialiste, Labor Notes a poursuivi inlassablement pendant plus de quatre décennies un travail d’éducation populaire, de formation aux « bonnes pratiques militantes », tout en jouant un rôle informatif de premier plan en faisant circuler les comptes-rendus des luttes et des mobilisations, tant au niveau de secteurs que des entreprises, l’action communautaire autour des workers centres, et publiant plusieurs manuels sur le bon syndicaliste « trublion » (si l’on veut traduire troublemaker) et sur les secrets de l’organisateur – disons du militant syndical – qui sait gagner des adhésions et mobiliser collectivement ses collègues de travail, par-delà les clivages raciaux, de genre, de qualification, de statut ou générationnels.
Au cours de la conférence de Labor Notes, ce travail d’éducatif a reçu l’appui manifeste de l’actuel président du puissant syndicat de l’automobile (United Automobile Workers), Shawn Fain, pour qui le Troublemakers Handbook n’est rien de moins que sa « bible » syndicale, qui l’a inspiré dans le combat interne pour le renouveau radical avec lequel il a d’abord gravi les échelons de l’organisation, et qui l’a ensuite guidé – au cours des deux dernières années – vers des objectifs qui auraient semblé impensables ou irréalistes jusqu’alors.
LE RÔLE DE LABOR NOTES
Mais Labor Notes, c’est aussi une conférence organisée tous les deux ans, en croissance continue et exponentielle d’une édition à l’autre, qui, du 19 au 21 avril dernier, a vu converger dans un des plus grands hôtels de Chicago jusqu’à 4 700 délégués de base et responsables syndicaux de tous les Etats-Unis, mais aussi de divers pays, dont certains d’Italie – de la Fédération des métallurgistes (FIOM) et de la Fondation Giuseppe di Vittorio [3]– pour discuter et échanger des expériences au cours de plus de 300 ateliers à propos d’une grande variété de thèmes syndicaux et de l’importance cruciale de réinvestir les relations collectives de travail (industrial relations) de manière combative afin d’obtenir à nouveau des victoires. Cette conférence ne fut ni un congrès ni une sorte de forum mais forme un cadre d’échanges et de formation extrêmement intéressant, en raison de son caractère pragmatique et opérationnel, horizontal et décentralisé, visant à partager au maximum les expériences et à comparer les pratiques de lutte menées, pour la plupart, dans des unités de production fragmentées, mais en concentrant tous les efforts à la recherche des pratiques les plus efficaces et les plus fructueuses.
La figure de ce syndicalisme d’en-bas – grassroots et rank-and-file, selon un lexique anglo-saxon que nous ne connaissons pas – réside dans le lien qui peut être construit entre l’organisation d’une part – en élargissant sa capacité à représenter les non-organisés – et le conflit assumé et la négociation collective d’autre part. L’objectif étant d’obtenir des d’avancées sociales concrètes, que ce soit en matière de salaires ou de conditions générales de travail et de vie.
EXPÉRIENCES CONCRÈTES
La conférence fut un véritable moment de foisonnement, avec des exposés de militants de base, des chercheurs, des responsables de structure et surtout beaucoup d’expériences concrètes à raconter et à transmettre, à « réseauter » pour établir des contacts. Avec seulement quelques séances plénières, au début et à la fin, et surtout un programme très dense qui s’est prolongé jusque tard dans la soirée, avec des moments de détente et de divertissement, musical ou théâtral, le tout dans une atmosphère de grande solidarité, d’effervescence qui fut rendue possible par l’extraordinaire présence de jeunes travailleurs. La génération qui s’engage dans le combat syndical est composé par les filles et les fils de cette « autre Amérique », coloré et combative, pleine d’optimisme et qui est aujourd’hui puissamment revenue sur la scène politique et médiatique internationale, grâce aux mobilisations pro-palestiniennes sur les campus universitaires. Le keffieh était à Chicago un symbole dominant, porté sur les T-shirts et sweatshirts de leur organisation, qu’ils soient du syndicat de l’automobile, les chauffeurs de poids lourds (les biens connus Teamsters), les enseignants ou personnel infirmier, hôtesses de l’air, employés d’Amazon, d’UPS ou encore de Starbucks.
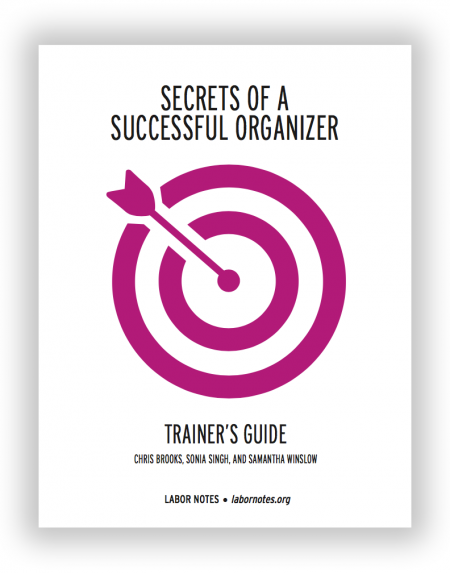 « Comment surmonter l’apathie de ses collègues ? », « Comment organiser un piquet de grève ? », « Comment reconnaître les leaders syndicaux potentiels sur le lieu de travail et comment les gagner au combat syndical ? »… Ce ne sont là que quelques-uns des titres des nombreux ateliers dans lesquels chaque participant pouvait intervenir tout en écoutant les autres. On a beaucoup chanté dans les couloirs de l’hôtel Hyatt, on s’est parfois donné des accolades, des embrassades, et à certains moments, on avait l’impression d’assister à des moments de prise de conscience collective, comme lors de la discussion sur « que faire lorsque votre syndicat vous brise le cœur » ou lorsque votre délégué vous laisse tomber et n’est pas à la hauteur de la tâche. Mais il fut question d’histoire, comme dans l’atelier consacré à la figure légendaire de Walter Reuther, leader de l’UAW pendant trente glorieuses années, de 1946 à 1970.
« Comment surmonter l’apathie de ses collègues ? », « Comment organiser un piquet de grève ? », « Comment reconnaître les leaders syndicaux potentiels sur le lieu de travail et comment les gagner au combat syndical ? »… Ce ne sont là que quelques-uns des titres des nombreux ateliers dans lesquels chaque participant pouvait intervenir tout en écoutant les autres. On a beaucoup chanté dans les couloirs de l’hôtel Hyatt, on s’est parfois donné des accolades, des embrassades, et à certains moments, on avait l’impression d’assister à des moments de prise de conscience collective, comme lors de la discussion sur « que faire lorsque votre syndicat vous brise le cœur » ou lorsque votre délégué vous laisse tomber et n’est pas à la hauteur de la tâche. Mais il fut question d’histoire, comme dans l’atelier consacré à la figure légendaire de Walter Reuther, leader de l’UAW pendant trente glorieuses années, de 1946 à 1970.
UN GRAND ABSENT : LA POLITIQUE
Ce qui était frappant, en revanche, c’était l’absence presque totale d’intervention ou de revendications politiques, tant en ce qui concerne l’actuel président Joe Biden – qui s’était proclamé comme le plus pro-syndical depuis l’époque de Lyndon Johnson dans les années 1960 et qui a effectivement manifesté sa proximité avec les travailleurs de l’automobile pendant leur grève de trois semaines – qu’en ce qui concerne le risque, perçu à juste titre comme catastrophique, d’une victoire de Donald Trump. La politique, au sens classique du terme, a tout simplement été la grande absente de ces trois jours à Chicago. La raison en est probablement à chercher dans l’idée – assez typique pour les États-Unis – que les travailleurs et leurs représentants syndicaux, doivent avant tout être capables de se débrouiller tout seuls, d’affronter les directions d’entreprises et de chercher des solutions à leurs problèmes sans placer trop d’espoirs dans les choix des gouvernements « amis », ni de détourner les forces et les énergies dans un affrontement forcément inégal avec des exécutifs hostiles. La nature structurellement décentralisée de l’État (ainsi que du syndicalisme et des relations industrielles nord-américaines) dans laquelle l’action collective a toujours été confrontée à une lourdeur délibérée des procédures d’accès à la représentation sur le lieu de travail et – surtout – à l’hostilité virulente des patrons à l’égard de l’implantation syndicale et de la grève, y a évidemment contribué.
Dans de nombreux États, au nom d’un « droit au travail » mal compris (et légalement validé), les employeurs peuvent tout faire pour briser les grèves et refuser les demandes de reconnaissance syndicale ou de représentation, y compris en ayant un recours systématique à des briseurs de grève. Les employeurs sont dès lors la première et véritable cible de l’action syndicale et c’est seulement en second lieu que la puissance publique est interpellée, avec peut-être une exception du côté des enseignants et du personnel hospitalier. Globalement, ce retour du syndicalisme réussit d’autant plus qu’il arrive à transcender les clivages et à articuler une dimension intersectionnelle de classe, de genre et de race (selon leur lexique).

SE MOBILISER POUR GAGNER
L’enquête ouvrière, la confrontation des expériences de mobilisation et la discussion sur les objectifs à atteindre ne sont jamais dilués ou dispersés en mille ruisseaux mais sont, comme on ils le disent eux-mêmes « focalisés » sur objectifs concrets que le mouvement syndical peut réaliser en construisant un rapport de force à partir de la base. Cette approche pragmatique n’est pas si nouvelle, puisqu’on la retrouve à l’époque où John Commons, Selig Perlman, Samuel Gompers et Walter Reuther avaient défini les grandes orientations de l’AFL-CIO et qui se distinguait de l’approche syndicale européenne, traditionnellement sceptique à l’égard d’un syndicalisme centré uniquement sur les questions matérielles (bread and butter, les questions de beurre et de pain) et très peu marqué idéologiquement[4].
Aujourd’hui, cette approche « volontariste » qui consiste à initier la négociation collective dans un objectif réaliste et concret est ravivée à une sauce radicale et s’éloigne des incrustations hyper-bureaucratiques et pseudo-participatives que nous avions appris à connaître à l’époque où Sergio Marchionne, patron italien de la Fiat-Chrysler, en vantait les vertus et la valeur exemplaire à Détroit.
Une partie de l’ancienne direction syndicale de l’UAW – il faut peut-être le rappeler ici en passant – a connu une fin pitoyable, et poursuivie par des scandales et des condamnations diverses, pour avoir échangé des concessions sur la peau des travailleurs pour leur profit personnel.
UN HORIZON D’ESPOIR
Aujourd’hui, l’UAW renoue avec des combats victorieux, et ce de manière éclatante, qui peut offrir un modèle syndical pour les autres secteurs. Ce syndicalisme est aussi, de manière décisive, une source d’espoir. L’UAW a organisé trois semaines de grèves en crescendo, avec des caisses de grève couvrant 500 dollars par semaine pour chaque gréviste – mais est-ce que quand réfléchirons-nous à cet outil utilisé dans tant de pays autrefois? – à obtenir 25% d’augmentations salariale chez les trois constructeurs, étalés en quatre ans et demi (+11% immédiatement) ; la réintroduction de l’échelle mobile des salaires (le fameux “COLA” : Cost-Of-Living-Adjustment) une amélioration des conditions de travail ; la fin du système dualiste two tier (basé sur une double grille de salaire essentiellement basé sur l’ancienneté) ; l’augmentation du salaire horaire d’embauche qui passe de 16,25 $ à 22,50 $/heure ; voire, enfin, le remboursement de 110 $ par jour, perdus lors des piquets de grève. La convention collective fut adopté à une large majorité dans toutes les usines des trois constructeurs. Les victoires, dans les mobilisations syndicales, sont d’une importance fondamentale et surtout, elles sont contagieuses. « Nous avons enfin mis fin à 40 ans de concessions et de reculs. C’est la meilleure convention de toute ma vie », témoigne un cadre syndical déjà âgé de la General Motors.
Le succès contre les trois géants de l’industrie automobile a déclenché une réaction en chaîne. Le vendredi 19 avril, en pleine séance plénière, la nouvelle de reconnaissance syndicale chez Volkswagen à Chattanooga a été accueillie par des cris de victoire dans l’auditorium ; et pour cause… Avec 70 % de voix en faveur de l’adhésion du syndicat sur les 4 300 employés de l’usine, l’UAW a enfin un pied dans l’entreprise qui fut pendant longtemps un exemple d’un management sans interlocuteur avec des travailleurs sans représentation. Le prochain objectif est maintenant d’obtenir le même résultat chez Mercedes à Vance, dans l’Alabama. Il est frappant de constater que les géants allemands de l’automobile, champions de la concertation sociale dans leur pays et en Europe, viennent dans les états du Sud des États-Unis chercher des conditions de non-représentation syndicale typique des pays du sud global.
À CHICAGO ET DANS LE MONDE ENTIER
A Chicago, il y avait de nombreux représentants et de de délégations syndicales de différents pays ; évidemment du Mexique – avec une cinquantaine d’ateliers étaient uniquement en espagnol, notamment en raison de la forte présence de travailleurs latinos –, mais aussi du Japon, de la Corée du Sud et de l’Europe. Citons notamment United du Royaume-Uni, Yanira Wolf, la secrétaire générale de Ver.di d’Allemagne, ainsi que divers représentants d’IG Metal, de la Fondation Rosa Luxemburg, l’IF-Metall suédois, notamment pour rendre compte de la grève chez Tesla (saviez-vous que ce syndicat dispose d’une caisse de grève d’un milliard et demi d’euros ?), la CGT de France, la CGIL d’Italie avec une délégation de la Fiom (fédération des métallurgistes) et moi-même, pour la Fondation De Vittorio de la CGIL, pour intervenir compte dans un atelier international d’une série d’expériences réalisées au cours de ces dernières années.
Les propos tenus par notre camarade Michele De Palma, lors de la dernière plénière du dimanche matin ont suscité beaucoup d’intérêt, voire d’enthousiasme, avant que la star de cet événement, Shawn Fain, clôture la conférence. Son accession à la présidence de l’UAW, il y a deux ans, a été rendue possible par la mobilisation d’une tendance radicale et critique des anciennes méthodes de direction. En effet, le courant Unite All Workers for Democracy (UAWD) rejetait en bloc toute la dérive bureaucratique et accommodante, en défendant un militantisme et une démocratie interne, par le bas, combinée à une stratégie offensive, et qui sont devenues les lignes directrices d’un redressement syndical qui n’a pas tardé à produire ses fruits, à commencer par la convention collective déjà évoqué contre les trois géants de l’automobile.
LA FORCE DE SHAWN FAIN
La posture et les discours de Shawn Fain sont un hommage vivant à la classe laborieuse et aux gens ordinaires. Dans ses interventions, il prononce des phrases d’une grande clarté, qui réchauffent le cœur et suscitent un enthousiasme contagieux. « Nous sommes ici pour mettre fin au syndicalisme d’entreprise, aux concessions sans fin, à la corruption syndicale et pour briser les chaînes qui nous ont emprisonnés. J’ai dit à maintes reprises que la négociation de bonnes conventions nous porte vers d’autres victoires et des succès, y compris sur le plan organisationnel. Ces deux choses vont de pair. De ce point de vue, notre grève de septembre n’était pas seulement dirigée contre les trois géants de l’automobile. Elle était la grève de l’ensemble de la classe laborieuse, du monde du travail. Et c’est la preuve d’une chose : la classe des travailleurs peut gagner. Elle peut changer le monde. Nous ne gagnerons jamais en jouant sur un mode défensif ou en nous contentant de réagir aux événements. Nous ne gagnerons jamais en jouant les bons élèves biens gentils avec les patrons. Nous ne gagnerons jamais en disant à nos membres ce qu’il faut faire, ce qu’ils doivent dire ou penser. Nous gagnerons en donnant aux travailleurs les outils, l’inspiration et le courage de se défendre. De ce point de vue, je pense que la classe des travailleurs est en quelque sorte l’arsenal de la démocratie et que les travailleurs en lutte sont les « libérateurs ».
Shawn Fain a reçu une ovation de la salle entière qui, debout, a entonné des chants en chœurs à l’issue de ce discours aussi sincère que combatif. Pour couronner le tout, Fain a proposé que l’ensemble des syndicats fassent expirer leurs conventions collectives le 30 avril 2028, date à laquelle la convention collective avec les trois grands de l’automobile tombe à échéance, afin que le 1er mai 2028 devienne un jour de grève générale unitaire, menée partout dans l’ensemble du pays.
LE RISQUE TRUMP
Certes, pour l’instant, les données sur le taux de syndicalisation n’indiquent pas de variations significatives, et gravitent autour de ce modeste 12% – en grande partie grâce à la forte contribution des employés publics (syndiqués à 33%) – et il pourrait y avoir de sérieuses répercussions si une élection de Trump devait se traduire par une recomposition pro-patronale du crucial Industrial Relation National Labor Relation Board. En effet, cette institution fédérale préside à l’admission des bulletins de vote permettant de reconnaître le syndicat sur le lieu de travail lors d’une consultation des travailleurs ; en vérifiant également la régularité des suffrages et des décomptes. Mais pour l’heure, le public de militants syndicaux ardents et enthousiastes savoure ce moment de succès inespéré, après les nombreuses, trop nombreuses années d’amertume du passé.
Il y avait un beau soleil à Chicago, à l’extérieur de l’hôtel Hyatt, parmi les parterres de fleurs des nombreux parcs de cette ville impressionnante. Nous verrons si c’est le signe annonciateur d’un nouveau printemps durable pour le mouvement syndical américain. Dans l’espoir que ses récentes réalisations s’expriment et se répercutent également chez nous. Pour le travail militant et les luttes qui nous attendent. Mais ici, à Chicago, nous avons découvert des modalités de mobilisation et de rassemblement, qui en termes de format organisationnel et, surtout, en termes de contenu, ne seraient pas inutiles d’être examinées de près, selon le meilleur esprit de comparaison et d’apprentissage mutuel et émulatif.
Salvo Leonardi, Fondation Di Vittorio – CGIL
article publié par Collectivo; traduit de l’italien par Stéphen Bouquin
[1] SEIU (Service Employees International Union) ou Union Internationale des Employés des Services est un syndicat nord-américain représentant 2,2 millions de travailleurs exerçant plus de 100 professions différentes aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
[2] Change to win est une centrale syndicale américaine formée en 2005 par des syndicats dissidents de l’American Federation of Labour – Congress of Industrial Organisations dont l’Union internationale des employés des services et les International Brotherhood of Teamsters. Le syndicat des travailleurs de l’automobile est resté affilié à la confédération AFL-CIO mais s’est élargi à d’autres secteurs comme par exemple les travailleurs du monde universitaire.
[3] La Fondation porte le nom du président de la CGIl de l’après-guerre ; Giuseppe Di Vittorio était un homme politique de gauche, antifasciste et syndicaliste italien. Contrairement à la majorité des syndicalistes du XXᵉ siècle issus de la classe laborieuse, Di Vittorio vient de la paysannerie. Militant communiste, il quittera la PCI après les évènement de Budapest en 1956 pour rejoindre le Parti Socialiste Italien. https://www.fondazionedivittorio.it/it
[4] Mais elle n’est pas si étrangère que cela à notre tradition italienne – ou allemande –puisque Gino Giugni, le grand maître du droit syndical italien, considéré comme le père du statut des travailleurs salariés de 1970, était parti étudier à l’université du Wisconsin où il a appris les leçons du syndicalisme américain fondé sur l’institutionnalisme volontariste théorisé par John Commons et surtout par Selig Perlman. Dans les années suivantes, Gino Giugni deviendra le théoricien de « l’autonomie collective » et de « l’inter-syndicalisme » ; c’est-à-dire d’un système de relations professionnelles entièrement centré sur la capacité autonome des partenaires sociaux à réguler les relations de travail, le rôle de l’État se limitant à produire une législation facilitant la négociation collective, du type de la loi Wagner rooseveltienne de 1935. Bien sûr, cette approche avait aussi ses faiblesses puisqu’elle n’a jamais posé la question du degré de couverture des conventions collectives et elle a laisse le champ libre au patronat de transférer la production dans les états du sud, où la présence syndicale est restée très faible jusqu’à très récemment
C’est avec regret que nous annonçons la cessation de la parution de la revue Les Mondes du Travail. Le comité de rédaction a connu un conflit interne qui s’est étiré sur plusieurs mois au cours de l’année dernière. Ce conflit s’est développé dans un contexte marqué par une fragilisation de notre assise financière et une accumulation de problèmes organisationnels. Même si la coordination des dossiers a été pris en charge collectivement, le travail de secrétariat et la gestion des abonnés a continué de façon bénévole, ce qui est révélateur d’un déficit d’appui institutionnel, alors même que la revue a gagné en reconnaissance et en visibilité depuis 2019.
Il faut dire aussi que le champ de l’édition scientifique s’est profondément transformé depuis une dizaine d’années. Le nombre de revues en ligne a explosé et leur économie organisationnelle repose, pour la plupart, sur la plateforme Revues.org sinon sur le portail payant de Cairn. Même si la publication d’une revue scientifique a gagné en «valeur d’échange» du point de vue de l’économie du champ et des carrières (passablement précaires), il est indéniable que sa «valeur d’usage» connait une érosion constante. La course à la publication génère une spirale inflationniste qui veut que la quantité d’articles publiés l’emporte sur la qualité ou leur pertinence. D’une manière générale, le contenu global d’une revue est bien moins important que la multitude d’articles qui peuvent être consultés séparément et qui alimenteront le Chat GPT qui produira des paraphrases utiles pour rédiger rapidement un ensemble d’articles qui seront probablement publiés un ou deux ans plus tard, si tel est le cas. Tout ce climat concurrentiel inflationniste propulsé par l’université néolibérale et sa culture managériale croissante génère une sorte de pathologie auto-immune (cf. le concept de pathologie auto-immunitaire utilisé par J. Derrida), produisant le contraire de ce qu’elle prétend réaliser. Bien entendu, dans un tel contexte, la recherche de cohérence est évacuée, la disponibilité pour un véritable dialogue entre chercheurs devient minimaliste et les positions critiques ou les analyses qui ne s’accommodent pas de la doxa dominante dans les sciences sociales sont écartées ou poussées vers l’autocensure. En prenant cette décision, nous ne ferons certainement pas partie du problème…
Nonobstant les vents contraires, nous avons réussi à maintenir, pendant près de 18 ans et 30 numéros parus à ce jour, une orientation ouverte et critique. Mais force est de constater qu’une telle orientation peut difficilement être soutenue par des structures tels que des laboratoires de recherche. Sachant que les mœurs organisationnelles du monde scientifique et l’engagement bénévole font mauvais ménage, il a semblé préférable de cesser la parution du titre et de redéployer nos ressources sur des objectifs plus réalistes et des projets en adéquation avec les principes qui ont présidé au lancement de la revue en 2006. Les abonnements individuels et institutionnels enregistrés pour l’année 2023 se clôturent donc avec le numéro 31 à paraître au printemps 2024.
« Deux pas en arrière, un pas en avant !»
Entre-temps, nous mettons en place une nouvelle plateforme de publication multilingue, d’édition et de recherche critique liée au monde réel et traitant non seulement du travail, de l’emploi ou des «relations professionnelles», mais aussi de toutes les questions urgentes interdépendantes telles que la montée de l’autoritarisme, la crise de la démocratie, l‘urbanisation de la planète, le dérèglement des éco-systèmes, l’économie politique, la financiarisation, la guerre contre la nature et contre la vie. Cette plateforme sera rendue publique lors de l’impression du numéro 31. Dans les mois à venir, nous publierons également sur ce site la traduction anglaise des articles et des interviews les plus intéressants, comme ceux de Michael Burawoy, Dave Lyddon et Martin Kuhlman, Moshe Postone, Oskar Negt, Ewan Gibbs, Ake Sandberg, Robert Karasek, Antonio Casilli, Michel Lallemant et Michèle Riot-Sarcey, Fernando Urrea-Giraldo, Jorge Cabrita, Danièle Kergoat, Laurent Vogel, Anselm Jappe et Danièle Linhart.
Pour le Conseil d’administration de la structure d’édition « Les Mondes du travail – association Loi 1901 »
Stephen Bouquin, Denis Blot, Pascal Depoorter, Nathalie Frigul, Alain Maillard.
Quelques statistiques
| Moment / période |
Visiteurs uniques |
Pages visitées |
| Aujourd’hui (22/10/2024) |
11 |
16 |
| Hier |
115 |
349 |
| Semaine dernière |
754 |
1 374 |
| Derniers 30 jours |
2 702 |
5 292 |
| Derniers deux mois |
4 131 |
8 861 |
| Derniers trois mois |
5 247 |
11 381 |
| Derniers 12 mois |
16 964 |
34 319 |
| Cette année (janvier 2024- aujourd’hui) |
15 725 |
32 413 |
| Année passée (2023) |
26 523 |
54 935 |
| Total depuis 2020 |
94 397 |
203 820 |
| Numéro et thème du dossier | Coordinateur(s) du dossier | # téléchargements par numéro format pdf. (total 32 634) |
| N°31– Le futur du travail : critiques et enjeux (octobre 2024) | Marie-Anne Dujarier et Olivier Frayssé | Papier uniquement |
| N°30 – Travail, négociations, conflits : quelles recompositions (septembre 2023) | Sophie Béroud et Jérôme Pélisse | 794 |
| N°29 – Travail et écologie (Mars 2023) | Alexis Cuckier, David Gaboriau et Vincent Gay | 2 825 |
| N°28 – Varia (July 2022), 2196 | collectif | 2 196 |
| N°27 – Périphéries, la part du travail dans la production de l’espace (décembre 2021) | José Angel Caldéron | 2766 |
| N°26 – Travailler en temps de pandémie (juin 2021) | Rachid Bouchareb, Nicolas Cianferoni, Nathalie Frigul, Marc Loriol | 2 983 |
| N°24-25 – L’automatisation en question (novembre 2020) | Stéphen Bouquin | 2 156 |
| Hors série – Mobilisations et grèves (février 2020) | Stéphen Bouquin | 3 450 |
| N°23 – Utopies au travail (novembre 2019) | Séverin Muller | 1 386 |
| N°22 – Ecrire à propos du travail (janvier2019) | Marc Loriol | 876 |
| N°21 – Les discriminations racistes au travail (mai 2018) | Rachid Bouchareb | 898 |
| N°20 – Syndicalisme international (octobre 2017) | Anne Dufresne et Corinne Gobin | 546 |
| N°19 – Travail et handicap (mars 2017) | Françoise Piotet | 788 |
| N°18 – Travailleurs de la mer (septembre 2016) | Jorge Munoz | 597 |
| N°16-17 – Travail et hors travail (décembre 2015) | Marc Loriol et Françoise Piotet | 779 |
| N°15 – Varia (avril 2015) | collectif | 624 |
| N°14 – Mobilités géographiques et travail (mars 2014) | Alain Maillard | 592 |
| N°13 – Humour au travail (juin 2013) | Marc Loriol | 1 452 |
| N°12 –Travail et action collective en temps de crise (novembre 2012) | Jean Vandewattyne et Mélanie Guyonvarc’h | 1 203 |
| N°11 – Varia (février 2012), 417 | collectif | 417 |
| N°9-10 – Travail informel (juin2011) | Stéphen Bouquin et Isabel Georges | 776 |
| N°8 –Travailler le social (avril 2010) | Pascal Depoorter et Nathalie Frigul | 567 |
| N°7 – Travail et Migrations (juin 2009) | Alain Maillard et Denis Blot | 528 |
| N°6 – Classe laborieuse, orientations politiques et engagements militants (septembre 2008) | Stephen Bouquin | 759 |
| n°5 – Splendeurs et misères du travail associatif (janvier 2008) | Mathieu Hély et Maud Simonet | 561 |
| n°3-4 – Travail et conflictualités (mai 2007) | Pascal Depoorter, Isabelle Farcy, Thomas Rothé | 859 |
| n°2 – Travail et temps sociaux en éclats (septembre 2006) | Alain Maillard | 471 |
| n°1 – Relations de travail, droits sociaux et syndicalisme dans les PME (janvier 2006) | Stephen Bouquin | 785 |
Allied Grounds ou terres alliées fut le titre d’une conférence internationale sur la justice sociale et la crise climatique qui s’est tenue début octobre à Berlin. La conférence était l’aboutissement d’un projet annuel de la Berliner Gazette (BG) qui explorait deux constellations voisines, mais rarement reliées : « Dans le Sud, les préoccupations environnementales font partie intégrante des mobilisations sociales contre l’expropriation, l’exploitation et l’extractivisme et cela depuis la conquête coloniale et capitaliste du Nouveau Monde. Dans le Nord, en revanche, l’environnementalisme de la classe laborieuse est apparu au 19ème siècle en réponse à l’industrialisation et à l’urbanisation, tandis que les mouvements syndicaux et environnementaux n’ont retrouvé leur potentiel d’alliance que ces dernières années ».
Expériences sur la forme
La conférence de trois jours était organisée autour d’une double temporalité. Les panels de la soirée étaient ouverts au grand public tandis que la journée avait lieu des ateliers / groups de travail qui rassemblaient des participants de pays aussi différents que l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, la Grèce, l’Italie, le Kenya, l’Iran, l’Inde, l’Indonésie, le Pérou, le Mexique, la Biélorussie, le Portugal, la Roumanie, le Sud-Soudan, l’Espagne et la Turquie. Organisée par Berliner gazette, un média indépendant fondé en 1999, la conférence a bénéficié du soutien d’un large éventail d’institutions et d’organisations. Les ateliers, en particulier, étaient uniques par leur forme et leur contenu. Pendant trois jours, cinq groupes de travail composés d’une dizaine de participants ont eu pour mission de discuter d’un résultat susceptible d’être diffusé sur plusieurs plateformes de communication. Cette méthode « en entonnoir », s’inspire de la méthode du hackathon (contraction de hacking et marathon) qui repose sur des séances de brainstorming respectant un équilibre délicat entre échanges horizontaux et la poursuite d’un objectif tangible à atteindre à la fin de la conférence.
Les séances de discussion ont permis d’identifier des problématiques communes et d’orienter les discussions vers un travail collaboratif qui devait déboucher sur une production ou une création collective ad hoc. Cinq thèmes ont été proposés au débat, mais sans définir la manière comment les aborder ni ce qui pourrait résulter de la discussion : 1) L’éco-internationalisme pour tous ; 2) ces Balkans qui (ne) travaillent (pas) ; 3) L’emploi contre la nature ; 4) l’environnementalisme de la classe laborieuse et enfin, 5) Démanteler l’écofascisme.
Pour aborder ces questions la rédaction de Berliner Gazette avait créé forum dans son journal en ligne qui se concentrait sur les questions clés du thématique de la conférence. Pendant la conférence, ce corpus a servi de référence, ce qui a certainement facilité le dialogue sur des questions très vastes et interconnectées. Tous les participants à la conférence étaient donc à la fois auditeurs, lecteurs, acteurs et modérateurs.
Entrecroisement de questions et de thèmes
Une des originalités de la conférence fut cette imbrication de questions et de thèmes qui sont le plus souvent abordés de manière divisée et juxtaposée dans les médias et le monde universitaire. La crise climatique a été abordée dans une perspective globale, reconnaissant l’existence d’une hiérarchie géographique et sociale des situations. La crise de subsistance dans les pays du Sud est amplifiée par la crise climatique et le développement destructeur d’un capitalisme globalisé. Quant aux phénomènes migratoires, ces derniers ne peuvent être compris sans prendre en compte la destruction des écosystèmes naturels, la mondialisation néolibérale et la crise systémique du capitalisme.
Comme on peut le constater dans bon nombre de pays du nord, l’écofascisme est une « réponse » qui suit la phase de déni de la crise climatique et écologique mais qui persiste dans le refus de remettre en question la nature systémique de la crise climatique. En cherchant à enfermer et à sécuriser les conditions d’existence des classes riches et blanches, l’écofascisme exprime également l’impasse du capitalisme vert. De fait, l’écofascisme avance en parallèle avec le capitalisme vert, l’autre grande utopie capitaliste, et cherche à contenir les luttes sociales et climatiques, à saboter les alliances entre travailleurs et à empêcher la justice environnementale.
Il n’est donc pas surprenant que l’ « écofascisme » ait été évoqué à plusieurs reprises lors de la conférence. C’est devenu un terme de combat de la droite, utilisé notamment comme hashtag dans les réseaux sociaux contre le « gouvernement éco-socialiste de Berlin », Fridays for Future et Elon Musk, entre autres. Tous sont accusés d’instaurer une « éco-dictature ». Cependant, il suffit d’écouter Marine Le Pen en France pour comprendre le sens de l’écofascisme. Comme d’autres personnalités de la droite extrême, Mme Le Pen prône un localisme écologique d’exclusion dans lequel les immigrés sont assimilés à des espèces étrangères envahissantes, tandis que son parti, proclame des slogans tels que « les frontières sont les meilleures alliées de l’environnement, c’est par elles que nous sauverons la planète ». Des discours similaires existent dans des pays aussi différents que les États-Unis et l’Autriche. La fétichisation de la nature par l’extrême droite, comme l’ont suggéré les discussions lors de la conférence, peut aussi se comprendre comme une « réponse » à la crise climatique qui suit la phase de déni, mais qui refuse toujours de remettre en question la nature systémique de la crise climatique. En cherchant à garantir les conditions d’existence des classes riches et privilégiées (principalement blanches) du capitalisme, l’extrême droite expose également les angles morts du capitalisme vert, qui cherche également à contenir (les liens entre) les luttes sociales et climatiques, à saboter les alliances entre les travailleurs et à empêcher la justice environnementale mondiale.
Mais la construction d’alliances durables est loin d’être facile ou spontanée. Alors que l’on prend de plus en plus conscience que les causes de la crise climatique sont le produit d’un « capitalocène racial » à la dérive (Françoise Vergès), il ne suffit pas de rassembler des luttes qui sont à la fois très dispersées et fragmentées. Pour Krystian Woznicki et Magdalena Taube, commissaires (curateurs) et principaux organisateurs de la conférence, c’est précisément ce qui justifie ces conférences et la méthodologie qu’elles mobilisent depuis près de 24 ans : « Pour former des alliances et s’unir, pour atteindre les personnes non convaincues et convaincre les hésitants, nous devons trouver un langage commun qui résonne au-delà des frontières et des expériences. Avant de pouvoir raconter une histoire commune, nous devons nous comprendre les uns les autres et être capables de se parler. Il s’agit avant tout d’une question pratique, et c’est sans doute la raison pour laquelle nous avons toujours rassemblé des personnes aussi diverses que des activistes, des chercheurs, des journalistes et des artistes créatifs. Le résultat n’est pas garanti, il est ouvert ».
Un exercice de créativité, de collaboration et d’écoute
Les résultats des ateliers, au terme de trois jours de discussions intenses, peuvent sembler modestes, mais ils ont un potentiel de multiplication considérable. Le groupe sur l’écofascisme, dont j’ai partagé les idées plus haut, a produit une série de flashcards qui combattent les principaux stéréotypes écofascistes. Le groupe sur l’environnementalisme des classes laborieuses a choisi de se concentrer sur une critique de « l’emploi durable » (sustainable employment) et a mis en place une ébauche d’archive en ligne qui rassemble toutes les ressources et expériences susceptibles de renforcer et d’élargir la dynamique autour de ces aspects. Citons à titre d’exemple, sans ordre particulier, la reconversion des usines récupérées et autogérées, les luttes pour la santé sur le lieu de travail et contre la toxicité de la production, tant pour les travailleurs que pour les habitants, les luttes des paysans pour la recommonisation des terres arables, les mobilisations pour le développement des transports publics dans les grandes agglomérations urbaines, etc.
Le groupe sur l’éco-internationalisme a travaillé sur un manifeste de la plate-forme, dont les premières lignes se lisent comme suit : « Ce manifeste appartient à la Plate-forme, un réseau imaginaire de plates-formes de forage squattées dans l’océan. La Plateforme est un corps vivant, habité par d’autres corps, qui cocréent leur réseau de dépendance. Les mauvaises herbes poussent ici, entre les panneaux solaires et le matériel. Les connexions au sein du réseau sont fragiles et instables. Derrière ce Manifeste, il y a un rêve éco-internationaliste pour tous ». Pendant ce temps, le groupe travaillant sur les luttes écologiques et ouvrières dans les Balkans a créé un modèle de mobilisation inspiré des camps climatiques afin de préparer rencontre de réseaux et de mouvements en juin prochain en Bosnie-Herzégovine. Un autre groupe, traitant de la contradiction entre emploi et environnement tel qu’il est imposé par le capitalisme, a quitté le bâtiment où se déroulait la conférence pour réaliser des entretiens de micro-trottoir, demandant aux passants leurs réactions par rapport à des slogans affichés sur des publicités en faveur de produits nocifs et destructeurs. L’action consistait à confronter les gens de passage avec la réalité de ces publicités polluantes tout en leur posant directement des questions telles que « Mais que voulez-vous produire avec votre travail ? ». En somme, un exercice de créativité, de collaboration, d’écoute et de dépassement des inhibitions symboliques et matérielles.
Espaces publics orientés vers le processus, le bricolage et l’opposition
Pour Krystian Woznicki et Magdalena Taube, deux principaux animateurs / curateurs de la conférence, chaque rencontre est à la fois une nouvelle expérience, différente des précédentes, et la poursuite d’une expérience créative qui n’a rien à voir avec un séminaire ou un colloque académique, mais exprime l’apparition éphémère d’un espace public dissident. Cette approche présente des affinités avec la création d’espaces publics oppositionnels prônée par les théoriciens de l’école de Francfort tels qu’Oskar Negt. Elle fait également écho à l’esprit des projets axés sur une exposition ou un happening comme la Documenta X de Kassel avec Catherine David comme curatrice. Elle s’inscrit aussi dans le prolongement la contre-culture underground Do It Yourself ou dit autrement « Fabrique ce qui n’existe pas alors que cela devrait l’être ». L’approche est donc non pré-formatée mais évolutive et, d’une certaine manière, ouverte et vivante ce qui fait que les traces qu’elle laisse (et les graines qui se répandent) sont certainement beaucoup plus amples que les signes immédiatement identifiables de tel ou tel projet, et c’est une très bonne chose.
Après deux jours de discussions, tant en séance plénière en atelier ou au cours des repas et les pauses, les participants commençaient à mieux se connaître, et les discussions rebondissaient les unes sur les autres ou se référaient à d’autres expériences. Les participants n’étaient pas là pour faire du réseautage ou de l’autopromotion, mais pour apprendre et partager leurs connaissances et leurs points de vue. À la fin de la journée, après les sessions de type hackathon et quelques pauses, les invités des ateliers se sont retrouvés pour des discussions publiques auxquelles le grand public était également convié.
Se débarrasser de la croissance, mais pas du capitalisme qui la produit ?
Le premier débat public, qui s’est tenu le 5 octobre, a porté sur les acteurs potentiels d’un changement systémique. Elle était animée par Claudia Núñez, journaliste d’origine mexicaine à la section « Migration et frontières » du Los Angeles Times et cofondatrice de MigraHack. Les échanges se sont concentrés sur les liens entre la crise climatique et les flux migratoires, sur la raison d’être des frontières (des frontières en papier aux barbelés) et sur la division internationale du travail qui en résulte. Jennifer Kamau, cofondatrice de l’Espace international des femmes à Berlin, une initiative de femmes migrantes et réfugiées, a expliqué comment la situation critique des populations rurales au Kenya est étroitement liée à l’adaptation de la production locale aux marchés européens. En effet, 60 % des fleurs vendues en Allemagne proviennent du Kenya. L’irrigation industrielle et la monoculture entraînent l’épuisement des sols et une énorme dépendance à l’égard des importations de céréales, notamment en provenance d’Ukraine et de Russie, ce qui accroît inévitablement les déplacements de populations et la pression migratoire.
Florin Poenaru, de Bucarest, a adopté le point de vue à la fois très critique et réaliste selon lequel il est peu probable que la situation actuelle s’améliore dans un avenir proche. Le « capitalisme vert » est une vision magique qui prétend résoudre le problème sans vouloir penser à la cause première. L’idée de la décroissance est tout aussi « magique », puisque nous voulons nous débarrasser de la croissance, mais pas du capitalisme qui la génère. N’est-ce pas reproduire le problème en prétendant y apporter la solution ? Une certaine forme d’environnementalisme radical-bourgeois est tout aussi futile : ceux qui prônent la désobéissance civile, le fait de crever les pneus des SUV ou de saboter d’un pipeline se tournent en réalité vers les élites. Leur action consiste à attirer l’attention des élites et à les convaincre de résoudre le problème… C’est encore de la magie !
Le vrai problème auquel nous sommes confrontés est qu’il aujourd’hui plus facile de s’imaginer la fin du monde plutôt que la fin ou la sortie du capitalisme. Pour dépasser ce sentiment d’impuissance, et la paralysie qui s’en suit, il n’y pas d’autre solution que de repolitiser la question de l’environnement, et de proposer des actions et des mesures visant restaurer ou à rétablir un équilibre naturel autant que possible, tout en prenant en charge l’avenir global de l’humanité, en donnant du pouvoir aux plus vulnérables et aux plus exploités que sont devenus la main-d’œuvre migrante et réfugiée.
Remettre en cause le Green New Deal européen
La deuxième conférence publique, le 6 octobre, était animée par Rositsa Kratunkova, membre de plusieurs collectifs travaillant sur des questions de justice sociale en Bulgarie, et portait sur l’environnementalisme de la classe laborieuse. Parmi les participants figuraient Svjetlana Nedimović, de Sarajevo, philosophe et activiste de Puls of Democracy – une publication en ligne pour l’analyse critique des Balkans ; Paola Imperatore, Turin, universitaire-activiste impliquée dans la lutte pour la conversion écologique de GKN à Florence ; et Francesca Gabbriellini, Bologne, historienne et chercheuse, également impliquée dans ces luttes. Les interventions, aussi riches que celles de la veille, ont porté sur les aspects contradictoires du Green New Deal en Europe.
Nedimović est revenue sur la crise environnementale et à la transition écologique en Bosnie-Herzégovine et en particulier ces régions où les communautés de mineurs sont capables d’exercer une pression très forte et de mener les luttes pour la justice économique et environnementale, mais semblent avoir perdu leur élan dans une situation où l’agenda européen exige des mesures environnementales tout en laissant se déployer les prédations extractivistes. L’expérience de GKN, un ancien fournisseur de pièces et de composants (arbres de transmission) pour l’industrie automobile, a gagné une valeur exemplaire à partir d’une occupation de l’entreprise occupée depuis l’été 2021 et dont le comité syndical de l’usine promeut une transition vers la production de pièces et de composants pour les transports publics (trains et bus). Cette expérience montre que les initiatives créatives et imaginatives de la base, lorsqu’elles sont basées sur des alliances fondées entre ceux qui sont directement affectés par le travail et l’emploi et des communautés plus larges d’habitants et d’usagers, peuvent avoir un impact qui va bien au-delà de la situation immédiate ou locale.
Conversation à travers les espaces, les échelles et les subjectivités
La troisième et dernière conférence publique du 7 octobre était animée par la chercheuse écoféministe Anna Saave et portait sur la question de la construction de passerelles entre les luttes. Dario Azzelini, New York et Mexico, a présenté sa vision critique des « emplois durables », qui peuvent être un axe de mobilisation mais à condition se poser la question du mode de production et de ses finalités. Lorenzo Feltrin, Birmingham, est revenu sur les luttes des travailleurs contre la toxicité au sens large, incluant la santé mentale et physique. Le dépassement du clivage entre production et reproduction est sans doute l’une des conditions nécessaires pour orienter les mobilisations dans une direction durable. Dans le même temps, les chaînes de valeur du capital se modifient et s’étendent d’une manière qui rend plus difficile l’identification et la création de liens entre les travailleurs en révolte.
Brett Neilson, Sydney, auteur de livres tels que The Politics of Operation, a axé sa présentation sur la question de la traduction et de la banalisation des langages de résistance. En réalité, cette question est tout sauf sémantique ou linguistique, mais avant tout sociale, en ce sens qu’elle nécessite un positionnement subalterne similaire par-delà les frontières territoriales ou culturelles. Une politique de la traduction doit permettre aux luttes et aux solidarités de s’articuler et d’entrer en conversation à travers les espaces, les échelles et les subjectivités. Savoir se décentrer est certainement une condition d’effectivité importante. Par exemple, la critique du travail animal est à la fois très centrée sur le Nord et exprime une sorte d’horizontalité ontologique qui confond toutes les formes d’êtres vivants. Par ailleurs, reconnaître la différence de nature entre les formes vivantes n’implique pas nécessairement une relation d’assujettissement ou d’exploitation.
La conférence Allied Grounds a été une expérience unique et éphémère. La joie se lisait dans les yeux de chacun. Tout en marquant les esprits par une création collective, cette nouvelle édition des conférences annuelles de la Berliner Gazette a été, comme les précédentes, mais sans doute différemment, une source d’inspiration et d’énergie. Ces trois jours ont démontré concrètement que l’intelligence collective, dans un contexte d’horizontalité et d’égalité, peut favoriser de l’imagination, générer de la confiance et amplifier de nouveaux récits qui devraient se diffuser d’autant plus facilement qu’ils répondent à un besoin réel.
La conférence était le point culminant du projet annuel de BG Allied Grounds, qui a engagé des chercheurs, des activistes et des travailleurs culturels dans une variété de formes et de rencontres dans le but de co-produire des ressources de connaissance, y compris des audios, des vidéos et des textes. Jetez un coup d’œil ici : https://berlinergazette.de/projects/allied-grounds/