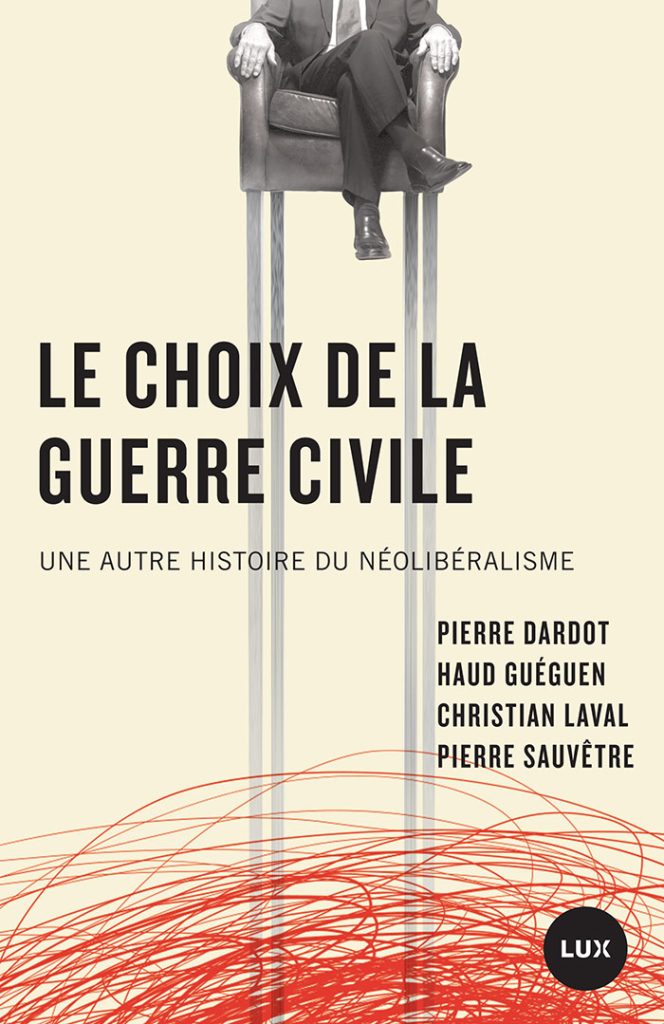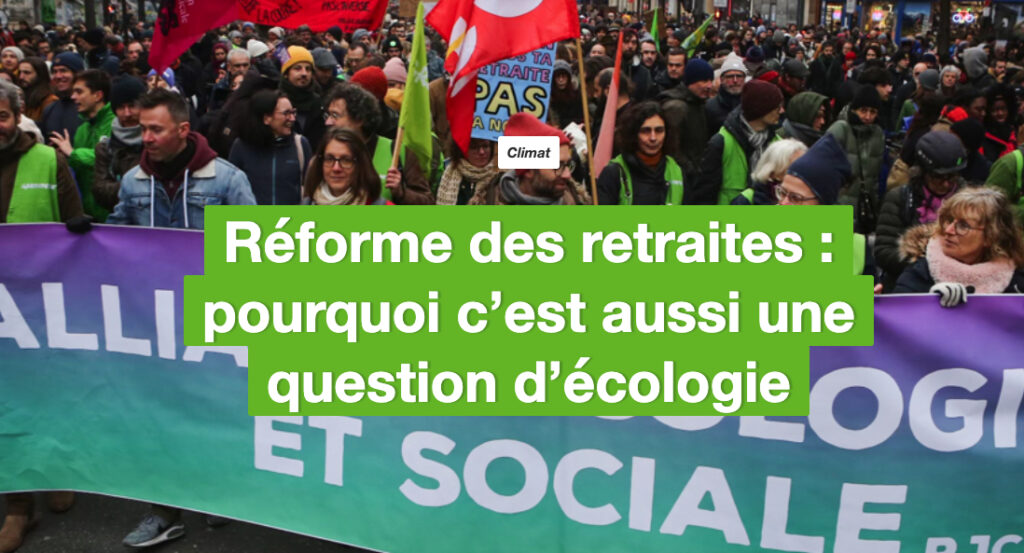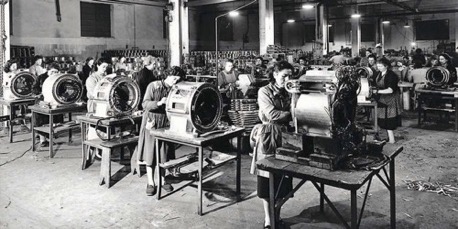La bataille ne fait que commencer : quelques notes critiques à propos du projet de directive européenne sur le travail de plateforme.
Les ministres de l’emploi de l’UE se sont réunis à Luxembourg pour adopter leur position de négociation qui affectera les droits de millions de travailleurs des plateformes. L’accord de compromis auquel est parvenu le Conseil affaiblit considérablement non seulement la position du Parlement, mais aussi la proposition initiale de la Commission, en permettant à des plateformes comme Uber et Deliveroo de continuer à exploiter les travailleurs sous le couvert d’un faux statut d’indépendant. Le texte adopté par le Conseil crée un seuil plus élevé pour déterminer qui est employé par les plateformes numériques, ce qui pourrait priver des millions de travailleurs de droits fondamentaux tels que les indemnités de maladie, les congés payés et les congés parentaux.
La députée européenne Leïla Chaibi déclarait à l’issue de cette prise de position du Conseil : « La position du Conseil en faveur d’Uber adoptée ce matin est à l’opposé de celle adoptée par le Parlement européen en février dernier, et va même à l’encontre des propositions de la Commission européenne. Je suis particulièrement déçue de savoir que c’est la France qui a poussé un si mauvais accord qui va à l’encontre des intérêts des travailleurs. Cette position est inacceptable pour le Parlement européen qui exercera pleinement son rôle de co-législateur lors des débats des prochaines semaines. Au cours de ces négociations, le Parlement défendra l’esprit de la directive face au Conseil qui a clairement cédé à la pression d’Uber et d’autres lobbies. Les travailleurs des plateformes à travers l’Europe peuvent compter sur le Parlement européen pour obtenir une directive qui les protège. » Selon l’approche générale adoptée par le Conseil, les travailleurs ne pourront légalement présumés être des employés d’une plateforme numérique que si leur relation avec la plateforme remplit au minimum trois critères sur cinq énoncés dans la directive, à savoir (1) la possibilité pour la plateforme de plafonner la rémunération des travailleurs; (2) des restrictions sur leur capacité à refuser un travail; (3) l’obligation pour la personne qui exécute le travail de la plate-forme de respecter des règles contraignantes spécifiques en matière d’apparence vestimentaire, de comportement envers le destinataire du service ou d’exécution du travail ; (4) superviser l’exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, y compris par des moyens électroniques ; (5) restreindre effectivement, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser son travail, en particulier la liberté de choisir ses heures de travail ou ses périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des substituts ;
L’enjeu est évidemment fondamental puisque la présomption de la relation d’emploi (salariale) impliquera pour les travailleurs de plateforme le droit de bénéficier des droits sociaux et du travail qui vont de pair avec le statut de « salarié »: (1) un salaire minimum (lorsqu’il existe); (2) un droit à la la négociation collective; (3) l’application de la réglementation sur le temps de travail et la protection de la santé; (4) le droit à des congés payés; (5) un meilleur accès à la protection contre les accidents du travail; (6) des allocations de chômage et de maladie; (7) le droit à la pension de retraite basées sur des cotisations;
Selon des estimations récentes de l’Institut Syndical Européen, près de 6 millions de personnes seraient faussement classées comme travailleurs indépendants dans l’UE. Maintenant que le Conseil (instance regroupant les représentants des gouvernements des Etats-membres) a adopté une position, en retrait par rapport au projet de directive élaboré par la Commission, la bataille va se poursuivre au travers d’un « trilogue » où le Parlement, la Commission Européenne puis à nouveau le Conseil auront à statuer sur le contenu définitif de la directive cadre. L’affaire est donc loin d’être clôturée… Pour mieux cerner les enjeux autour de la réglementation du travail de plateforme, il nous semble utile de commencer par une analyse critique du projet initial de directive élaboré par la Commission. Nous publions à cette fin un article de Valerio De Stefano, juriste spécialiste du travail de plateforme. Valerio De Stefano est professeur à l’université de York (Toronto, Canada) après avoir été associé pendant une dizaine d’année à l’Institut Syndical Européen et chercheur au département de droit du travail de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Nous reviendrons ultérieurement sur les dimensions socio-économiques de travail de plateforme et le positionnement des acteurs syndicaux tout comme les multiples comités de lutte représentant les travailleurs de plateforme.
La rédaction
_________________________
La proposition de directive de la Commission européenne sur les Plateforme de travail : une vue d’ensemble.
Valerio De Stefano*
Résumé
Cet article examine la proposition de directive de l’UE sur le travail sur plateforme. Tout en saluant la proposition avancée par la Commission, il met en évidence certaines de ses lacunes et suggère une protection plus solide tant pour le projet de chapitre sur la présomption d’emploi, qui risque d’être largement inefficace, que pour le chapitre sur la gestion algorithmique, dont la protection doit être pleinement étendue aux travailleurs indépendants, des droits collectifs plus substantiels pour les travailleurs et l’élargissement du champ d’application à l’ensemble de la main-d’œuvre de l’Union européenne.
Mots clés : travail sur plateforme, management algorithmique, présomption d’emploi, travail indépendant
1 – Introduction.
En décembre 2021, la Commission européenne a présenté un « paquet » de mesures concernant le travail sur plateforme dans l’Union européenne, qui comprenait une proposition de directive sur le travail sur plateforme et un projet de communication de la Commission concernant des « lignes directrices sur l’application du droit communautaire de la concurrence aux conventions collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs indépendants isolés »[1] . Une initiative sur le travail de plateforme avait été annoncée dès les premiers jours de la législature par la vice-présidente Vestager et avait été expressément mentionnée dans la « lettre de mission » de la présidente von der Leyen au commissaire Schmit.[2]
Le « paquet » présenté par la Commission est sans doute l’une des initiatives législatives les plus importantes prises par l’Union européenne dans les domaines du travail et des affaires sociales au cours des dernières années. Dans cette brève contribution, j’aborde certains des éléments les plus critiques de la proposition de directive, sachant que d’autres articles de ce volume monographique aborderont ces éléments de manière plus spécifique et plus approfondie.
2 – Le principe de « primauté des faits » et la présomption de salariat : réviser et le soumettre à nouveau.
La première série de dispositions essentielles de la directive concerne le statut d’emploi des travailleurs des plates-formes. Le chapitre II commence par prévoir que les États membres doivent mettre en place des procédures pour assurer la classification correcte de l’arrangement contractuel entre une plateforme et ses travailleurs, « en vue de vérifier l’existence d’une relation de travail » entre ces parties et « d’assurer qu’elles jouissent des droits découlant du droit de l’Union applicable aux travailleurs ». Pour atteindre cet objectif, l’article 3 de la directive prévoit également que « la détermination de l’existence d’une relation de travail est guidée principalement par les faits relatifs à l’exécution effective du travail, en tenant compte de l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail de la plateforme, indépendamment de la manière dont la relation est classifiée dans tout arrangement contractuel qui peut avoir été convenu entre les parties concernées ».
Cette disposition réaffirme le principe de la « primauté des faits », selon lequel la substance doit prévaloir sur la forme pour déterminer le statut de l’emploi. Cette idée n’est pas nouvelle, puisque la plupart des juridictions dans le monde suivent ce principe, que ce soit à la lumière de dispositions légales spécifiques ou par le biais de la jurisprudence.[3] En outre, ce principe est également au cœur de la recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006, de l’OIT, expressément rappelée dans le considérant (§21) de la directive proposée. Notamment, la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne faisait déjà référence à ce principe dans son considérant (§8). Son inclusion dans la proposition de directive sur le travail sur plateforme, bien qu’elle ne soit pas surprenante, devrait être accueillie favorablement. Tout d’abord, la proposition établirait expressément ce principe dans un article de la directive, lui donnant une sanction législative explicite au lieu de le confiner dans ses considérants. Cela est d’autant plus important dans un secteur comme celui du travail sur plateforme, où la classification erronée des arrangements contractuels est endémique et où les plateformes dictent presque invariablement les conditions de travail par le biais de clauses types, souvent purement cosmétiques, qui affirment une relation de travail indépendant entre les parties. En outre, l’article 3 stipule explicitement qu’en examinant « l’exécution effective du travail », les adjudicateurs doivent tenir compte de l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail sur les plateformes. Ici, la directive indique clairement que, dans le domaine du travail sur plateforme, le contrôle et la supervision managériaux qui peuvent entraîner la requalification d’un accord contractuel en une relation de travail peuvent également se produire par le biais d’une « gestion algorithmique ». La directive codifie donc l’acquis de plusieurs juridictions en Europe, notamment les Cours suprêmes française et espagnole, selon lesquelles le contrôle et la subordination peuvent également découler de formes technologiques de gestion.[4] Les articles 4 et 5 de la directive prévoient une présomption réfutable d’emploi entre une «plateforme numérique de travail qui contrôle […] l’exécution du travail et une personne qui exécute un travail de plateforme par l’intermédiaire de cette plateforme ». Par ailleurs, la vérification de l’activité de travail réalisé dans le cadre d’une relation d’emploi requiert le fait de remplir au moins deux des cinq indicateurs suivants :
- déterminer unilatéralement ou fixer des limites supérieures du montant de la rémunération ;
- l’obligation pour la personne qui exécute le travail de la plate-forme de respecter des règles contraignantes spécifiques en matière d’apparence vestimentaire, de comportement envers le destinataire du service ou d’exécution du travail ;
- superviser l’exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, y compris par des moyens électroniques ;
- restreindre effectivement, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser son travail, en particulier la liberté de choisir ses heures de travail ou ses périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des substituts ;
- limiter effectivement la possibilité de se constituer une clientèle personnelle ou d’effectuer des prestations de travail pour des
Une présomption réfutable de relation de travail dans un domaine qui, comme nous l’avons déjà mentionné, est largement touché par les erreurs de classification est, en principe, un instrument bienvenu. Toutefois, force est de constater que la formulation actuelle de la présomption risque d’être au mieux peu utile, voire contre-productive dans certains cas.
En fait, les indicateurs mentionnés aux points b), c) et d) peuvent être considérés – en soi – comme des indices forts, voire des éléments déterminants, susceptibles d’entraîner une requalification en statut d’emploi dans plusieurs pays européens. Par exemple, on peut difficilement imaginer une définition plus appropriée du contrôle et de la subordination suffisants pour déterminer le statut d’emploi qu’une partie « restreignant effectivement la liberté, y compris par des sanctions, d’organiser le travail [de l’autre partie] ». Pourtant, si la directive était adoptée dans sa version actuelle, cet élément serait « déclassé » en un simple indicateur parmi d’autres qui, ajouté à un autre, pourrait déclencher une présomption réfutable d’emploi. En d’autres termes, les plateformes pourraient restreindre la liberté des travailleurs d’organiser leur travail et pourraient toujours prouver que cela ne devrait pas entraîner une reclassification, même si l’un des autres indicateurs susmentionnés est rempli.
La supervision de l’exécution du travail, la vérification de la qualité des résultats et l’obligation de respecter des règles contraignantes spécifiques devraient également constituer des indices très forts de l’existence d’une relation de travail. Prouver leur existence pourrait sans doute suffire à obtenir une reclassification dans plusieurs juridictions, comme cela s’est produit au cours des deux dernières années dans plusieurs États membres. En tout état de cause, si l’un de ces indicateurs est rempli, il ne devrait pas être nécessaire de remplir un autre indicateur pour déclencher une présomption d’emploi qui peut encore être réfutée. Si ces indicateurs ne sont pas réexaminés de manière significative, le risque est que certains tribunaux placent la barre très haut pour considérer que le travailleur n’est pas en mesure d’exercer un emploi.
Il s’agit d’une interprétation erronée et trop stricte, car ces indicateurs sont désignés comme des éléments qui peuvent cumulativement équivaloir à un « contrôle ». Il s’agirait d’une interprétation erronée et trop stricte, car ces indicateurs sont désignés comme des éléments qui peuvent cumulativement équivaloir à un « contrôle » et, par conséquent, la surveillance ou l’imposition de règles contraignantes ne devraient pas être aussi intenses que celles qui suffisent déjà à conclure à un contrôle en vertu des normes existantes. Néanmoins, si le projet de directive n’est pas révisé, son application pratique pourrait paradoxalement rendre plus difficile pour les travailleurs des plateformes de contester leur statut d’emploi dans certains pays européens.
L’indicateur a) semble pour l’instant le plus facilement mobilisable devant les tribunaux et, contrairement à l’indicateur e), il serait également plus difficile pour les plateformes de l’éviter en se contentant d’inclure et d’adapter des clauses fictives dans leurs conditions générales. L’indicateur a), cependant, ne serait pas déclenché dans la plupart des cas de travail sur des plateformes en ligne, mais aussi pour de nombreuses activités hors ligne, telles que le travail domestique, où c’est plus souvent le client qui est autorisé par la plateforme à fixer une rémunération de manière unilatérale. Cela est d’autant plus problématique que les autres indicateurs semblent également plus difficiles à respecter devant les tribunaux pour ces activités. En conséquence, l’un des aspects les plus importants et les plus positifs de la proposition de directive – son ambition de couvrir toutes les formes de travail sur plateforme, en ligne ou hors ligne – pourrait rester lettre morte dans la pratique.
La proposition, telle qu’elle est formulée, semble difficilement « à l’épreuve du temps » – le travail sur plateforme en ligne sera à peine affecté par la directive, laissant également le marché du travail de l’UE sans protection contre les vagues futures possibles d’externalisation des activités de travail qui peuvent être exécutées à distance ;[5] à cet égard, l’absence de toute disposition spécifique pour régir les conflits de normes légales pouvant survenir si une personne exécutant un travail sur plateforme est basée dans un pays différent de celui de la plateforme est également particulièrement préoccupante. En outre, le travail sur plateforme hors ligne, au-delà des secteurs où les tribunaux ont déjà reclassé les travailleurs en tant qu’employés (salariés), tels que la livraison et le transport, pourrait également ne pas être affecté par la directive.
Il n’est donc pas surprenant qu’un projet de rapport sur la directive introduit au Parlement européen propose de modifier matériellement la notion de présomption.[6] Selon ce rapport, la présomption réfutable de la relation d’emploi s’appliquerait à toutes les plateformes numériques de travail, définies à l’article 2 comme « toute personne physique ou morale utilisant des programmes et des procédures informatiques pour intermédier, superviser ou organiser de quelque manière que ce soit le travail effectué par des particuliers, que ce travail soit effectué en ligne ou dans un certain lieu ». Les indicateurs précédemment inclus dans l’article 4 seraient désormais modifiés et ne figureraient plus que dans un considérant.
L’objectif de ces amendements semble être de rendre la présomption plus efficace en évitant que son application ne soit entravée, entre autres, par les aspects litigieux ou contestables qui sont apparues auparavant. Si l’on peut considérer qu’il s’agit là d’une évolution positive, même si la présomption était ainsi élargie, son fonctionnement pourrait encore être sensiblement entravé si la possibilité de la réfuter n’était pas également renforcée d’une manière ou d’une autre. Ni la proposition actuelle de la Commission, ni les amendements du projet de rapport posent des limites significatives à la manière dont la présomption peut être réfutée. En conséquence, la présomption sera très facilement contestable.
La proposition de la Commission s’appuierait aussi principalement sur les définitions nationales des relations de travail « en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice ». Si telle était la formulation finale de la directive, dans tout État membre ayant une définition particulièrement étroite de la relation de travail, que ce soit dans sa législation ou dans sa jurisprudence, les plateformes pourraient neutraliser toute présomption d’emploi en s’appuyant simplement sur des critères nationaux traditionnels trop stricts qui ne tiennent pas compte des particularités du travail sur plateforme. Ce risque pourrait être atténué si les amendements proposés dans le projet de rapport étaient adoptés, étant donné que la Cour de justice de l’UE aurait une plus grande possibilité d’interpréter le chapitre III de manière plus ciblée et que les critères utilisés par la Cour de justice pour déterminer l’existence d’une relation de travail sont traditionnellement plus généreux que de nombreux critères nationaux (bien que, sans aucun doute, l’approche de la Cour à l’égard du travail de plateforme dans sa décision Yodel ait laissé beaucoup à désirer)[7] . Toutefois, même dans ce cas, il semblerait nécessaire que la directive prévoie des exigences plus strictes pour renverser la présomption afin de garantir son efficacité dans tous les États membres.
La présomption de l’existence d’une véritable relation de travail indépendant sur les plates-formes ne sera effective que si des critères plus précis sont adoptés pour rendre plus difficile le renversement de la présomption et renverser la charge de la preuve de l’existence d’une véritable relation de travail indépendant sur les plates-formes. Dans le cas contraire, la présomption risque de n’être effective que dans les pays où le législateur et les tribunaux ont déjà adapté les critères de détermination de l’existence d’une relation de travail au statut d’emploi des travailleurs des plateformes – en d’autres termes, la présomption incluse dans la directive serait largement dépourvue de pertinence.
3 – Gestion algorithmique et travail sur plateforme : techno-déterminisme et lueurs de régulation.
Le chapitre III de la directive proposée introduit une protection en cas de gestion algorithmique. L’article 6 impose d’informer les travailleurs des plates-formes de l’existence et du champ d’application spécifique « a) des systèmes de contrôle automatisés qui sont utilisés pour contrôler, superviser ou évaluer le travail des travailleurs des plates-formes par des moyens électroniques » et « b) des systèmes automatisés de prise de décision qui sont utilisés pour prendre ou soutenir des décisions qui affectent de manière significative les conditions de travail de ces travailleurs des plates-formes». Ces décisions comprennent, en particulier, celles qui affectent les travailleurs des plates-formes dans leur accès aux missions de travail, à la rémunération, à la sécurité et à la santé au travail, au temps de travail, à la promotion et au statut contractuel, « y compris la restriction, la suspension ou la résiliation de leur compte ».
En ce qui concerne les systèmes visés au point b), les travailleurs des plates-formes doivent également être informés des critères utilisés pour prendre une décision, du « poids » de chaque critère ainsi que des « motifs des décisions de restriction, de suspension ou de résiliation du compte du travailleur des plates-formes, de refus de la rémunération du travail, sur le statut contractuel du travailleur des plates-formes » et de « toute décision ayant des effets similaires ». En vertu de l’article 8, les travailleurs des plates-formes auront le droit de recevoir une explication écrite sur la manière dont ces décisions ont été prises. Ils auront également le droit d’accéder à une « personne de contact » compétente désignée par la plate-forme « pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons » qui ont conduit à une décision. Ils auront également le droit de demander à la plateforme de réexaminer une décision préjudiciable.
L’article 6 interdit également certaines des formes les plus abusives de traitement des données, notamment « toute donnée à caractère personnel relative à l’état émotionnel ou psychologique » des travailleurs des plates-formes, les données concernant leur santé et les conversations privées. Il interdit également de collecter « toute donnée à caractère personnel pendant que le travailleur de la plateforme ne propose pas ou n’effectue pas de travail sur la plateforme ». Si l’interdiction de traiter les données susmentionnées est un pas en avant, on se demande pourquoi la collecte de ces données extrêmement sensibles n’est pas purement et simplement interdite – les données relatives à l’état émotionnel et mental, par exemple, peuvent difficilement être collectées par hasard en l’absence de systèmes permettant de les suivre spécifiquement. Pour éviter les abus, la collecte de ces données devrait également être interdite, en plus de leur traitement.
L’article 7 de la directive imposerait l’obligation de réexaminer régulièrement les systèmes de contrôle et de prise de décision automatisés, notamment en ce qui concerne les risques pour la santé et la sécurité au travail. Les plateformes ne doivent pas non plus « utiliser les systèmes automatisés de suivi et de prise de décision d’une manière qui exerce une pression indue sur les travailleurs des plateformes ou qui met en péril la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes ». Il s’agit là d’une notion bienvenue, car les risques en matière de santé et de sécurité au travail se sont tragiquement matérialisés pour les travailleurs des plateformes à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Toutefois, pour que ces risques soient atténués de manière efficace, il est nécessaire d’interpréter le mot « système » au sens large, y compris les politiques mises en œuvre ou facilitées par les technologies de gestion. Par exemple, les paiements à la pièce poussent matériellement les travailleurs à ignorer les règles de sécurité pour augmenter leurs revenus dans les secteurs de la livraison de nourriture et de la logistique. Le paiement à la pièce des travailleurs des plateformes est une politique qui ne peut fonctionner que si la technologie est utilisée pour contrôler et suivre automatiquement le nombre de tâches exécutées au cours d’une période de travail donnée ; il est donc permis de penser que ces politiques tombent sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7.
La raison pour laquelle cet article n’aborde pas explicitement le risque de discrimination algorithmique n’est pas claire, malgré une littérature universitaire en plein essor montrant qu’il s’agit d’un risque susceptible d’affecter, entre autres, les travailleurs des plateformes[8] et l’existence d’au moins une décision adoptée par un tribunal de l’Union européenne constatant qu’une plateforme avait discriminé ses travailleurs par le biais du fonctionnement d’un système algorithmique.[9]
L’article 9 de la directive introduit des obligations d’information et de consultation des représentants des travailleurs concernant l’introduction et les modifications substantielles de l’utilisation de systèmes automatisés de contrôle et de prise de décision. Bien que cet article n’aille pas jusqu’à prévoir un droit plein à « négocier l’algorithme », il permet aux acteurs collectifs d’évaluer les systèmes algorithmiques avant leur mise en place et d’apporter une contribution ex ante à l’adoption et à la modification de ces systèmes. Il s’agit d’une mesure indispensable, car les droits individuels à la transparence qui ne fonctionnent qu’a posteriori ne permettent pas de prévenir les risques de manière adéquate.
Les droits collectifs peuvent être liés aux systèmes de gestion algorithmique et peuvent également être inefficaces si les travailleurs individuels ne reçoivent pas une assistance adéquate lorsqu’ils sont confrontés aux résultats de ces systèmes. Néanmoins, la proposition actuelle de la directive présente au moins deux lacunes importantes concernant la gestion algorithmique et les droits collectifs.
La première est l’exclusion des travailleurs indépendants de l’application de l’article 9. La directive étend les dispositions qui favorisent la transparence en prévoyant un droit à l’information, à l’explication et à la contestation des systèmes de prise de décision automatisés aux « personnes exécutant un travail de plateforme qui n’ont pas de contrat de travail ou de relation de travail » (article 10). Si cette extension est positive, l’exclusion des personnes effectuant un travail sur une plateforme en dehors du cadre d’une relation de travail des aspects collectifs de cette protection, à savoir les obligations d’information et de consultation vis-à-vis des représentants des travailleurs, semble tout à fait insuffisante pour relever de manière adéquate les défis de la gestion algorithmique dans le cadre du travail sur une plateforme. Les plateformes utilisent largement des systèmes de gestion algorithmique invasifs indépendamment du statut d’emploi de leurs travailleurs – de simples droits de transparence « individuels » ne sont pas plus suffisants pour protéger les indépendants qu’ils ne le sont pour les travailleurs des plateformes engagés dans une relation d’emploi.
Outre l’article 153 du TFUE, la proposition de directive mentionne l’article 16, paragraphe 2, comme étant sa base juridique. Cet article permet d’adopter des règles « relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ». Il n’y a pas de distinction entre les indépendants et les salariés dans cet article, et pourtant, limiter la protection des travailleurs indépendants des plateformes à des droits de transparence ex-post revient à confiner ces travailleurs dans une forme patente de protection de second rang. Cette limitation est d’autant plus inexplicable que le « paquet » sur le travail de plateforme présenté par la Commission comprend, au-delà de la proposition de directive, des projets de lignes directrices qui reconnaissent sans équivoque que les pratiques de négociation collective concernent de plus en plus les indépendants, y compris les travailleurs de plateforme. En outre, les syndicats européens s’intéressent de plus en plus à la question de la gestion algorithmique et s’y intéressent activement, y compris par le biais de la négociation collective.[10] À la lumière de ces développements, exclure les travailleurs indépendants de la protection de l’article 9 semble difficilement raisonnable.
Une dernière remarque cruciale concernant l’extension aux indépendants de la protection de la transparence individuelle relative aux systèmes de gestion algorithmique concerne l’interaction possible avec le statut d’emploi et les demandes de reclassement. Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains de ces systèmes de gestion peuvent être radicalement opposés à de véritables formes de travail indépendant. Le travail indépendant est incompatible avec certains des contrôles intrusifs et détaillés de la performance professionnelle rendus possibles par la technologie. Le statut d’indépendant contraste avec les déplacements des travailleurs, le contrôle strict du rythme de travail et le contrôle technique de la messagerie, de la navigation et de l’utilisation des ordinateurs, en particulier lorsque des systèmes automatisés sont utilisés pour combiner les informations déduites de ces caractéristiques.[11]
Même si ces systèmes sont conformes au chapitre III de la directive, s’ils sont mis en place pour contrôler les travailleurs indépendants des plates-formes, ils peuvent entraîner la requalification de la relation de travail en une relation d’emploi. Il serait opportun de mieux préciser que le fait qu’un système de gestion soit autorisé en vertu du chapitre III n’empêche pas que l’utilisation de ce système à l’égard des travailleurs indépendants des plates-formes puisse conduire à la requalification de ces personnes en vertu du chapitre II de la directive. Cela semble implicite dans la formulation actuelle du principe de « primauté des faits » à l’article 3, qui précise que, parmi les faits qui se rapportent à la « prestation de travail effective », l’« utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail de plateforme» doit être prise en compte. Néanmoins, il peut être préférable de prévoir expressément que certaines formes de gestion algorithmique des travailleurs qualifiés d’indépendants peuvent conduire à une requalification même si elles sont conformes au chapitre III.
Une deuxième lacune majeure de la proposition actuelle est son approche « techno-déterministe » de la surveillance et de la prise de décision algorithmiques. En d’autres termes, la directive accepte que ces systèmes et pratiques de gestion soient autorisés en principe, comme s’il s’agissait d’une conséquence naturelle du fait que ces systèmes sont disponibles et que ces pratiques sont rendues possibles par les récents développements technologiques. On pourrait au contraire affirmer que la gestion algorithmique ne devrait pas être considérée comme un « fait acquis ». Son introduction devrait être – au minimum – une question de négociation avec les représentants des travailleurs, parfois également soumise à une autorisation administrative. C’est l’approche adoptée dans le passé par certaines législations nationales européennes concernant l’utilisation de technologies, telles que les caméras, qui peuvent permettre de contrôler la performance au travail.[12] Il semble déraisonnable que la gestion algorithmique – qui s’appuie sur des technologies qui pourraient être beaucoup plus invasives que celles qui ont été plus sévèrement examinées dans le passé – soit soumise à des normes réglementaires moins strictes.
4 – La proposition de directive, les dispositions plus favorables et les effets potentiellement dérégulateurs de la réglementation en cours d’élaboration à propos de l’intelligence artificielle » de l’UE.
L’approche techno-déterministe du chapitre III pourrait être atténuée par l’article 20 de la directive, qui permet aux États membres d’appliquer ou d’introduire des réglementations plus favorables aux travailleurs. Néanmoins, le risque d’un conflit potentiel entre ces réglementations nationales et d’autres instruments de l’UE ne doit pas être négligé. En particulier, la proposition actuelle de règlementation sur l’intelligence artificielle (la « loi sur l’intelligence artificielle ») [13] pourrait constituer un obstacle matériel à l’application ou à l’introduction de normes de protection plus strictes que celles autorisées par ce règlement (ou celles correspondant exactement au contenu de la directive). La base juridique de la loi sur l’intelligence artificielle et l’ensemble de sa conceptualisation vont dans le sens d’une libéralisation de la production et de la commercialisation des systèmes d’intelligence artificielle dans l’UE, à condition que ces systèmes soient conformes aux normes de la loi. Comme nous l’avons expliqué en détail ailleurs [14], ces normes sont totalement inadaptées aux systèmes de gestion algorithmique qui sont de plus en plus courants dans le monde du travail d’aujourd’hui car, entre autres, elles ignorent complètement le rôle des partenaires sociaux dans la réglementation de l’introduction d’outils technologiques au travail.
En outre, l’élan de libéralisation (et la base juridique) qui sous-tend cette initiative risque de l’emporter sur toute réglementation nationale, y compris en matière de travail, qui prévoit des normes de protection plus élevées. Si tel était le cas, la loi sur l’intelligence artificielle agirait comme un « plafond » plutôt que comme un seuil « plancher » de protection, ce qui ne serait pas inédit dans le domaine de la législation européenne en matière d’emploi et de travail si l’on pense, par exemple, à la manière dont les dispositions ayant une base juridique « libéralisante » ont été interprétées par la Cour de justice de l’UE de manière perturbatrice dans le cadre du « quatuor Laval ».
Malgré toutes ses lacunes, la directive sur le travail sur plateforme comprend déjà des normes de protection beaucoup plus spécifiques et adéquates que celles prévues par la loi sur l’intelligence artificielle. Elle autorise aussi expressément l’application et l’introduction de niveaux de protection plus vigoureux par les États membres. Il semble raisonnable de soutenir que la directive et les dispositions nationales explicitement sanctionnées par l’article 20 de la directive devraient être interprétées comme une lex specialis par rapport à la loi sur l’intelligence artificielle, étant donné que la directive repose sur une base juridique plus spécifique traitant en particulier des questions sociales et du travail. Une telle interprétation de ces dispositions l’emporterait sur une éventuelle interprétation perturbatrice de la loi dans le champ d’application de la directive. Une interprétation contraire fondée sur la loi sur l’intelligence artificielle abrogerait implicitement l’article 20, ce qui semblerait impossible à justifier pour des instruments adoptés par les mêmes organes législatifs au cours de la même période.
Ces dernières considérations rendent d’autant plus urgent l’examen du champ d’application des dispositions relatives à la gestion algorithmique du chapitre III de la directive. Dans sa formulation proposée, la directive ne couvrirait que les personnes effectuant un travail sur une plateforme, laissant en dehors du champ de sa protection tous les travailleurs qui ne sont pas engagés par des plateformes. Les systèmes de gestion algorithmique, qui posent d’énormes défis aux systèmes nationaux et européens de protection du travail, se sont étendus depuis longtemps au-delà du travail sur plateforme.[15] Cette évolution, associée aux effets libéralisants potentiels de la Directive-cadre sur l’intelligence artificielle, représente une menace importante pour les conditions de travail et les droits des travailleurs dans l’UE.
Par conséquent, il semble d’autant plus urgent d’étendre la protection du chapitre III (en plus de renforcer cette protection, comme indiqué ci-dessus) au-delà du travail de plateforme. Le projet de rapport susmentionné a présenté des amendements potentiels du Parlement européen qui iraient effectivement dans ce sens. Ces amendements seraient entièrement compatibles avec la base juridique et l’évaluation d’impact de la directive proposée. Bien que ce ne soit pas le lieu pour discuter de la difficulté potentielle d’adopter ces amendements au niveau politique, il est essentiel de dire ici, en conclusion de ces remarques, que peu de mesures législatives dans le domaine du droit du travail et de l’emploi de l’UE semblent aussi vitales et juridiquement raisonnables que d’offrir une protection adéquate contre l’introduction et le fonctionnement des systèmes de gestion algorithmique à tous les travailleurs de l’UE, indépendamment de leur statut d’emploi et du secteur dans lequel ils travaillent.
La directive proposée est un premier pas crucial vers une approche plus centrée sur l’humain dans l’introduction et l’application de la technologie au travail, en particulier par rapport aux pratiques libres dont les plateformes et les entreprises technologiques ont bénéficié ces dernières années. Il est néanmoins essentiel de renforcer et d’étendre sa protection pour garantir que ses objectifs soient poursuivis efficacement.
______________
Bibliographie
Aloisi A., «Time Is Running Out». The Yodel Order and Its Implications for Platform Work in the EU, in Italian Labour Law e-Journal, Issue 2, Vol. 13, 2020 ;
Aloisi A., De Stefano V., «Frankly, my rider, I don’t give a damn», in Rivista il Mulino, 7 janvier 2021, disponible à l’adresse : https://www.rivistailmulino.it/a/frankly-my-rider-i-don-t-give-a-damn-1 ; Aloisi A., De Stefano V., Your Boss Is an Algorithm. Artificial Intelligence, Platform Work and Labour, Hart Publishing, Oxford, 2022 ;
Aloisi A. ; Georgiou D., Two steps forward, one step back : the EU’s plans for improving gig working conditions, in Ada Lovelace Institute Blog, 7 avril 2022, disponible à l’adresse : https://www.adalovelaceinstitute.org/blog/eu-gig-economy/ ;
Aloisi A. ; Gramano E., L’intelligence artificielle vous regarde au travail : Digital Surveillance, Employee Monitoring, and Regulatory Issues in the EU Context, in Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 41, 2019, 95 ;
Countouris N., De Stefano V., Working from a distance : remote or removed ?, in Social Europe, 16 juin 2022, disponible à l’adresse : https://socialeurope.eu/working-from-a-distance-remote-or- removed ;
De Stefano V., Durri I., Stylogiannis C., Wouters D., Platform work and the employment relationship, document de travail du BIT n° 27 ;
De Stefano, V., Wouters M., AI and digital tools in workplace management and evaluation. An assessment of the EU legal framework, STUDY Panel for the Future of Science and Technology EPRS | European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 729.516 – mai 2022, 55 ;
Espinoza J.,Vestager says gig economy workers should «team up» on wages, in Financial Times, 24 octobre 2019, disponible à l’adresse : https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3- eca8fc8f2d65 ;
Gramano E., Kullmann M., Algorithmic discrimination, the role of GPS, and the limited scope of EU non-discrimination law, in De Stefano V., Durri I., Charalampos S., Wouters M. (eds.), A Research Agenda for the Gig-Economy and Society, Cheltenham and Camberley and Northampton, Massachusetts, forthcoming ;
Rosin A., Towards a European Employment Status : The EU Proposal for a Directive on Improving Working Conditions in Platform Work, in Industrial Law Journal, advance articles, publié en ligne le 30 mai 2022.
Copyright © 2022 Valerio De Stefano. Cet article est publié sous une licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
* Chaire de recherche du Canada en innovation, droit et société, Osgoode Hall Law School, York University, Toronto. Cette recherche a été entreprise, en partie, grâce au financement du Programme des chaires de recherche du Canada. Cet essai a été soumis à un examen par les pairs en double aveugle.
Notes
[1] Voir Aloisi A. ; Georgiou D., Two steps forward, one step back : the EU’s plans for improving gig working conditions, dans Ada Lovelace Institute Blog, 7 avril 2022, disponible à l’adresse : https://www.adalovelaceinstitute.org/blog/eu-gig- economy/ ; Rosin A., Towards a European Employment Status : The EU Proposal for a Directive on Improving Working Conditions in Platform Work, in Industrial Law Journal, advance articles, publié en ligne le 30 mai 2022.
[2] Espinoza J.,Vestager says gig economy workers should «team up» on wages, in Financial Times, 24 octobre 2019, disponible à l’adresse : https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65. Le texte de la lettre de mission adressée au commissaire Schmit est disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/missio n-letter-nicolas-schmit_en.pdf.
[3] Voir la discussion au Bureau international du travail, L’emploi atypique dans le monde. Comprendre les défis, façonner les perspectives, 2016, 263.
[4] Pour un examen global de la jurisprudence concernant le statut d’emploi des travailleurs des plateformes, voir De Stefano V., Durri I., Stylogiannis C., Wouters D., Platform work and the employment relationship, document de travail de l’OIT n° 27.
[5] Countouris N., De Stefano V., Working from a distance : remote or removed ?, in Social Europe, 16 juin 2022, disponible à l’adresse : https://socialeurope.eu/working-from-a-distance-remote-or-removed.
[6] Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans les plates-formes (COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD)), Commission de l’emploi et des affaires sociales, Rapporteur : Elisabetta Gualmini, 3 mai 2022.
[7] Voir Aloisi A., « Time Is Running Out ». The Yodel Order and Its Implications for Platform Work in the EU, in Italian Labour Law e-Journal, Issue 2, Vol. 13, 2020.
[8] Voir également, pour d’autres références, Gramano E., Kullmann M., Algorithmic discrimination, the role of GPS, and the limited scope of EU non-discrimination law, in De Stefano V., Durri I., Charalampos S., Wouters M., A Research Agenda for the Gig-Economy and Society, Cheltenham and Camberley and Northampton, Massachusetts, à paraître.
[9] Aloisi A., De Stefano V., «Frankly, my rider, I don’t give a damn», in Rivista il Mulino, 7 janvier 2021, disponible à l’adresse : https://www.rivistailmulino.it/a/frankly-my-rider-i-don-t-give-a-damn-1.
[10] Voir, par exemple, les présentations faites lors de la conférence de mars 2022 sur la négociation collective et la gestion algorithmique, disponibles à l’adresse suivante : https://www.etui.org/events/collective-bargaining-and-algorithmic-management. En juin 2022, les partenaires sociaux européens ont expressément fait référence aux défis que pose la surveillance numérique pour la vie privée des travailleurs dans le contexte du travail à distance et ont affirmé que «les outils de contrôle et de surveillance ne devraient être utilisés que lorsque cela est nécessaire et proportionné et que le droit à la vie privée des travailleurs devrait être garanti» : «Les outils de contrôle et de surveillance ne devraient être utilisés que lorsque cela est nécessaire et proportionné, et le droit à la vie privée des travailleurs devrait être garanti. [En raison du rythme accéléré d’adoption des technologies de contrôle et de surveillance sur le lieu de travail, les partenaires sociaux doivent créer un espace d’échange de vues sur ces tendances et sur leur importance pour les partenaires sociaux et les négociations tous les niveaux appropriés dans toute l’Europe». Voir https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-06- 28_european_social_dialogue_programme_22-24_0.pdf
[11] Un problème similaire se pose en ce qui concerne la «loi sur l’intelligence artificielle» de l’UE mentionnée ci-dessous. Voir De Stefano V., Wouters M., AI and digital tools in workplace management and evaluation. An assessment of the EU legal framework, STUDY Panel for the Future of Science and Technology EPRS | European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 729.516 – mai 2022, 55.
[12] Voir, par exemple, Alois, A. Gramano E., Artificial Intelligence Is Watching You at Work : Digital Surveillance, Employee Monitoring, and Regulatory Issues in the EU Context, in Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 41, 2019, 95.
[13] Proposal For a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts {SEC2021) 167 final} – {SWD(2021) 84 final} – {SWD(2021) 85 final}.
[14] De Stefano V., Wouters M., nt. (9).
[15] Aloisi A., De Stefano V., Your Boss Is an Algorithm. Artificial Intelligence, Platform Work and Labour, Hart Publishing, Oxford, 2022.