Daniel Bachet et Gilles Ringenbach nous ont fait parvenir une critique de l’article de Mateo Alaluf (« Travail et entreprise à l’heure de la distanciation physique », Les Mondes du Travail, numéro 26, juin 2021.)
Daniel Bachet (Centre Pierre Naville, professeur émérite, Université d’Evry Paris-Saclay)
Gilles Ringenbach (Centre Pierre Naville)
Le texte de Mateo Alaluf est clair et bien argumenté mais nous souhaitons montrer que sa thèse centrale est très discutable et surtout qu’elle ne permet pas d’ouvrir des perspectives pour l’action collective des salariés. L’auteur tient en effet à soutenir l’hypothèse selon laquelle l’entreprise ne serait plus le lieu central du pouvoir et des modes privilégiés d’exercice du travail. Or, pour confirmer cette hypothèse, il aurait fallu préalablement donner une définition précise de l’entreprise tout en opérant la distinction qui s’impose entre « entreprise » (structure productive) et « société » (entité juridique) car c’est dans le cadre d’une entreprise refondée et non capitaliste que le travail peut devenir une source de valeur et de développement.
L’entreprise fait partie du rapport capital/travail sans toutefois se confondre complètement ni avec le capital ni avec le travail. C’est une entité qu’il faut identifier, car elle ne se donne pas à voir en tant que telle. Ce n’est pas une donnée naturelle, mais un modèle construit. C’est une convention pour nommer et qualifier un « objet » dont les fonctions sont multiples : productives, économiques, sociales et politiques. Tout dépend le plus souvent de son « objet social » et surtout des finalités institutionnelles qui lui sont assignées dans un contexte donné.
Malheureusement, Mateo Alaluf a rabattu les logiques financières de la société de capitaux derrière laquelle opèrent les actionnaires de contrôle sur les dynamiques productives de l’entreprise et des mondes du travail. Il a confondu la « société » sous sa forme néolibérale ou capitaliste à laquelle est assignée un objectif exclusif de rentabilité avec « l’entreprise » conçue comme outil de travail pour les salariés. C’est pourquoi l’auteur reprend, sans la discuter, la définition néoclassique de l’entreprise comme outil de rendement des actionnaires. Il s’agit de la reconduction de la thèse de Milton Friedman selon laquelle l’objectif de l’entreprise serait en priorité de maximiser la valeur pour l’actionnaire.
Par ailleurs et de manière symétrique, la raison d’être d’une entreprise n’est pas d’abord (et de tout temps) la production de plus-value à moins de naturaliser une fois pour toute cette entité. C’est l’entreprise capitaliste qui est productrice de plus-value et non l’entreprise en soi, sauf à souscrire à une approche quasiment métaphysique c’est-à-dire ahistorique de l’organisation et de la production des richesses. L’organisation et les finalités d’une coopérative de production (SCOP) ne sont pas tout à fait assimilables à celles d’une grande société anonyme de capitaux.
L’entreprise peut-elle se réduire, comme le croient encore certains sociologues, à des « collectifs de travail » sans autre considération sur les formes institutionnelles qui leur donneront l’opportunité et la capacité de produire et de vendre les biens et/ou les services ?
Comment produire et vendre et que produire ? Entre le travail et son résultat, il y aura encore longtemps une médiation institutionnelle, soit un ensemble composé d’une « structure productive » qui produit et d’une « société » (entité juridique) qui vend les biens et/ou les services. Les dirigeants, sous contrôle des actionnaires, organisent la division du travail et donnent une partie de son sens aux activités salariées, individuelles et collectives : soit sur un mode coopératif « démocratique » (un individu = une voix) et plus au moins « horizontal » comme dans les SCOP soit sous des modes plus hiérarchiques et non démocratiques (une action= une voix) comme dans les entreprises capitalistes.
Qu’est-ce qu’une entreprise ?
Si l’on tente de cerner la catégorie « entreprise » au plus près, on pourra signaler qu’elle est une structure productive qui a besoin d’un véhicule juridique (la société) afin d’exister comme personnalité morale. La personnalité morale est une « fiction juridique », puisque seule la société est reconnue par le droit. Tout dépend ensuite des finalités institutionnelles qui lui sont assignées : profit et rentabilité ou production et vente de biens et/ou de services associées à une autre manière, non lucrative, de voir et de compter.
Les missions assignées à l’entreprise et à la société ne se résument pas seulement à la production et à la vente de biens et de services. L’entreprise est également un support de création collective qui engage des agents et des collectifs aux intérêts multiples. Ces agents et ces collectifs produisent, coopèrent, innovent et apprennent les uns des autres, de manière individuelle et collective. Les intérêts sont souvent divergents, contradictoires et par conséquent conflictuels. C’est pourquoi l’entreprise est également une entité profondément politique, qui transforme le monde social. Elle possède « une raison d’être » ou un « intérêt social » non réductibles aux intérêts des seuls associés (propriétaires et actionnaires de contrôle).
Depuis l’origine du capitalisme, l’entreprise, comme structure productive dont l’objectif est d’abord de produire et de vendre des biens et des services, n’est pas appréhendée comme une catégorie distincte du travail et du capital. Elle n’existe pas comme unité autonome, car sa finalité supposée (la recherche du profit) et son objet social (les associés sont réunis par un contrat et ont un intérêt commun, qui est le partage du profit) lui ont été assignés par les seuls détenteurs de capitaux (ou associés). Au XIXe siècle, il n’est d’ailleurs pas possible de la reconnaître en tant qu’entité productive spécifique. Elle est d’abord considérée comme un bien ou un outil appartenant à ses propriétaires.
Il est pourtant nécessaire de rappeler que les détenteurs de capitaux ne peuvent jamais être considérés comme les propriétaires de l’entreprise dès lors que cette dernière n’est pas définie par le droit[1]. Elle n’est ni un objet, ni une personne. Les actionnaires sont simplement détenteurs des actions, des parts sociales ou des titres de propriétés.
Quelle est la portée des analyses de Mateo Alaluf ?
L’auteur montre à juste titre les limites de l’ensemble des formes de cogestion (à l’allemande) ou de codétermination. S’il s’agissait après la seconde guerre mondiale de démocratiser l’entreprise, l’échec est patent car les prérogatives des directions n’ont jamais été fondamentalement entamées même si le projet politique de la codétermination était de remettre en question la « gouvernance » des sociétés à travers la participation des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance. L’autre volet portait sur l’organisation du travail à travers le conseil d’établissement en Allemagne (ou Betriebsrat).
Si la plupart des syndicats en Europe ont rejeté la cogestion, le contrôle ouvrier ou le syndicalisme de contrôle se sont présentés après-guerre comme des « instruments de revendication et de ce fait agents de transformation sociale » (Touraine) ou encore comme des partenaires dans la négociation. Mais le contrôle ouvrier qui ne voulait pas se mêler des questions stratégiques et de la gestion des entreprises a également échoué. Car la gestion d’une entreprise est entièrement politique et le droit comptable est l’un des centres névralgiques du capitalisme. Autrement dit, comment un syndicalisme qui plaide pour un contre-pouvoir autonome, séparé du pouvoir de décision économique et stratégique pourrait-il contrôler et infléchir les décisions des dirigeant et des actionnaires ?
Sachant que les directions maîtrisent parfaitement les stratégies économiques et financières (choix d’investissement en particulier) et qu’elles utilisent pour cela des outils de gestion orientés profit et rentabilité, on voit mal comment un contre-pouvoir ouvrier aurait pu infléchir sérieusement les stratégies patronales pour les repositionner en faveur des « intérêts des salariés ».
Les outils de gestion utilisés par les directions d’entreprise sont des technologies politiques qui orientent la manière de voir, d’organiser le travail et de prendre des décisions.
Ainsi, adopter un langage comptable plutôt qu’un autre, c’est adopter une représentation de l’entreprise, de sa finalité, de son efficacité et des rapports de pouvoir. Il est néanmoins possible de compter différemment en vue de proposer une alternative cohérente et opératoire à l’entreprise capitaliste[2].
Dans le texte de Mateo Alaluf, on retiendra la description des transformations spatio-temporelles du travail qui viennent de prendre un tour accentué avec le télétravail et aussi depuis ces dernières années, avec l’éclatement de ce que furent les grandes concentrations industrielles (et ouvrières). Par ailleurs, se sont développées des chaînes de sous-traitance qui font que, par exemple, sur un même lieu de travail (c’est bien souvent le cas dans le BTP) peuvent se côtoyer des travailleurs n’appartenant pas à la même entité et aux contrats de travail hétérogènes.
A la lecture de l’article de Mateo Alaluf, « l’entreprise » aurait ainsi pratiquement disparu. Affirmer cela est dangereux et tend à s’aligner sur le discours des détenteurs de capitaux qui souhaitent – et ont toujours souhaité –ne surtout pas devenir employeurs. Revenir au temps du contrat de louage d’ouvrage est bien ce qui se dessine en ce moment : rendre invisibles le travail et les travailleurs. Or, aujourd’hui, la bataille se déroule sur le plan juridique quand, les « producteurs » (au sens large) se battent justement contre leurs « exploiteurs ». C’est déjà ce qui s’est produit chez Uber, Deliveroo où ont éclaté récemment des mouvements de grève[3] au terme desquels, ces « entreprises » ont été condamnées à requalifier ces travailleurs prétendument autonomes en « salariés ». Consciemment ou non, ces travailleurs sont en lutte non pas contre « l’entreprise » mais contre les détenteurs de capitaux et leurs attributs, prérogatives juridiques de dominants.
Il existe et continuera d’exister nombre d’entités au sein desquelles il y aura nécessairement « concentration » de personnels. Le dénommé capitalisme de plateforme ne requiert pas moins de personnel « sur place » : téléopérateurs, entrepôts gigantesques d’Amazon etc., et bien d’autres y compris dans le domaine des services quelle que soit la nature de ces derniers, « industrie du tourisme », ou grandes chaînes hôtelières par exemple. On n’oublie pas non plus la grande distribution et sa consœur en amont : le capitalisme agro-alimentaire qui a toujours besoin de têtes et de bras. Qu’une grève générale éclate chez les exploiteurs fraisiculteurs du sud de l’Espagne et émergera alors une ligne d’affrontement directe entre capital et travail. Que les manutentionnaires de gros entrepôts en fassent de même et le processus de confrontation sera analogue.
De même, faut-il aussi considérer les « entreprises » du secteur public dont les méthodes de gestion et celles de direction des personnels instaurées par le « new public management », sont désormais calquées sur celles de l’entreprise privée. Que leur statut et celui des agents de la fonction publique relèvent d’un régime juridique différent de l’entreprise privée, n’exclut nullement qu’en leur sein, se nouent les mêmes rapports de domination sous la férule des ministères et de leurs relais incarnés par les hauts-fonctionnaires, l’encadrement supérieur. Or, le surgissement de diverses grèves – dont l’intensité variable a des conséquences y compris pour les entreprises capitalistes – dans ce secteur, attestent bien d’une conflictualité sur les lieux de travail qui mettent face à face un employeur, « l’Etat-patron » et ses salariés.
La crise sanitaire a bien mis aussi en relief, la fragilité logistique dans les flux marchands, écrit encore Mateo Alaluf. Certes, mais qu’est-ce que cela prouve ? Derrière la logistique, interviennent des « entreprises » : les fabricants de containers, les « entreprises » de transports, les personnels de fret, les « entreprises » de services annexes etc. L’auteur pense-t-il réellement que ce ne sont plus des lieux de lutte de classes ? Le vrai défi réside dans le fait que les transformations rapides du capital avec les conséquences que cela comporte (divers éclatements), nécessitent un sérieux réajustement stratégique et tactique de la part des syndicats tout autant que de la capacité des travailleurs eux-mêmes à s’auto-organiser ; ce qui conduit à repenser les modalités elles-mêmes spatio-temporelles d’action. Qu’il y ait déplacements spatio-temporels n’entraine nullement la disparition de « l’entreprise », fût-elle entièrement dématérialisée, virtuelle. Ce qui prouve bien que l’effacement de l’entité physique n’engendre absolument pas la disparition de la société de capitaux et du droit issu de la propriété privée. C’est bien à cela qu’il faut s’attaquer avec des modalités de combat renouvelées.
A défaut d’assigner à l’entreprise une autre finalité que le profit, surtout pour les grandes sociétés de capitaux, le sociologue restera prisonnier de la grammaire capitaliste et sera amené à décrire les conséquences des processus financiers (restructurations, licenciements, délocalisations, etc.) sans être en mesure de remonter à leur origine et de s’attaquer à leurs causes réelles.
Il ne s’agit pas simplement « d’écouter les revendications des salariés » (p. 195) comme l’écrit l’auteur pour les aider à peser sur la finalité de leur travail. Il faut préalablement identifier l’institution ou la structure dans lequel se déploie le travail concret pour lui assigner une nouvelle finalité institutionnelle. L’entreprise n’est plus un objet de propriété et devient alors un « commun ». Elle offre aux salariés des pouvoirs accrus de décision sur le mode de la démocratie salariale : un individu = une voix. Car dans l’entreprise capitaliste, les dominants (dirigeants et actionnaires) occupent une position telle au sein de la structure que celle-ci agit systématiquement en leur faveur. Dans la société de capitaux, le vote par actions permet d’organiser des majorités de façon parfaitement étrangère à l’égalité en droit puisqu’il est possible de se faire élire non pas en recherchant la majorité des voix de partenaires associés, mais en les submergeant avec les « droits de vote » que le capital (la fortune) permet d’acquérir. Cette situation heurte frontalement les valeurs de la démocratie car la seule règle conforme à l’égalité en droit en matière d’expression de volonté commune est logiquement le « vote par tête ».
L’enjeu est donc d’outiller les mondes du travail, lorsque ceux-ci veulent accéder à la mobilisation collective contre l’ordre politique et symbolique établi. Celui-ci s’incarne dans les droits issus de la propriété et dans les outils comptables orientés profit, rentabilité ou valeur pour l’actionnaire. Il s’agit par conséquent de proposer comme légitime les principes d’une autre construction de la réalité économique et sociale.
[1] Jean-Philippe Robé, op.cit.
[2]. Voir sur ce thème en particulier les travaux de Jean Lojkine et de Daniel Bachet.
[3] « Livreurs : ils établissent un rapport de force dans la lutte contre les plateformes ». Rapports de force –l’info pour les mouvements sociaux, 29 janvier 2021.

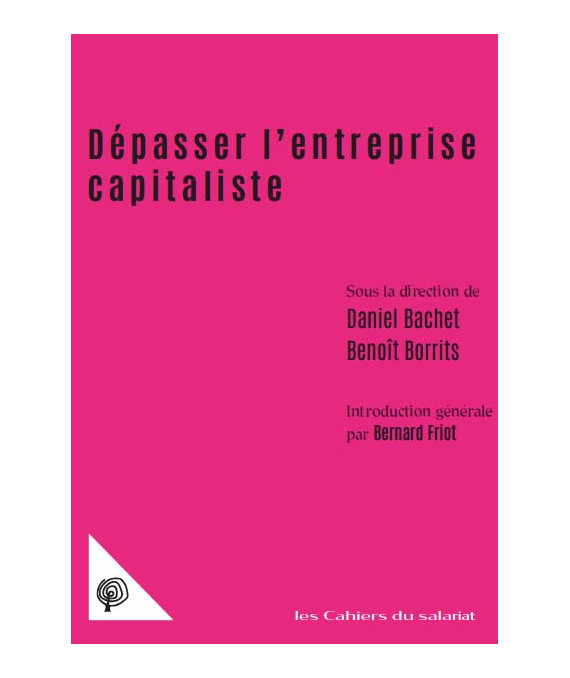
Merci pour ces deux textes qui permettent de souligner les différentes lectures des mutations du capitalisme contemporain. Quelques remarques sur celui de D. Bachet. Cordialement.
D’accord avec l’auteur, l’entreprise est bien une « fiction juridique » mais tout comme la force de travail, la monnaie et la terre (cf Polanyi), c’est une fiction bien réelle. Comme toute marchandise, elle est achetée et vendue sur un marché (les marchés financiers) et plus largement gérée, organisée conformément aux principes de la théorie des droits de propriété (usus, abusus, fructus). Cette « fiction juridique » est irréductible… sauf à sortir du capitalisme.
A l’inverse, me semble-t-il, ce qui se transforme, c’est l’entreprise comme « structure productive », entendue comme une configuration « espace/temps » à l’intérieur de laquelle le travail est réduit à du « travail abstrait » et dont la crise renvoie tout à la fois à une crise de la valeur, une transformation des normes comptables et à un salariat débordé. L’auteur semble oublier cette dimension. La dématérialisation de l’entreprise, c’est un changement profond de référentiel à ce niveau. Si, depuis 10 ans, UBER ne fait toujours pas de profit, c’est que peut-être ce n’est pas seulement le travail qui est invisibilisé, ce sont aussi ses profits qui transitent par d’autres canaux que celui du marché des biens et des services.
Le business modeld’Uber c’est aussi d’augmenter la capitalisation boursière en mobilisation les tournées des chauffeurs comme ressource d’un machine learning en vue de développer l’IA qui pourra servir à la conduite (semi)-automatisée de véhicules. / S. Bouquin