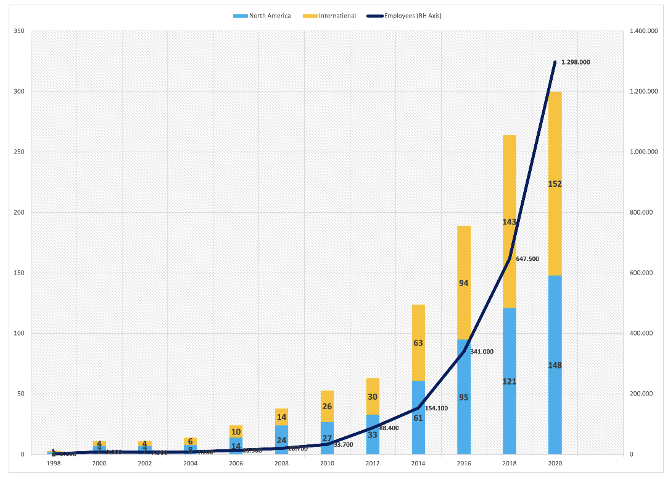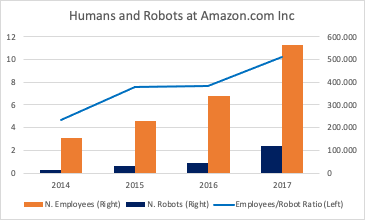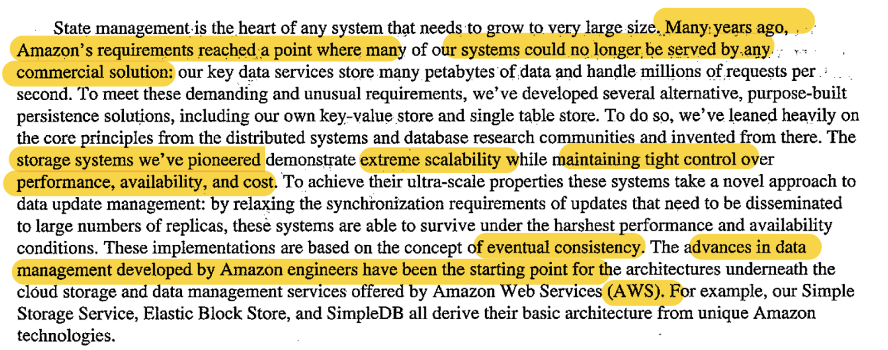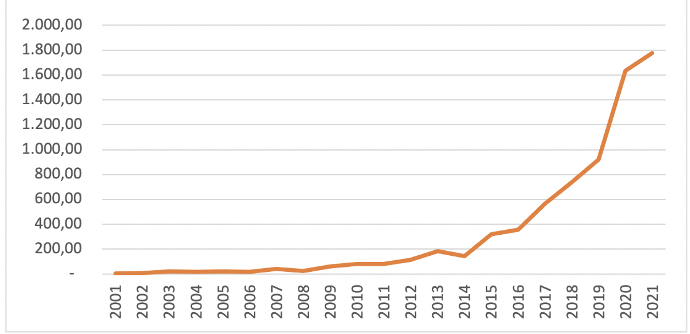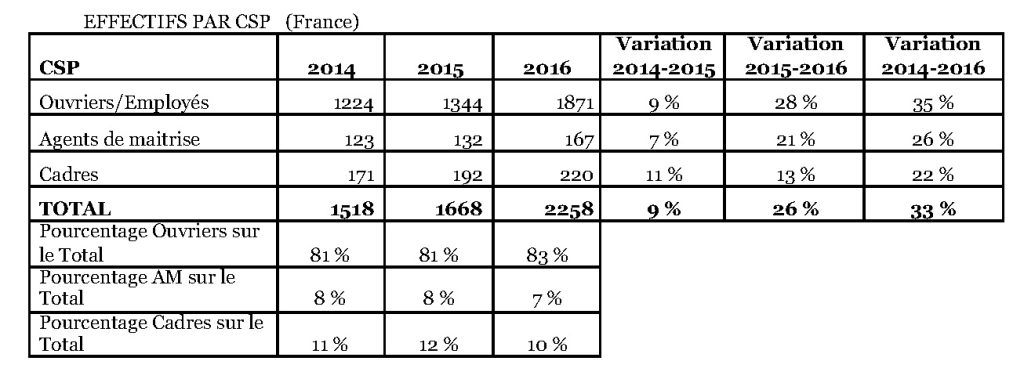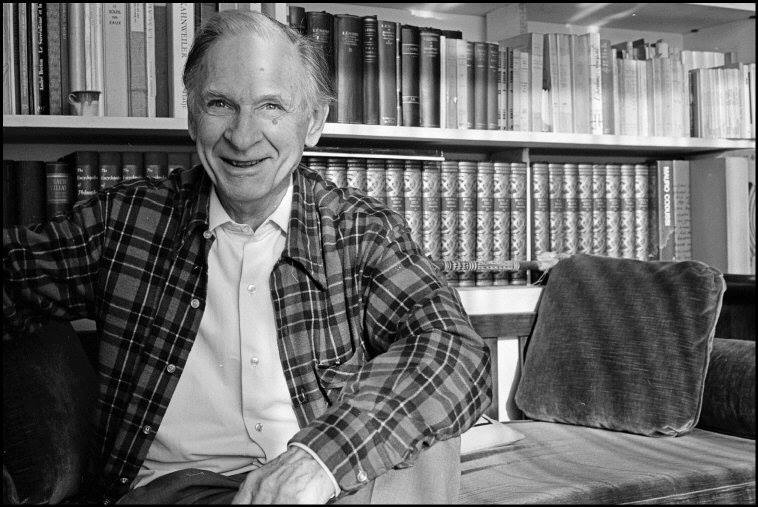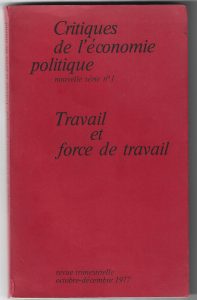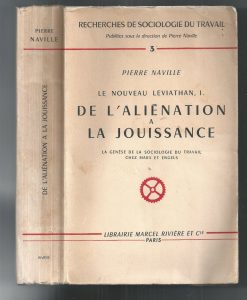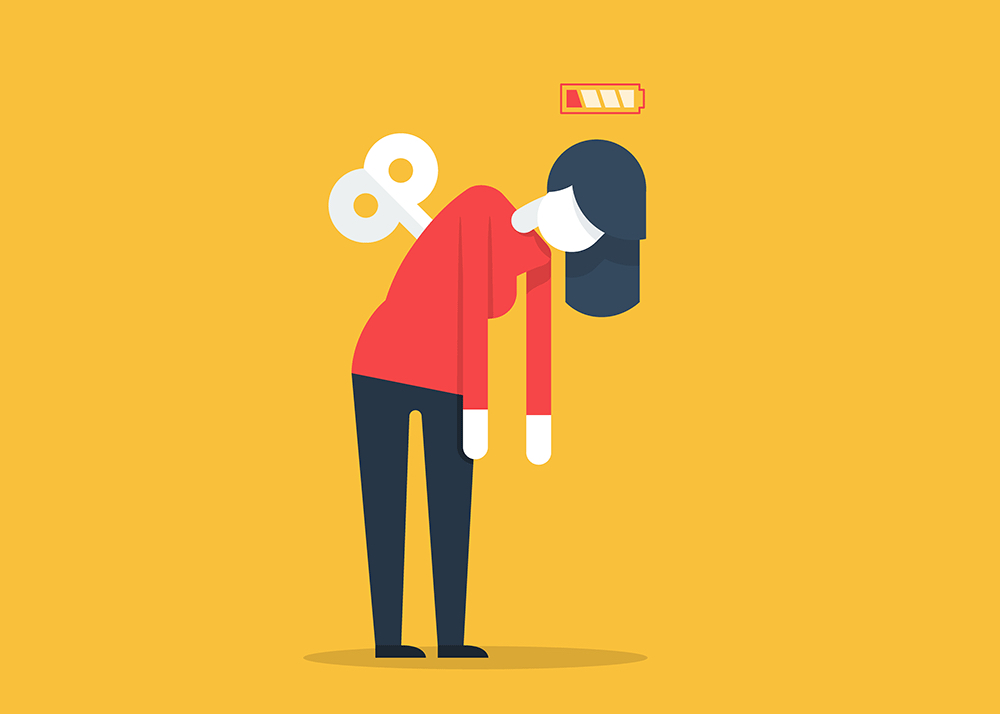par Marc Loriol, sociologue au CNRS, IDHES Paris 1
Résumé : Le vieux terme de « passion » semble depuis quelques années faire un retour en force dans les débats et les comptes-rendus sur le travail. Marqué par un lourd passé philosophique et littéraire, le mot passion renvoie dans l’imaginaire commun à une force psychique individuelle. Pour le sociologue, la passion envers tel ou tel objet de travail (la vente, les relations avec l’usager, l’informatique…) correspond le plus souvent à une construction collective dans laquelle les enjeux d’intérêt économiques et sociaux ne sont pas absents comme le montrent les tentatives d’instrumentalisation de la passion par le management. Cet article synthétise et complète deux de mes contributions récentes.
Mots clés : passion, vocation, plaisir, travail, création, construction sociale, normes collectives
Le vieux terme philosophique de « passion » semble depuis quelques années faire un retour en force dans nos préoccupations sociales comme dans les débats sur le travail. Dans des univers professionnels très divers, la passion deviendrait de plus en plus une attente tant des salariés que des employeurs, voire un pré-requis. Ainsi, dans un certain nombre d’offres d’emploi trouvées sur Internet, le fait d’être passionné est explicitement mis en avant :
« Vous êtes conseiller en immobilier passionné, vous aimez accompagner des clients dans des “projets de vie”. »
« Vous êtes passionné d’automobile ou souhaitez élargir votre expérience à un univers technique et captivant? »
« Vous êtes passionné par la vente, le challenge et la décoration, rejoignez notre équipe structurée dans un projet ambitieux »
« Tu es passionné(e) par les réseaux sociaux et tu as une réelle affinité pour le digital ? »
« AIMER SON TRAVAIL ÇA EXISTE ! Concepteur vendeur… C’est que du bonheur ! […] Le sens du service client, la passion du commerce, le goût du challenge, la volonté de progresser sans cesse …voici les clefs pour devenir concepteur-vendeur […]. Découvrez un monde passionnant, saisissez votre chance et construisez votre avenir dès à présent ! »
« Passionné(e) par le web et expérimenté(e) sur les technologies Open Source, vous serez intégré(e) à une équipe experte en systèmes et réseaux au sein de laquelle vous développerez vos compétences et votre polyvalence. »
Dans ces annonces, la passion au travail apparaît comme une promesse réciproque : pour l’employé, le fait de faire un travail qu’il aime, stimulant et intéressant ; pour l’employeur, l’espoir d’avoir un salarié engagé, motivé, prêt à se dépasser et à aller au-delà de la fiche de poste. Dans certaines annonces, la passion remplace, voire supplante, la compétence technique comme critère exigé !
« Nous ne recherchons pas des cavistes, sommeliers ou œnologues professionnels mais avant tout des hommes ou femmes passionnés par des produits authentiques, des histoires de vie et des rencontres. »
« De formation technique (menuiserie, électricité) et/ou passionné de bricolage, vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire. »
« Notre client restaurateur dont l’activité est portée par la compétence et la passion cherche son second de cuisine pour son établissement »
Le terme « passion » ne se retrouve pas seulement dans la rhétorique des petites annonces, mais aussi dans les discours sur le travail (Dortier, 2016). De nombreux écrits sur le travail (ou des métiers particuliers) retiennent ainsi la passion comme caractéristique supposée centrale d’activités très variées,
Thami Kabbaj, qui enseigne le trading, l’analyse technique et la psychologie des marchés financiers à Dauphine et à Assas, déclare dans son étude sur la psychologie du trader (2011) : « Plus que tout, le trader doit dès le départ être convaincu de sa passion pour son activité. Condition sine qua non pour faire face aux nombreuses difficultés de ce métier. » Décrivant le parcours et les travaux des pionniers de l’informatique et d’Internet, Walter Isaacson (Les innovateurs, 2015) les présente presque avant tout comme des passionnés. Le mot passion et ses dérivés est ainsi utilisé 69 fois dans son livre.
Enfin, la passion est aussi invoquée dans la façon dont de nombreux travailleurs (mais pas tous) présentent, lors des entretiens sociologiques, leur engagement et leur rapport au travail (Leroux et Loriol, Le travail passionné, pour lire une recension ). Pourtant, le terme passion est porteur de nombreuses ambivalences et ambiguïtés. D’où vient la passion ? Que signifie être passionné ? A quelles conditions peut-on être passionné par son travail ? L’histoire de l’utilisation de la notion de passion en philosophie, médecine et littérature révèle les tensions qui traversent les débats sur la passion au travail. Cette multiplicité d’usages et de significations du mot passion se comprend mieux si l’on fait l’hypothèse que la passion au travail est le fruit d’une histoire (les différentes utilisations sociales du terme) et d’une construction collective (de ce qu’est un travail « passionnant »). Dans cette construction, les enjeux d’intérêt économiques et sociaux ne sont pas absents comme le montrent les tentatives, depuis la fin des années 1990, d’instrumentalisation de la passion par le management.
1 – La notion de passion : une histoire complexe et contradictoire (philosophie, psychopathologie et littérature)
1.1 Condamnation puis valorisation de la passion par les philosophes
En philosophie, il existe une longue tradition de condamnation des passions, fondée sur l’opposition entre passion et rationalité, les émotions venant perturber l’intelligence et l’action (comme le suggère l’étymologie commune entre passion et passif). L’homme dominé par ses passions est le jouet de ses émotions, de ses peurs ou de ses désirs, sa raison est rendue passive par une force qui le dépasse ou le trompe.
Déjà, pour Platon, dans le Phédon, la recherche de la vérité passe par la méfiance à l’égard du corps et de nos perceptions. « Le vrai philosophe se tient à l’écart des plaisirs, des passions, des chagrins, des craintes, autant qu’il lui est possible ». Les passions sont comme un cachot qui empêche l’homme de se libérer du sensible pour entrer dans la véritable étude philosophique.
Quelques siècles plus tard, René Descartes pousse encore plus loin l’opposition entre passion et raison. Les émotions qui se forgent dans le cœur, le sang et les « esprits animaux » demeurent longtemps présentes à notre pensée et l’accaparent. Le travail de la volonté est de contrôler et de contenir autant que possible les effets des passions ; de limiter ces réactions du corps qui vont à l’encontre de notre raison. Dans la Lettre à Élisabeth du 6 octobre 1645, il écrit :
« On peut généralement nommer passions toutes les pensées qui sont ainsi excitées en l’âme sans le concours de sa volonté (et par conséquent, sans aucune action qui vienne d’elle), par les seules impressions qui sont dans le cerveau, car tout ce qui n’est point action est passion. Mais on restreint ordinairement ce nom aux pensées qui sont causées par quelque particulière agitation des esprits. »
Pour Spinoza, ce sont les passions tristes de l’âme, telles que la vanité ou le désir envieux, qui nous empêchent d’atteindre le bonheur. « La joie et la tristesse sont des passions par lesquelles la puissance ou l’effort de chacun à persévérer dans son être est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée. » Les passions agissent comme une force extérieure :
« L’essence d’une passion ne peut être expliquée par notre seule essence (selon les définitions 1 et 2, partie III), c’est-à-dire (selon la proposition 7, partie III) que la puissance d’une passion ne peut être définie par la puissance par laquelle nous nous efforçons de persévérer dans notre être, mais (comme il a été montré par la proposition 16, partie II) doit nécessairement être définie par la puissance d’une cause extérieure, comparée avec la nôtre. »
Chacun doit donc chercher à se comprendre lui-même afin que l’intellect le délivre de cette force extérieure inconsciente : « Un sentiment qui est une passion cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » Ainsi les sentiments ne seront plus excessifs et l’homme pourra vivre selon les commandements de sa raison.
Cette condamnation des passions et de leurs excès par les philosophes est toutefois de plus en plus contestée à partir du 18e siècle. La passion désigne désormais le moteur essentiel des grandes entreprises humaines (Diderot, Montesquieu), voire le fondement de l’activité (Hume). Pour Hume, la passion ne peut, le plus souvent, être opposée à la raison, car elle relève d’une nature différente et tout aussi essentielle. La rationalité est souvent impuissante comme seule guide de l’action et de la décision humaines et l’homme ne peut se passer de ses passions et émotions, qui elles-mêmes tirent leur origine de nos désirs et de nos besoins.
De même, pour Rousseau, « l’entendement humain doit beaucoup aux passions » (Discours sur l’origine des inégalités, 1755). Sans passion du savoir, par exemple, pas de progrès de la connaissance, connaissance qui permet à son tour d’éloigner l’homme de son animalité. Toutefois, pour le philosophes, les passions qui viennent de la société (et non de la nature humaine) sont mauvaises : « nos besoins nous rapprochent à mesure que nos passions nous divisent ; et plus nous devenons ennemis de nos semblables, moins nous pouvons nous passer d’eux (Du contrat social, 1762). D’où les querelles, la jalousie, la cupidité qui ne peuvent être régulées que dans les petites communautés égalitaires.
Le courant romantique dote la passion de nouvelles vertus. Kierkegaard, par exemple, voit son époque comme étant sans passion et sans engagement. Il propose pour dépasser l’opposition entre croyance et raison de chercher « ce qui est vrai pour moi », ma vérité subjective est ce qui est le plus essentiel pour moi. Pour être soi, il ne faut aller contre ses passions. Dans ce cadre les passions sont plus un bienfait qu’un mal ! « On a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s’est perdu dans sa passion » écrit-il dans son roman philosophique Le Journal du séducteur (1843).
Pour Hegel (La raison dans l’Histoire, 1830), « rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion. » Seule la passion permet à l’homme de dépasser ses intérêts égoïstes, de mobiliser toutes ses énergies, de s’oublier au nom de fins qui le surpassent. Max Weber, dans Le savant et le politique (1919), adapte la formule à son approche compréhensive : « Rien n’a de valeur, pour homme en tant qu’homme, qu’il ne peut faire avec passion. » Sans passion, le monde devient froid, strictement rationnel, le charisme se routinise et se perd.
De ce trop rapide survol par un néophyte en philosophie, je retiens deux grandes oppositions. La première, la plus classique, entre ceux qui voient dans la passion un risque et ceux au contraire qui y perçoivent une opportunité. La seconde, plus discrète, mais non moins intéressante, oppose une vision de la passion comme venant du plus profond de la personne, de son être et de son corps même et une approche de la passion comme force extérieure à l’individu (force liée au social, à l’Histoire ?).
1.2 De la pathologisation des passions à la recherche du mieux-être
Cette ambivalence (la passion peut être bonne ou mauvaise) et ce paradoxe (c’est une force extérieure cultivée de l’intérieur) de la passion en philosophie se retrouve en médecine. Pour la psychologie, voire la psychopathologie, la passion revêt d’abord une connotation négative et pathologique. Sur certaines échelles d’évaluation de l’état maniaque dans les troubles bipolaires, la passion se situe dans un état intermédiaire entre la normalité et la folie (Martin, 2013, pour lire une recension ). Dans le même temps, si les psychiatres positionnent les personnes diagnostiquées comme « maniaco-dépressives » du côté de l’irrationalité, de la dépendance, les malades ; quelques médecins soulignent aussi le fait que des personnages célèbres (artistes, politiciens, hommes d’affaires, etc.) ont dû leur succès à la mise en valeur de leur comportement maniaque et passionnel. Au-delà de ces individus exceptionnels qui ont su trouver dans leurs mondes sociaux respectifs les ressources pour sublimer ces affects hypertrophiés pour développer leur « pouvoir d’agir ». La clinique de l’activité (méthode d’analyse du travail en collaboration avec les travailleurs eux-mêmes, développée par Yves Clot), voit dans le « développement du pouvoir d’agir sur le monde et sur soi-même, collectivement et individuellement », un moyen d’échapper aux « passions tristes » (selon les termes de Spinoza) du ressentiment, de transformer la confrontation au réel et au social en plaisir.
Dans la théorie du burn-out de Maslach et Schaufeli (2001), la passion, dès lors qu’elle reste raisonnable, est un signe de bonne santé, de plaisir et d’efficacité au travail. Mais si elle est excessive, elle peut épuiser peu à peu les réserves d’énergie et de motivation du salarié et le conduire, pour se protéger, à déshumaniser les personnes qu’il a en charge ou à développer une attitude cynique envers son activité. Il perd alors toute passion voire tout intérêt pour l’objet de son travail, le rôle ou la mission qui faisait sa fierté. Mais où est la limite entre « trop » et « pas assez de passion » ? Repose-t-elle sur la personnalité et l’histoire de chaque individu, sur des normes collectives construites et entretenues, avec plus ou moins d’emprise sur chacun, par les communautés de travail ? Chacune à leur façon, la psycho-dynamique du travail (développée par Christophe Dejours), la clinique de l’activité (portée par Yves Clot), la psychosociologie du travail, mais aussi la sociologie (l’approche par les dispositions et les positions ou l’approche par la situation) insistent sur le rôle de l’environnement social, de l’organisation (formelle et informelle) du travail dans la genèse et la régulation des passions.
1.3 Un objet littéraire par excellence
En littérature également, la passion est l’objet de représentations contradictoires. Niklas Luhmann (L’Amour comme passion, 1990) note par exemple « qu’à partir d’environ 1760 se multiplient les romans dans lesquels les héros présentent leur Passion comme leur nature, et s’insurgent, au nom de la Nature, contre les conventions morales de la société. » En même temps, dans les romans d’amour, la passion, en privant celui qui la subit de sa raison, en le poussant à commettre des actes répréhensibles (comme l’adultère), peut parfois être assimilée à une maladie (Cossart, Usages de la rhétorique romantique, Sociétés & Représentations, 2002). Le mot « passion » se retrouve 46 fois dans Madame Bovary de Flaubert.
Les romans d’Emile Zola sur le travail fourmillent de références à la passion : 87 occurrences du terme (ou de ses dérivés) dans l’Argent, 59 dans Au bonheur des dames, 54 dans La bête humaine, 25 dans Germinal, etc. Dans L’Argent, Emile Zola note à propos d’un des personnages : « il se disait qu’il était peut-être trop passionné pour cette bataille de l’argent qui demandait tant de sang-froid » Un autre personnage voit ses bénéfices mangés « par la passion malheureuse du jeu ». Chez Zola, la passion est comme une maladie héréditaire : « ce sont les gens les plus honnêtes qui ont à souffrir plus tard de leurs passions, ou, ce qui est pis, des passions de leurs parents ».
Un petit détour par la littérature populaire contemporaine montre la dimension genrée des jugements portés sur la passion des personnages pour leur travail. Alors que pour les hommes, l’engagement passionné dans le travail est vu comme positif – et que c’est le manque de passion qui peut devenir un problème (l’indifférence est sa seule passion, écrit Chloé Thomas à propos d’un des personnages de Nos lieux communs, 2016) – les femmes, elles, sont vues comme menacées par une trop grande passion pour leur travail qui les amputerait de toute vie privée ou affective, ce qui pourrait-être en fin de compte néfaste pour leur santé. L’héroïne de Désolée, je suis attendue (Agnes Martin-Lugand, 2016), qui va de plus en plus mal, déclare à ses proches ou ses collègues qui s’inquiètent : « J’étais passionné par mon métier, ça me suffisait. De quoi avais-je besoin de plus ? » Dans ces romans, seule la passion amoureuse pourrait guérir les femmes malmenée par leur passion pour le travail ! Le personnage de Féminine d’Emilie Guillaumin s’engage dans l’armée de façon passionnée, avant de découvrir dans la douleur que cela ne lui convient pas. Dans Brillante (2016), Stéphanie Dupays écrit : « Claire veut un métier passionnant, avec des défis à relever chaque jour ». Pour l’auteur, « le surmoi a remplacé le contremaître, la passion pour l’entreprise le pousse à s’investir avec une intensité infiniment supérieure ». Mais le jour où Claire se retrouve placardisée suite à la jalousie de sa cheffe, commence pour elle une période de souffrance et de remise en cause. Dans Les visages écrasés (Marin Ledun, 2011), Deadline (2013) de la roumaine Adina Rosetti, Open-Space (2014) de l’américain Joshua Ferris, Mauvais coûts (2016) de Jacky Schwartzmann, des femmes actives et compétentes finissent par mourir de leur passion trop exclusive pour le travail ! On le voit bien, dans le jugement différencié porté sur la passion des hommes et des femmes pour le travail, les représentations sont le fruit de normes sociales profondément ancrées. Autrement dit, la passion est aussi une construction sociale.
2 – La passion : une construction collective
La vision commune, largement confortée par les psychologues et les conseillers d’orientation, repose sur l’idée que les personnes passionnées par leur travail sont celles qui seraient parvenues à travailler dans le domaine qu’elles aiment, c’est-à-dire celui pour lequel elles « seraient faites », en quelque sorte par nature. Il leur faudrait donc découvrir, au gré des expériences personnelles ou avec une aide professionnelle, leur « vraie nature », le projet qu’ils ou elles porteraient en eux. Dans un dossier de la revue Sciences Humaines consacré à la passion, Achille Weinberg (2016, p. 37) écrit : « Voilà la formule magique de la vocation. Devenir ce que l’on est ; trouver le métier qui correspond à quelque chose de profondément ancré en soi. » Et un peu plus loin, il ajoute : « Il est des gens qui s’épanouissent parfaitement dans les emplois de soins, de service ou d’artisanat. On peut être passionné de pâtisserie, de mécanique moto aussi bien que d’élevage de chèvres ». Pour lever toute ambiguïté, il ajoute : « chacun d’entre nous est censé avoir des centres d’intérêt stables au cours du temps car lié à sa personnalité, ses goûts et ses talents ».
Se trouve résumé ici une théorie psychologique des passion qui fait des talent, des goûts et des centres d’intérêt des caractéristiques personnelles, immuables et inscrites dans chaque individu. Cette croyance innéiste est particulièrement prégnante dans le monde des arts. Pourtant, des études variées et différentes ont bien montré comment la passion (comme le talent) pour telle ou telle pratique artistique était le fruit d’un travail collectif sans lequel le jeune aspirant artiste aurait bien du mal à entretenir le feu de sa vocation, voire même à trouver sa vocation.
2.1 La passion et la vocation artistiques comme constructions collectives
Izabela Wagner (Producing Excellence. The Making of Virtuosos, 2015) a mené une étude ethnographique très fouillée sur le parcours qui a conduit certains jeunes à devenir, malgré les obstacles, un(e) violoniste soliste virtuose, appelé(e) à jouer dans les plus grands orchestres symphoniques internationaux. Pour la plupart, il semble difficile de dire que le goût du violon viendrait essentiellement d’eux-mêmes. Il résulte plutôt d’une socialisation précoce à la musique et au violon. Il s’agit d’abord de l’influence de parents musiciens, essentiellement professionnels (dans 64% des cas étudiés) et plus rarement amateurs (16% des cas). Initiés très tôt à la musique, les futurs solistes ont commencé à un très jeune âge à prendre des cours de violon (la plupart ont commencé le violon entre 4 et 6 ans). Tous, à l’exception d’une jeune femme, affirment que sans la contrainte exercée par leurs parents, ils n’auraient pas atteint un tel niveau ! Il s’agit donc d’abord d’un projet parental exprimant le souhait de voir son (ou ses) enfant(s) atteindre(nt) les positions les plus valorisées dans le monde de la musique classique. Malgré cela, les violonistes solistes virtuoses rencontrés sont nombreux à parler de « passion » et de « vocation » pour la pratique de leur art. Cette passion, cependant, est héritée, voire imposée par les parents. La passion et le rapport au travail positif doivent donc sans cesse être entretenus par différentes méthodes : gratifications symboliques (par exemple quand un morceau particulièrement difficile est maitrisé), storytelling pour rappeler l’histoire glorieuse des grands violonistes du passé dans laquelle s’inscrivent les jeunes, chantage affectif ou autoritarisme, etc. Les échecs ou abandons sont attribués au « manque de passion ». Dans le même temps, la « passion » pour le violon renvoie de façon ambivalente à la souffrance des longues répétitions, à l’engagement exclusif au détriment de la vie privée, des loisirs et de la formation générale (ce qui conduit à mettre encore plus la pression pour la réussite). Souvent également, les enfants doivent quitter l’école et suivre des cours par correspondance afin de dégager plus de temps pour la pratique du violon, mais aussi pour rester dans un monde où le rapport au travail musical reste fort, où le sacrifice de son enfance fait sens.
Arrivés à 18-20 ans, les musiciens doivent devenir plus autonomes, même s’ils gardent des contacts informels avec leurs anciens maîtres pour les plus talentueux, pour trouver des concerts, des enregistrements, des compositeurs, etc. Les dispositifs destinés aux jeunes musiciens et enfant prodiges (bourses, concours, masters classes) se font plus rares et beaucoup doivent, dans la douleur, réajuster à la baisse leurs ambitions en devenant musiciens d’orchestres, professeurs, chef d’orchestre ou premier violon dans des philharmoniques de deuxième ou troisième rang. Il leur faut donc travailler pour maintenir un rapport positif à leur travail. La passion est sans cesse à reconstruire, à recalibrer, sur d’autres bases, avec d’autres motifs et étayages sociaux, au risque de perdre la motivation et de se voir exclu(e) de la carrière musicale.
Sur un registre moins interactionniste et plus bourdieusien, le travail de Joël Laillier auprès des jeunes danseurs de l’opéra de Paris illustre aussi le rôle de la socialisation familiale et des institutions dans la production et l’entretien de la passion pour la danse des jeune élèves de l’école de l’Opéra de Paris.
« Ainsi, de même qu’ils ont des dispositions à adhérer à l’Opéra en tant qu’élite sociale, les parents font preuve de dispositions à adhérer aux dispositifs d’élection. Il est possible de relire le placement de la fratrie dans ce sens : qu’il s’agisse d’un placement dans une pratique artistique intensive ou un placement dans une élite scolaire, plusieurs parents en parlent comme le résultat du don ou du talent de leurs enfants, y voyant l’inscription dans un destin singulier exceptionnel résultant d’une vocation supposée. Les parents intermittents du spectacle font preuve de cette disposition en orientant leurs enfants vers une pratique artistique qui doit être vécue sur le mode de la passion » (Laillier, Des familles face à la vocation, Sociétés contemporaines 2011, p. 75).
Une fois à l’école de l’Opéra de Paris, des concours réguliers, la mise en avant des réussites individuelles, une auto-glorification de l’institution et de ses élèves participent de l’entretien de la passion.
2.2 Le rôle des collectifs de travail
La dimension collective de la production et de l’entretien de la passion pour l’objet du travail ne se manifeste pas seulement dans les métiers artistiques. On la retrouve aussi, par exemple dans des recherches sur le travail artisanal. Dans sa thèse consacrée au parcours d’artisans ébénistes, Thomas Marshall (La fabrication des artisans, 2012) compare deux cas emblématiques : celui de Jean-Baptiste (61 ans) et celui de Claire (24 ans). Après un CAP d’ébénisterie en un an au cours duquel Jean-Baptiste fabrique son premier meuble et éprouve le plaisir de fabriquer une belle pièce, il entre dans une entreprise qui fabrique des meubles de style, en particulier Louis XV, d’abord à un poste de monteur (assembler les pièces et faire les finitions). Il apprend en observant et en recevant des conseils de la part des anciens, ceux qui travaillent bien. Après avoir travaillé dans deux autres entreprises pour diversifier son expérience (sculpture sur bois, poste de chef d’atelier) tout en suivant en parallèle une formation aux beaux-arts, il s’installe à son compte à 24 ans et parvient rapidement à faire reconnaître son savoir-faire auprès d’une clientèle locale. A différents moments de son parcours il peut mener des réalisations dans lesquelles il trouve des sources de fierté : rénovation des menuiseries d’une ancienne tour de l’école professionnelle, achat de beaux outils pour sa caisse, premiers meubles de sa fabrication, installation, premiers meubles vendus, expansion de son entreprise (jusqu’à 20 salariés)… Ce parcours est pour Thomas Marshall « fondé sur la passion ». La transmission de la passion est un phénomène social complexe : « Le métier n’est pas un virus, la passion de l’artisan ne se répand pas de façon directe ». C’est en se rapprochant d’enseignants et de collègues plus âgés qu’il perçoit comme passionnés que Jean-Baptiste peut entretenir cette passion : « J’allais vers des gens dans le même esprit, c’est-à-dire des passionnés, des gens qui travaillaient bien », déclare-t-il en entretien. Et plus loin, il ajoute : « Quand il y avait des nouveaux qui venaient, qui étaient passionnés, je leur transmettais. » C’est le fait de pouvoir partager une certaine vision du travail avec ses collègues, un même goût pour un certain style d’ébénisterie qui permet de construire et d’entretenir collectivement la passion.
Ça ne sera pas le cas pour Claire : Elle a décroché du lycée à 16 ans et poursuit un apprentissage de menuiserie (BEP en 2 ans). Si elle est intéressée par l’ébénisterie, elle doit commencer par apprendre la menuiserie avant de pouvoir se spécialiser sur les meubles. Sa formation en alternance, notamment durant les stages, lui laisse peu de temps personnel, pour une vie sociale adolescente. Elle doit s’accrocher pour tenir le rythme et trouver des éléments de motivation sur les deux ans de formation. L’ambiance est bonne avec ses collègues et le chef d’atelier et elle prend plaisir à créer, de sa propre initiative, des petits meubles ou objets à partir des chutes de bois récupérées dans l’atelier. Mais elle a le sentiment que le travail qui lui est demandé est trop répétitif, pas assez créatif ni collectif (chacun ayant une tâche limitée et spécialisée). Elle a l’impression de faire « des trucs qui servent à rien », même si la répétition des gestes participe de l’apprentissage du métier. Surtout, elle s’entend mal avec son patron, chez qui elle loge, et à qui elle reproche de ne pas partager ses propres recherches et inventions en ébénisterie qu’il développerait « dans son coin ». Son désir d’expériences positives, enrichissantes, marquantes n’est pas comblé et la possibilité d’exprimer et d’extérioriser ce qu’elle porterait en elle lui semble insuffisante. L’absence d’un collectif de travail qui permettrait de nourrir sa passion pour la création explique au final son échec.
Ces exemples montrent bien que la passion comme la définition de ce qui est passionnant ne peuvent venir d’un individu seul, de son intériorité psychique personnelle, mais se construisent à travers la famille, les institutions, les collectifs de travail, etc. C’est le paradoxe de la passion.
2.3 Ce qui est valorisant est ce qui est valorisé
Lors de l’étude collective que j’ai dirigée sur les diplomates (Piotet, Loriol, Delfolie, 2013), un représentant permanent (l’équivalent d’un ambassadeur auprès d’une organisation internationale), pour expliquer son engagement dans le travail, précise :
« C’est naturellement passionnant parce que ce qui est intéressant, c’est justement cette approche, c’est la généralité du monde, vous voyez ce que je veux dire, vous côtoyez une variété de métiers, techniques, culturels, économiques ou politique pure, les armements, le communautaire, les télécoms, etc. Et puis également, c’est cette approche globale qu’on peut avoir, on voit vraiment le monde, les grands sujets importants pour la planète sur lesquels on a un accès ; et puis, il y a un troisième élément qui est très intéressant, je pense, dans ce métier, c’est l’accès à des personnalités exceptionnelles. »
A plusieurs reprises, au début de notre étude en 2004-2005, il nous a été donné comme exemple de « personnalités exceptionnelles » Georges W. Bush et Saddam Hussein ! Pour des personnes extérieures au monde des relations internationales, ce ne sont probablement pas les personnalités que l’on rêverait a priori de rencontrer. Toutefois, il s’agissait avant le début de notre enquête, des deux personnages les plus cités dans les pages internationales des journaux ainsi que des dossiers les plus chauds et les plus suivis de la diplomatie. Ce qui est « passionnant » en diplomatie est bien une construction sociale. La façon dont les diplomates expriment leur passion, lors d’entretiens menés avec des chercheurs sur leur métier, ne peut être dissociée de l’identité professionnelle qu’ils souhaitent présenter, de la façon dont ils veulent définir leur rôle de médiateur et d’acteur de l’Histoire. Le diplomate n’est pas un dilettante, un mondain ni un privilégié mais un professionnel qui s’investit pleinement dans sa mission ! Il est possible de parler ici d’une forme « d’expression obligatoire de la passion » (Marc Loriol, dans Le travail passionné, 2015) visant à légitimer un métier pas toujours bien compris par le public. Ensuite, les éléments de leur travail que les diplomates associent à la passion au travail ne sont pas forcément les mêmes d’une personne à l’autre et peuvent faire l’objet d’une évaluation différente en fonctions des parcours, des situations. Une même activité pourra être jugée passionnante dans certains contextes (une carrière réussie, un poste en prise avec l’actualité ou l’intérêt du ministre, etc.), mais pas dans d’autres (poste isolé, supérieur peu reconnaissant, etc.) Ce n’est pas forcément la nature de l’activité qui la rend passionnante, mais ce que l’on peut en faire, l’écho qu’elle peut avoir, la reconnaissance, ou non, par les pairs. C’est d’une certaine façon ce que dit ce rédacteur : « C’est un dossier passionnant, mais tout dossier devient passionnant dès qu’on commence à gratter un peu ». Pour être durablement passionnante, une activité doit être reconnue comme telle par des autrui significatifs. Les diplomates à la représentation permanente (RP) auprès du conseil de l’Europe (à Strasbourg) ont le sentiment de s’occuper de dossiers très intéressants (les Droits de l’Homme, la culture, les relations avec la Turquie ou la Russie, etc.), mais le fait que leur travail soit quasiment ignoré par leur administration de tutelle au Quai d’Orsay rend plus difficile l’entretien de la passion (du fait d’un héritage de l’Histoire, cette RP était suivie pour les questions de désarmement stratégique, ce qui n’est plus au centre de ses préoccupation après la chute de l’URSS).
L’utilisation du mot passion (ou de ses dérivés) ne se constate pas dans tous les métiers. Dans mes nombreux entretiens avec des policiers ou des infirmières, qui sont pourtant souvent très engagés dans leur travail, le mot « passion » n’est pratiquement jamais utilisé (deux fois sur près de 200 entretiens). Par contre, dans les entretiens menés avec des agents du ministère des Affaires étrangères, environ 80 occurrences spontanées des mots « passion », « passionnant », « passionné » ont pu être notées sur près de 120 entretiens analysés. De même, au cours des entretiens menés avec Line Spielmann auprès de salariés de Scènes de Musiques Actuelles (Smacs), la passion est présente dans presque toutes les 26 interviews. D’autres études sociologiques montrent que le terme de passion est utilisé particulièrement souvent dans les métiers artistiques (Laillier, 2011 ; Buscatto, 2015 ; Wagner, 2015, Oughabi, 2015 ; Karakioulafis, 2015), sportifs (Bertrand, 2009 Slimani, 2015 ; Honta et Julhe, 2015 ; Leroux, 2015), de l’informatique et des technologie de la communication (Vendramin, 2004 ; Murgia, 2012), de la finance et du trading (Sarfati, 2012), de la mode (Arvidsson, Malossi et Naro, 2010), du journalisme et de l’édition (Morini, Carls et Armano, 2010), de la culture, etc. Quel est le point commun entre toutes ces activités apparemment hétérogènes ? Il s’agit de carrières très individuelles et personnalisées, dans lesquelles l’accès aux postes les plus prestigieux fait l’objet d’une rude concurrence basée sur le mérite et la domination individuelle. Le rapport au travail se construit dans un registre plus personnel qu’ailleurs, autour de l’idée d’un « style », d’un engagement vécus comme individuels (même si, comme nous l’avons vu, leur détermination est largement collective). Ce sont aussi des secteurs qui demandent souvent des sacrifices personnels et où il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. La passion devient alors une forme d’auto-justification et un signe d’élection. Elle peut aussi être parfois une forme d’auto-exploitation.
3 – Une passion instrumentalisée par le management ?
Retraçant le développement d’un nouveau style de management dans la Silicon Valley, Walter Isaacson (Les innovateurs, 2016) écrit que les leaders « doivent encourager les autres à suivre leur passion et non leur donner des ordres ». Cette mobilisation de la passion et du plaisir au travail pour garantir l’engagement et la motivation des salariés, se traduit par la mise en place de formes ludiques de management, de relations informelles et décontractées. Si les grandes entreprises américaines des technologies de l’information et de la communication semblent avoir été les pionnières, ce mouvement s’est ensuite étendu à d’autres secteurs. D’après Luc Boltanski et Eve Chiapello (Le nouvel esprit du capitalisme, 1999), le capitalisme serait ainsi parvenu à récupérer à son profit la « critique artiste » du travail et la demande de sens exprimée par les salariés.
3.1 Instrumentaliser la passion et la compétition
C’est ce qu’illustre l’étude de Nathalie Leroux (Le travail passionné, 2015) sur les jeunes vendeurs des magasins Décathlon. Cette enseigne a fait le choix d’entretenir la passion sportive et le goût pour la compétition afin de susciter, dans un univers de concurrence ludique, motivation et surtravail. Décathlon embauche ainsi une population jeune, correspondant à l’imaginaire sportif des produits, et plus malléable (car sans grande expérience professionnelle antérieure). La moyenne d’âge en magasin est en effet de 28 ans. Les jeunes vendeurs sont incités à progresser dans la hiérarchie ou à partir. Cela permet à l’enseigne de maintenir une moyenne d’âge peu élevée et d’accroître les chances de promotion pour les heureux élus, augmentant ainsi l’attractivité du travail pour les nouveaux salariés fraîchement sortis du système universitaire, plus ou moins diplômés, et qui souhaitent, travailler dans le secteur du sport. Nathalie Leroux (Le travail passionné, 2015, p 213) conclue ainsi que « l’engagement sportif de ces jeunes cadres oriente en effet leur subjectivité au travail dans le sens proposé par l’entreprise et les invite à valoriser ce qui confirme le bien fondé de leurs choix antérieurs ». Mais cela se paye d’un gros investissement en travail, pas toujours récompensé en retour. Comme le dit un ancien vendeur cité par Nathalie Leroux :
Les salaires Décat sont inférieurs à la moyenne quoi qu’ils en disent… Autonome certes, si ton magasin et ton univers cartonnent, on te foutra la paix. Si on compte 66h hebdo d’ouverture plus 6h de réception et sans compter les 8 dimanches, les déménagements de nuit, les inventaires, etc., et seulement assez de vendeurs pour couvrir 75% de ces heures, je passais jusqu’à 70 heures au taf pour 1650€, donc j’ai déclaré forfait. Oui, Décat a été une super boîte pour les passionnés de sport et de commerce et le reste… du moment que vous pensez, parlez, respirez, mangez, buvez, pissez bleu. Alors là oui, vous aurez peut-être la chance de faire partie de ces non pas 25% mais 10% de “patrons” évolutifs jusqu’à ce quelqu’un le soit plus que vous…
Plusieurs travaux sur le travail dans le secteur des TIC (et dans une moindre mesure des arts) ont développé l’idée que les employeurs étaient parvenus à s’appuyer sur la passion et l’engagement des jeunes salariés pour leur activité afin d’obtenir un « travail gratuit », une valorisation extrinsèque par les employeurs de la motivation intrinsèque des salariés (selon l’expression de Mathieu Cocq, 2016). Un exemple peut être donné par le cas des programmateurs dans une petite entreprise de services Internet (Vendramin, Le travail au singulier, 2004) : surchargés de travail, ils accumulent les heures supplémentaires non payées et doivent, en plus, trouver le temps sur leurs loisirs de se former en permanence. Comme l’explique une de leur collègue graphiste : « Il y a tout le temps des nouvelles technologies, des nouvelles possibilités, donc, je pense que ça doit être une passion et qu’ils doivent être à ça tout le temps » (citée dans Vendramin). Une consultante dans une autre entreprise de services informatiques ajoute : « On ne peut pas tout avoir, avoir un métier qui est enrichissant [au sens de rémunérateur] et qui est passionnant. Par exemple, il y a des journées où, du matin au soir, je ne vois pas l’heure passer parce que ça me passionne. » Les faibles salaires, les heures supplémentaires non payées, l’absence de formations offertes par l’employeur, l’absence de syndicats et de conventions collectives sont vus par les professionnels des NTIC interrogés comme le « prix à payer » pour faire un travail passionnant (Vendramin, 2004).
3.2 Auto-exploitation et régulation de la passion
Même si le management ne cherche pas explicitement à mobiliser la passion des salariés en vue d’un surtravail, la possibilité de vivre sereinement ou non sa passion au travail dépend pour une large part de choix d’organisation. Dans une recherche menée sur les salles de concert dédiées aux musiques actuelles, Line Spielmann et moi-même avons pu constater que la régulation du rapport passionnel au travail parmi les jeunes salariés pouvait prendre des formes variables d’une structure à l’autre (Le travail passionné, 2015). Dans une première salle, les salariés font preuve d’un engagement très fort, ne comptant pas leurs heures, confondant leur vie professionnelle et leur vie privée (par exemple en allant voir des concerts ou en distribuant des tracts pendant leurs loisirs). Ils rechignent à se mettre en arrêt quand ils sont malades, n’envisageant pas de pouvoir se syndiquer, etc. Passionnés par leur travail et se percevant comme privilégiés d’être payés pour faire ce qu’ils aiment, ils se sentent toutefois insuffisamment reconnus par l’équipe de direction (plus âgée) qu’ils admirent, mais qui ne partage pas forcement la même vision qu’eux de l’action culturelle et de la musique. Cela les pousse à toujours vouloir en faire plus pour enfin pouvoir être pleinement satisfaits de leur travail, être mieux reconnus. À ce rythme, plusieurs ne tiennent pas, craquent (burn-out, dépression) et quittent la structure lorsqu’ils se sentent ouvertement désavoués par l’équipe de direction. Dans une autre salle, plusieurs conflits avec la direction et la municipalité qui finance la structure, mais aussi l’absence de perspectives de carrière pour les jeunes salariés, ont conduit à l’impression qu’un bon travail n’est pas possible et que cela ne vaut pas la peine de se fatiguer. Le directeur cumule son rôle avec celui de programmateur et laisse peu d’initiatives stimulantes à ses jeunes subordonnés. La démotivation a donc succédé à la passion (au bout de trois ans). Le ressentiment a conduit les jeunes salariés à limiter leur investissement. Certains déclarent même prendre des arrêts-maladie (alors qu’ils auraient pu venir travailler quand même) « par revanche ». La troisième salle est un peu différente. Les salariés sont presque tous dans les âges intermédiaires et partagent une vision commune de ce que doit être un « beau concert ». Ils ont connu des expériences de travail antérieures passionnantes mais très prenantes en temps et en énergie et sont heureux de pouvoir, dans leur poste actuel, combiner un travail intéressant et créatif, avec une relative préservation de leur vie privée. Les jeunes sont peu nombreux et occupent de positions provisoires (stage, CDD). Ils perçoivent leur travail comme une chance d’apprendre leur métier dans une structure dynamique et valorisante et n’entretiennent, de ce fait, pas de relations conflictuelles ou de concurrence avec la direction.
Conclusion
En conclusion, loin de n’être que l’improbable rencontre d’une vocation personnelle intrinsèque et d’un univers professionnel donné, la passion et le plaisir au travail sont des constructions conjointes complexes, objet de conflits d’intérêt et de choix d’organisation. L’autonomie et le dynamisme des collectifs de travail constituent des éléments essentiels dans la définition et l’entretien de la passion au travail. Celle-ci ne se décrète pas et le rôle du management se limite bien souvent à ne pas entraver, involontairement ou non, ces dynamiques collectives plutôt qu’à imposer de façon volontariste et artificielle une passion et un entrain que ne ressentiraient pas véritablement les salariés. La passion au travail suppose une autonomie collective réelle et des institutions fortes et légitimes pour tous. Or le monde du travail contemporain, qui individualise les parcours et les identités, délie et met en concurrence les travailleurs, ne favorise pas la construction de repères et de valeurs partagés. C’est justement pour pallier la mise à mal de la valorisation par les pairs du travail et de son objet que les managers et les spécialistes des ressources humaines en viennent à réclamer, dans une injonction paradoxale, l’engagement passionnel.
Texte initialement publié dans Bulles de Savoirs (revue en ligne aujourd’hui disparue), le 5 avril 2017, Rubrique « Sciences Sociales ».
Références
- Arvidsson Adam, Malossi Giannino et Naro Serpica, (2010), « Passionate Work? Labour Conditions in the Milan Fashion Industry», in Journal for Cultural Research, 14,3, p. 295–309.
- Bertrand Julien (2009), « Entre passion et incertitude : la socialisation au métier de footballeur professionnel », in Sociologie du travail, n° 51, p. 361-378.
- Boltanski Luc, Chiapello Eve, (1999), Le Nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard, 843 p
- Buscatto Marie (2015), « Aux fondements du travail artistique. Vocation, passion ou travail ordinaire? », dans Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 29-56.
- Clot Yves (2006), « Clinique du travail et clinique de l’activité », in Nouvelle Revue de Psychosociologie, n° 1, p. 165-177.
- Cocq Matthieu (2016), Co-création et mise au travail des joueurs : le cas d’une plateforme communautaire dans l’industrie du jeu vidéo, Journée d’études co-organisée par l’IDHES et le LISE : Le travail à l’épreuve des plateformes numériques, Nanterre le 18/11/2016.
- Cossart Paula, (2002), « Usages de la rhétorique romantique », in Sociétés & Représentations, 1, n°13, p. 151-164.
- Dejours Christophe, (1993), Travail : usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Bayard.
- Dortier Jean-François (2016), Le réveil des passions, in Sciences Humaines, n° 280, p. 25-29.
- Isaacson Walter (2015), Les innovateurs. Comment un groupe de génies, hackers et geeks a fait la révolution numérique, Jean-Claude Lattès.
- Julhe Samuel et Honta Marina (2015), « Expression et maintien de la passion au travail chez les agents du ministère des Sports. Une approche par les capacités », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 153-182.
- Kabbaj Thami (2011), Psychologie des grands traders. Editions d’Organisation.
- Karakioulafis Christina (2015), « Être acteur professionnel en Grèce : un travail de passion ou un emploi comme les autres ? », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 89-115.
- Joël Laillier (2011), « Des familles face à la vocation. Les ressorts de l’investissement des parents des petits rats de l’Opéra », in Sociétés Contemporaines, 2, n°82, p 59 – 83
- Leroux Nathalie (2015), « La mobilisation de la passion sportive des cadres dans une entreprise de la grande distribution d’articles de sport », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 183-213.
- Loriol Marc (2015), « Les diplomates et l’expression obligatoire de la passion dans le travail », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 215-244.
- Loriol Marc et Spielmann Line (2015), « Quand la passion s’emmêle. De l’investissement de soi à la souffrance dans une MJC, scène de musiques actuelles », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 117-151.
- Luhmann Niklas (1990), L’Amour comme passion : de la codification de l’intimité, Paris, Aubier.
- Marshall Thomas (2012), « La fabrication des artisans. Socialisation et processus de médiation dans l’apprentissage de la menuiserie », Thèse sous la direction de Jacques Bonnet, Agrosup Dijon, Université de Bourgogne, 316 p.
- Martin Emily (2012), Voyage en terres bipolaires. Manie et dépression dans la culture américaine, Paris, Rue d’Ulm.
- Maslach Christina et Schaufeli Wilmar (2001), « Job burnout », in Annual Review of Psychology, Vol. 52, p. 397-422.
- Morini Cristina, Carls Kristin et Armano Emiliana (2014), « Precarious Passion or Passionate Precariousness? Narratives from co-research in Journalism and Editing », in Recherches sociologiques et anthropologiques, 45-2.
- Murgia Analisa (2012), « Stories of Gender. Hegemony and Resistance in Temporary Jobs », in Gendered Ways of Knowing in Science. Edited by S.Knauss, T.Wobbe and G.Covi, FBK Press, p. 117-196.
- Oughabi Moufida (2015), « Ne vivre que de son activité de plasticien : une condition exclusive pour affirmer sa passion au travail ? », in Loriol et Leroux (dir.), Le travail passionné, éditions ERES, p 57-88.
- Sarfati François (2012), Du côté des vainqueurs. Une sociologie de l’incertitude sur les marchés du travail, Lille, Presses Universitaires du Septentrion.
- Slimani Hassen (2015), « L’économie de la passion. Formation professionnelle et turn-over des moniteurs(trices) équestres sous conditions sociales et affectives », in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 205, p. 21-41.
- Vendramin Patricia (2004), Le travail au singulier – Le lien social à l’épreuve de l’individualisation, Academia Bruylant/L’Harmattan.
- Wagner Izabela (2015), Producing Excellence. The Making of Virtuosos, New Brunswick, Rutgers University Press, 2015
- Weinberg Achille (2016), « Comment trouver sa vocation ? », in Sciences Humaines, n° 280, p. 36-39.