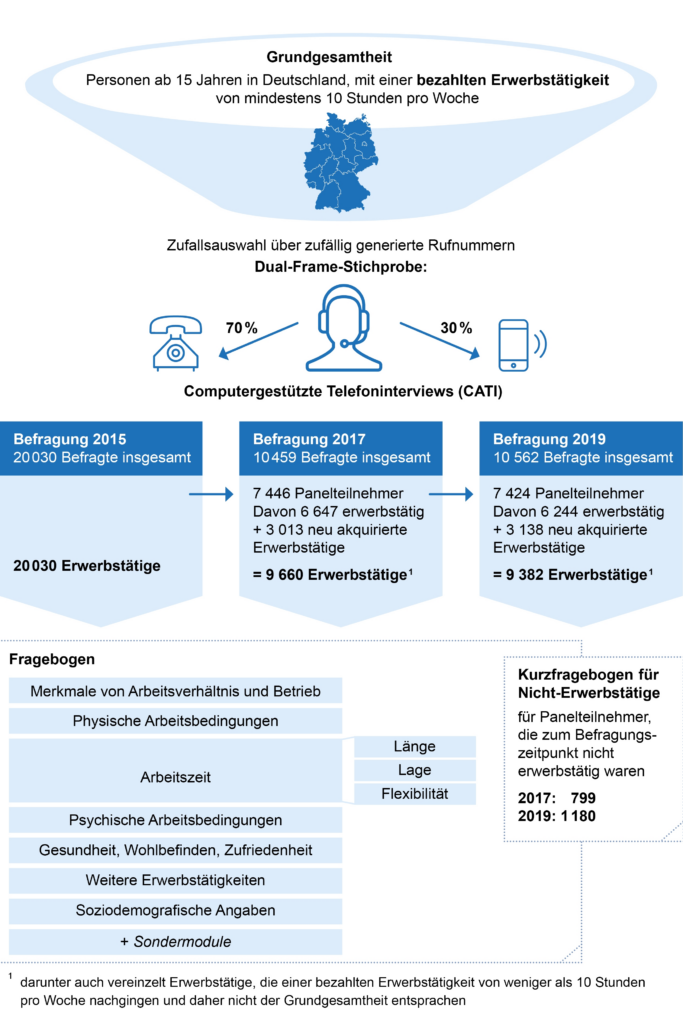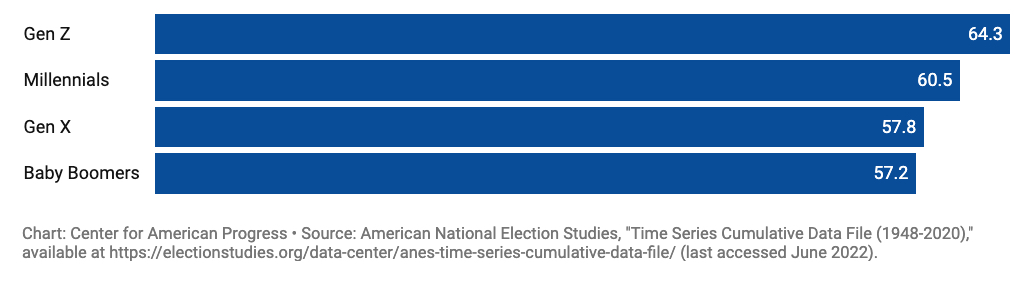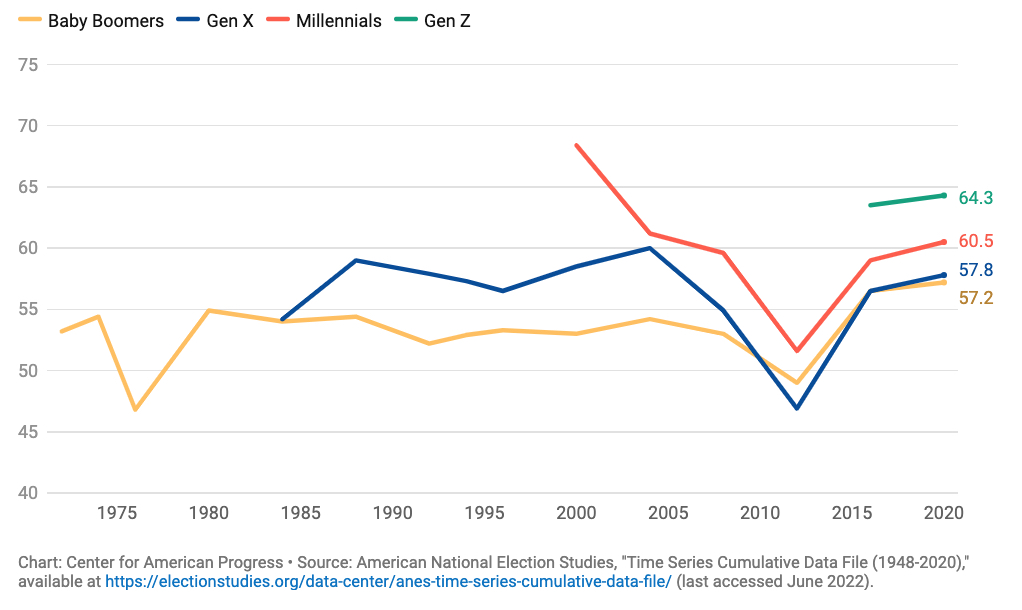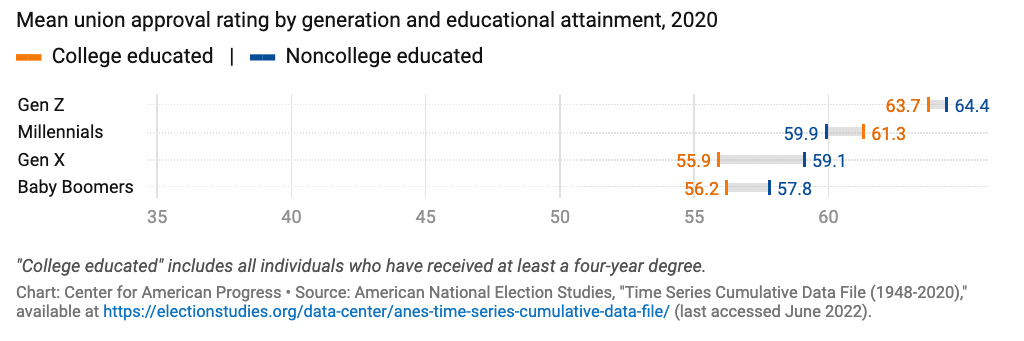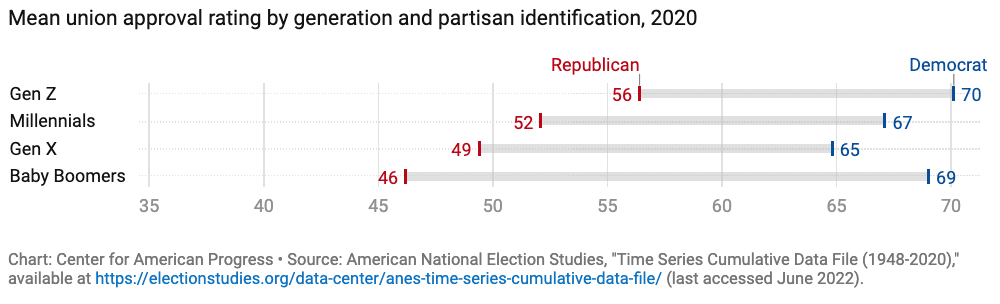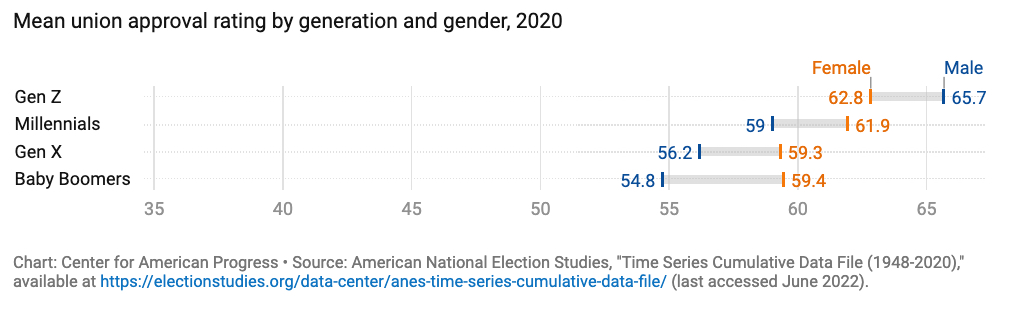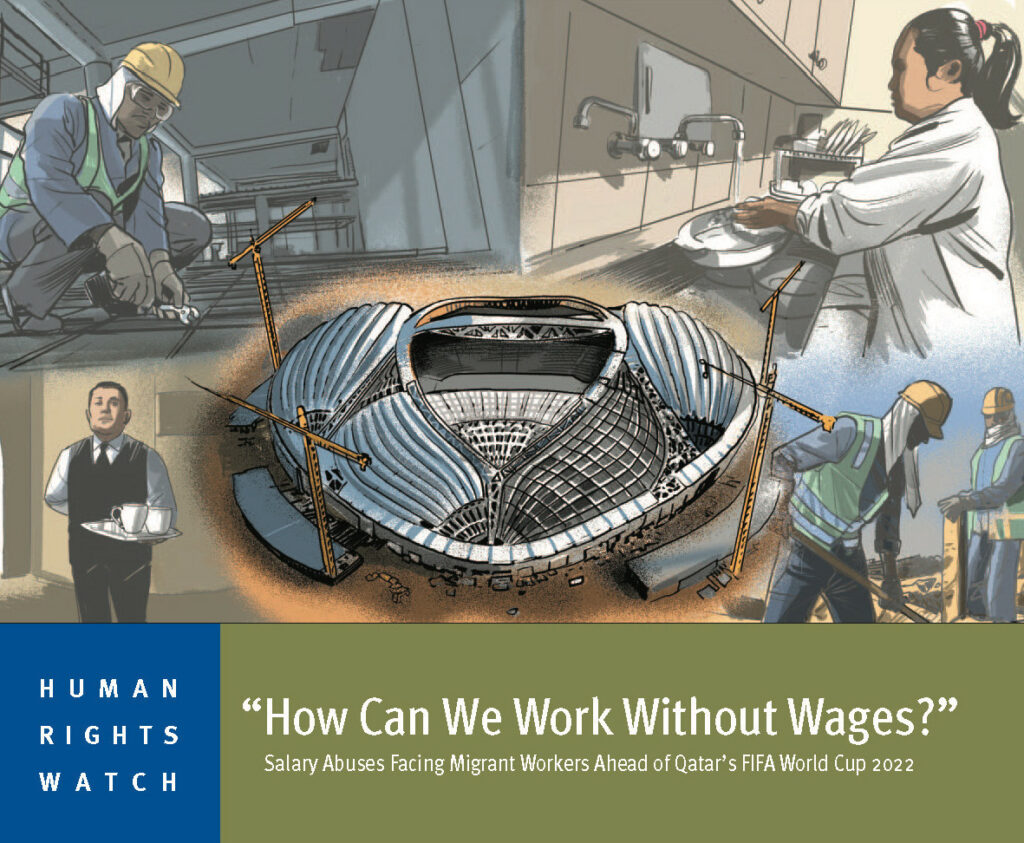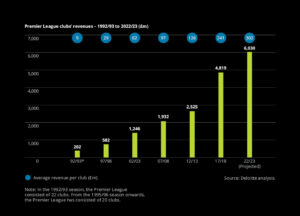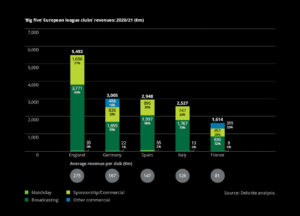Les échanges avec les travailleurs de divers ports européens, les entretiens avec des cheminots, les multiples grèves du rail au Royaume-Uni[1], etc. révèlent qu’il existe une exaspération généralisée parmi de larges secteurs du monde du travail. Ils sont en colère contre un patronat d’abord centré sur la finance, qui obtient beaucoup d’argent (de l’État) pour l’investir dans des projets d’automatisation et de numérisation. L’inflation est également un problème majeur. Les échanges suivants ont eu lieu après les arrêts de travail du mois de mai et juin 2022.
D’où vient la volonté actuelle de faire grève chez les dockers ?
Il s’est passé quelque chose d’important lors du cycle de négociations « tarifaires » (négociations sur les salaires) de l’année dernière (2021). Le lundi de Pentecôte, un jour de congé, les employeurs ont dû annuler un certain nombre de workshifts (postes) parce que de nombreux travailleurs de Hambourg et de Bremerhaven avaient refusé de s’inscrire (ce qui se fait sur une base volontaire). Ce genre de chose n’a jamais eu lieu. Ensuite, lors du troisième ou quatrième cycle de négociations tarifaires, les employeurs ont fait une proposition d’augmentation que la Commission syndicale de négociation collective a acceptée. Mais les travailleurs ont critiqué l’accord, le jugeant en deçà du minimum acceptable ; ils s’attendaient à ce qu’il y ait au moins une autre grève d’avertissement afin d’obtenir plus ; ce qui n’a pas été le cas.
Je pense que l’une des clés du succès a été un clip vidéo qui a circulé sur divers canaux de médias sociaux avant la Pentecôte, notamment sur Whatsapp, et quelqu’un l’envoyait toutes les cinq minutes à d’autres. Dans la vidéo, 20 dockers disent l’un après l’autre pourquoi ils n’iraient pas travailler le lundi de Pentecôte. Des jeunes aux moins jeunes, l’un disant qu’il avait piscine, l’autre qu’il avait envie de revoir son frangin, l’autre en disant qu’il fallait respecter les traditions – un jour férié est un jour férié. C’était encore un moment marqué par le Covid, et tout le monde avait ce sentiment de communauté. Cette confiance collective en soi n’avait pas existé depuis longtemps, et voilà qu’elle est soudainement revenue. Cela a un effet mobilisateur énorme dans chaque conflit qui a suivi : « Ensemble, nous sommes forts et rien ne pourra nous arriver ». Notre force est collective et nous voulons l’utiliser. C’est pourquoi nous voulons faire grève maintenant, et nous voulons montrer aux employeurs : « Ne mettez pas d’autres projets stupides en route et nous sommes là et nous sommes solidaires… ». C’est pour cela que les dockers ont voulu faire grève.
L’année dernière, lorsque les gens se sont engagés dans le work-to-rule et ont refusé les heures supplémentaires pourtant attrayantes grâce au sursalaire, il y a eu une grosse alerte ! Qu’il s’agisse des confinements ou de ce navire bloqué dans le canal de Suez ou des porte-conteneurs bloqués au large le trafic, tout le monde a pu voir que le système déraille. Et c’est encore pire aujourd’hui ! C’est pourquoi le sentiment que le collectif de travail a du pouvoir et doit l’exercer a gagné les esprits.
À l’époque, la Commission syndicale a demandé pourquoi pas une seule grue à conteneurs ne fonctionnait au terminal de Tollerort. Je parle d’avant l’action spontanée du lundi de Pentecôte ! Et bien la réponse était simple : Il n’était pas possible de décharger le navire car il n’y avait pas assez de personnel. C’est un phénomène qui se reproduit régulièrement au terminal de Tollerort dans le port d’Hambourg. Actuellement, il n’est pas possible de mettre en route le déchargement en deux postes (6h-14h et 14h-22h) tant que le personnel de la première équipe fait quatre heures supplémentaires et que le personnel de la seconde équipe nocturne fait quatre heures supplémentaires. Ce principe est actuellement pratiqué car tant la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) et GHB (Gesamthafenbetriebs-GmbH) manquent de bras pour gérer les navires.
Manifestement, les actions n’ont pas encore réussi à imposer aux employeurs de céder et de changer les choses. Le port assez de bénéfices et en même temps, ils auraient besoin d’embaucher de nouvelles personnes. Comment expliquer ce paradoxe ?
Il faut bien voir que dans cette crise des ports et de la logistique mondiale, tout le monde gagne de l’argent, sauf le consommateur qui doit le payer plus par l’inflation des prix. Les expéditeurs font d’énormes bénéfices parce que les conteneurs sont en nombre insuffisant. Il y a partout des navires pleins qui ne peuvent pas être déchargés. Les services de gestion des terminaux portuaires s’enrichissent facilement parce qu’ils ont convenu dans leurs contrats qu’un conteneur qui reste en attente plus de deux jours coûte de l’argent en termes de stockage. En ce moment, tous les conteneurs sont en attente de plus en plus longtemps. Normalement, la maintenance d’un grand porte-conteneurs COSCO (avec environ 10 000 conteneurs !) se fait à Tollerort en deux jours et demi. Mais actuellement, il est impossible de le faire en moins de cinq jours. Le dernier sur lequel on a travaillé en a pris six. Il y a un navire de 400 mètres à quai en ce moment – nous aurions besoin de deux jours et demi avec normalement 6000 mouvements. C’est un programme fixe, c’est la norme. Nous voyons arriver deux ou trois navires COSCO par semaine. Maintenant ils restent bloqués à quai alors que le suivant attend encore au large.
La direction avait l’habitude de dire que si nous avions besoin de trois jours pour décharger tel navire, plus aucune compagnie maritime viendrait encore à Hambourg parce que nous serions beaucoup trop improductifs. Maintenant, la direction appelle COSCO et expliquent : « On est désolé, nous ne finirons probablement pas d’ici demain parce que nous avons eu reçu ces deux autres portes-conteneurs hier… ». Avant, vous ne pouviez pas faire ça au client.
Aujourd’hui, c’est seulement 24 heures avant l’arrivée du navire que le camion ou l’opérateur de fret reçoit le feu vert pour livrer les conteneurs au port. Avant, on pouvait toujours livrer – le conteneur était emballé et on pouvait le mettre sur le terminal portuaire. Mais les installations sont tombées en panne. Il ya un nombre croissants de conteneurs fantômes. Soit ils auraient du être déchargés dans un autre terminal, soit ils n’ont jamais été livrés au transporteur et au final, leur code de routage est sorti du système. Lorsque les conteneurs restent trop longtemps sur les quais, cela bloque la productivité – et en plus, il y a des chargements qui ne sont pas du tout enlevés. Et puis il y a aussi les « cargaisons russes », dont personne ne sait quand, où et comment. Cela devient aussi de plus en plus fréquent. Personne ne sait plus ce qui se passe.
Il faut savoir que la société portuaire de Hambourg/Bremershaven ne réalise pas seulement des « revenus de stockage » élevés grâce à la durée moyenne supérieure de stockage mais qu’en même temps, sa filiale de fret ferroviaire Metrans est également extrêmement rentable, aussi parce qu’elle emploie des conducteurs de train hors convention collective. En même temps, Metrans cherche à se restructurer et à s’automatiser.
Que disent vos collègues de l’automatisation ? Est-ce que cette menace est une autre raison qui explique la disponibilité élevée pour la grève ?
Je le ressens très fortement à Burchardkai (un quai de déchargement faisant partie du terminal), qui est en plein dans ce processus de transformation, où précisément ce monde de dockers manutentionnaires et cette façon de travailler dans lesquels les travailleurs se sont installés professionnellement – et dans lesquels ils vivent très bien – est en danger. La direction n’est pas capable d’expliquer son projet CTX, de manutention automatisée des conteneurs. Elle vient de réunir à nouveau les cadres dans des séminaires de formation et a essayé de leur faire comprendre, pour la énième fois, à quel point ce projet est important, qu’il tiendra la route et tutti quanti. Mais ce projet représente une menace du côté des opérateurs et il nourrit la colère; qui est aussi fondé sur un sentiment d’impuissance car la direction n’est pas capable de présenter ce projet avec précision. Sur le plan technique, quelles assurances avons-nous que cela va fonctionner avec des conteneurs qui font 20 ou 30 tonnes, pas tous chargés à 100 % ni avec les mêmes contenus. Est-ce que le traitement automatique va fonctionner réellement ? Beaucoup d’informaticiens s’auto-illusionnent sur ce plan. Ensuite, elle ne peut même pas déterminer exactement combien de personnes seraient « licenciées » ni même si des personnes seraient « licenciées » parce qu’elle s’est complètement trompée sur la conjoncture économique, comme elle l’a fait tant de fois auparavant. Et dans cette situation, les collègues sont très remontés et frustrés pour le déni de leurs compétences.
Il est également difficile de comprendre qui seront les larbins de l’automatisation ? On voit ces cadres courir d’une réunion à l’autre; ce sont toujours de nouveaux visages, très instruits, élégamment habillés, mais très différents du docker au sweat à capuche. Ils portent leurs costumes de marque mais ne connaissent rien du travail réel. En attendant, on a l’impression que ces types contrôlent l’avenir de tout le groupe HHLA.
De quelles entreprises proviennent-ils ? Des entreprises d’automatisation ?
Ce sont des employés de HHLA. Ce sont des responsable des projets de digitalisation. HHLA cherche des informaticiens sans fin, car il n’y en a pas assez pour traiter les problèmes du traitement des bases de données, délais, horaires, chargement, etc. Partout, vous avez besoin de personnes qui peuvent maîtriser cela à chaque moment. Mais ce sont justement ces programmes qui ne fonctionnent pas. De même, avec l’automatisation, lorsqu’on constate qu’il y a encore un problème ici et un problème de ce côté-là ils nous disent « Oh, nous n’avons pas pensé à cette éventualité et nous n’avons pas pensé à cela et ceci qui explique pourquoi cela ne fonctionne pas… ». Vous avez besoin de personnes qui ont le savoir-faire opérationnel pour faire cela. Sans eux, il n’y a pas d’algorithme qui puisse fonctionner même en analysant les métadonnées. Mais la direction n’arrête pas de racheter des start-ups qui développent à peu près tout ce qui a trait à l’automatisation…
Ils ont même un système moyennement fonctionnel qu’ils pourraient utiliser – le système de stockage en bloc du CTA [Container Terminal Altenwerder]. Quand ils ont voulu le transposer au quai Burchard, la direction de ce terminal a réagi en disant : « Ah non, nous on va faire quelque chose nous-mêmes ». Il leur a ensuite fallu deux ou trois ans pour mettre en place quelque chose qui ne fonctionne pas mieux…
J’appelle cela la « mégalomanie hanséatique », avec cet impératif où il faut sans cesse développer quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelqu’un qui dit avoir une meilleure idée. Puis il arrive et ça part à vau-l’eau – ce qui coûte toujours beaucoup d’argent. C’est aussi le fétichisme de la grande taille : le nouveau terminal de HHLA, qui a toujours été productif – hautement automatisé et à la pointe de la technologie, bien sûr – est malheureusement situé derrière le pont Köhlbrand. Le problème est que les navires sont devenus si grands qu’ils ne peuvent pas passer sous ce pont. La HHLA a encore fait un excellent travail à ce sujet ! Désormais, les grand navires doivent être déchargés sur nos anciennes installations, plutôt que sur les installations plus automatisées.
Impressions de la plus grande manifestation de travailleurs portuaires depuis 1978
La première grève d’avertissement dans les ports nord-allemands de Hambourg, Brême, Bremerhaven, Emden et Brake a eu lieu le 9 juin 2022 et a duré quatre heures et demie. La seconde, le 23 juin, a duré 24 heures. Selon le syndicat Ver.di, plus de 8 000 travailleurs portuaires y ont participé.
C’est une action impressionnante qu’ont menée les dockers en juin. Le syndicat Ver.di avait espéré mobiliser environ 3 000 travailleurs pour la manifestation de grève de la Sandtorkai. C’est le nombre de personnes qui étaient peut-être présentes au début de la manifestation, à 9 heures mais ensuite, les gens ont afflué de partout, et au final, ils étaient bien plus de 4 000.
Au début, il y avait beaucoup de feux de Bengale et beaucoup, beaucoup de drapeaux Ver.di. Les organisateurs ont annoncé par haut-parleur que les gens devaient arrêter les feux d’artifice en raison des conditions convenues avec la police. Mais cela n’a pas pu être appliqué. C’est surtout au Jungfernstieg [un boulevard avec des commerces pour les revenus élevés, NdT] et devant la gare centrale que les feux d’artifice ont continué à retentir et à se brouiller. Ici, la police a bloqué la manifestation avec une cohorte de motards et une centaine d’hommes et a menacé de la disperser.
Des travailleurs d’autres secteurs du port, qui sont officiellement externalisés (par exemple, les équipes de maintenance de l’entreprise, les travailleurs de l’amarrage, qui travaillent dans des unités de négociation distinctes mais dont les contrats sont « liés » au contrat collectif de Ver.di après les grèves du printemps 2021), ont également participé à la manifestation. Il y avait aussi des gilets avec des inscriptions d’entreprises, que je ne connaissais pas du tout. Et aussi beaucoup de « cols blancs » qui craignent les restructurations.
Les discours étaient très chargés en émotion. Cela est dû, semble-t-il, au fait que tant de personnes sont venues et n’ont pas cédé aux instructions de la police. Certains organisateurs avaient « les larmes aux yeux ». Ils étaient dépassés par la dynamique de la manifestation et par la spontanéité des masses. Il ne s’agissait pas d’une manifestation ordonnée, mais d’une masse qui se frayait un chemin dans les rues et qui, lorsqu’elle en avait la possibilité, occupait tout l’espace disponible, les trottoirs et les ruelles opposées.
Lors d’un rassemblement syndical intermédiaire, il a été souligné qu’il s’agissait de la plus grande grève des dockers depuis 1978[2]. En cas de réussite, elle aura également une grande signification pour d’autres entreprises, pour l’ensemble du secteur de la logistique. Elle pourrait être le signe qu’il existe une ferme volonté de résistance des travailleurs à la perte de leur pourvoir d’achat à cause de l’inflation et des salaires trop bas. Lors du rassemblement final, un délégué syndical a déclaré que « nous, les travailleurs pourrions paralyser toute l’Allemagne et faire de ce pays à bas salaires un pays où les salaires sont décents.»
Tout cela est très radical sur le plan verbal. Pour moi, la question s’est posée plus tard de savoir dans quelle mesure la grève d’avertissement avec la manif pourtant puissante serait peut-être qu’un simple exutoire et si les dockers peuvent vraiment faire respecter leurs revendications ambitieuses, notamment la liaison automatique des salaires à l’évolution des prix, et donc à l’inflation) en se mettant en grève, en s’appuyant uniquement sur le réseau de délégués syndicaux de Ver.di dans les entreprises. Le département fédéral du syndicat pour les ports, qui dirige également les négociations, est très orienté vers une logique de partenariat social et a plutôt été contraint à accepter des grèves d’avertissement par les comités locaux ou d’entreprise qui sont prêts à s’engager dans l’épreuve de force et qui siègent également dans les commissions de négociation collective, notamment au niveau des différentes entreprises.
Epilogue
En définitive, nous avons appris que Ver.di et l’Association patronale des opérateurs portuaires allemands ont conclu un accord fin novembre, avec un effet rétroactif jusqu’au 1er juillet 2022, qui augmente les salaires de 9,4 % dans les «opérations de conteneurs complets» et de 7,9 % dans les manutentions portuaires conventionnelles et générales. À partir du 1er juin 2023, les augmenteront à nouveau de 4,4 %, l’inflation pouvant atteindre 5,5 % en 2023.
Le chemin de fer de l’enfer
Les choses ne semblent pas aller très bien pour le transport de fret par rail. Alors que les patrons des chemins de fer ont réduit le réseau ferroviaire allemand de 15 % depuis 1995, le trafic de passagers sur les voies a augmenté de 43 % et le trafic de marchandises de 83 %. Derrière le « chaos ferroviaire » actuel se cache des décennies de sous-financement, une privatisation rampante et une ignorance folle à propos de l’usure des infrastructures. Lorsqu’il s’agit d’accidents prévisibles et prédits par les cheminots -– notamment aux goulets d’étranglement – la Deutsche Bahn cherche des boucs émissaires, de préférence au niveau le plus bas. Ces dernières années, les travailleurs de maintenance se sont vus confier de plus en plus de tâches. En outre, les employés des centres de contrôle des signaux sont responsables de jusqu’à 400 kilomètres de voies et, grâce au passage à des centres de contrôle numériques, les répartiteurs sont responsables de gares situées à des centaines de kilomètres.
La part du fret transporté par rail en Allemagne est inférieure à 20 pour cent, et a même diminué ces dernières années. En 1950, cette part était encore de 50 pour cent. Selon les estimations, plus de 50 milliards d’euros seraient nécessaires pour étendre le réseau afin qu’un quart de toutes les marchandises puissent être transportées par le rail d’ici 2030. Les deux plus grands projets ferroviaires, Stuttgart 21 et un deuxième tunnel de S-Bahn à Munich, sont de plus en plus coûteux et sont retardés de plusieurs années. Le plus grand projet européen, le tunnel sous le Brennerpass, vers l’Italie, ne pourra probablement être pleinement opérationnel que dans dix ans, car les lignes d’alimentation près de Rosenheim n’ont même pas encore été planifiées. Ce n’est donc pas différent du Royaume-Uni où les compagnies ferroviaires ont tenté de faire passer un programme de réduction drastique des investissements (- 34 %) doivent être « économisés » dans la seule maintenance des infrastructures.
Pour le capital, les coûts de la main-d’œuvre sur les rails sont plus élevés que pour les camions. Les wagons de marchandises doivent être collectés individuellement ou par petits groupes, puis désaccouplés dans des gares de triage spéciales et amenés à destination. Il y a encore beaucoup de wagons différents pour les différents produits en vrac. On y travaille donc à la conteneurisation, ce qui réduirait les opérations d’attelage. L’attelage est toujours fait à la main – ici, on travaille davantage sur l’ « attelage automatique » piloté de façon numérique[3].
Il y a six ans, M. Grübe, alors PDG de la DB, prévoyait des locomotives « entièrement automatisées » en 2022 – mais en 2022, des trains sont annulés parce qu’il y a beaucoup trop peu de conducteurs de train…
« Le manque de personnel » est le fil conducteur des extraits suivants de conversations avec un conducteur de train de marchandises et un employé d’un centre de contrôle. Ces entretiens ont eu lieu au cours de la première quinzaine de juillet 2022.
Un conducteur de train de marchandises dans le nord de l’Allemagne
Au cours des dernières décennies, des sommes énormes ont été investies dans les « infrastructures », y compris les chemins de fer, si l’on pense, par exemple, aux onze milliards qui ont été dépensés dans la réduction de la taille de la gare de Stuttgart. Dans le même temps, le réseau ferroviaire se dégrade de plus en plus. Dépense-t-on mal l’argent ou n’a-t-on plus les moyens d’apporter des améliorations fondamentales ? Ou est-il possible que les deux soient vrais ?
Les deux. En raison du faible niveau d’investissement, les entreprises de construction ferroviaire sont probablement devenues de plus en plus petites au cours des dernières décennies. Leur principal problème, à mon avis, était qu’elles ne réunissaient jamais tous les corps de métier nécessaires pour travailler sur une voie en une seule fois ! Ce que le ministre des Transports, M. Wissing, annonce maintenant concernant les nombreux investissements censés améliorer l’infrastructure, ils l’annoncent depuis dix ans. Entre-temps, il a toujours fallu rafistoler les choses.
L’infrastructure ferroviaire s’est détériorée de plus en plus Un peu comme un processus rampant. Pouvez-vous me dire quelles décisions politiques ont provoqué des coupes les plus importantes dans ce processus de dégradation ?
À l’Est, il s’agissait clairement de l’impact de la réunification au début des années 1990. À l’Ouest, la rentabilité de chaque aiguillage et de chaque ligne secondaire a été constamment vérifiée à partir des années 1960. La privatisation a accéléré ce processus.
Ceci est contraire à tout ce qui concerne le trafic routier ; puisqu’il il n’est pas question de vérifier la viabilité économique de chaque route secondaire. Il est simplement clair que tout le monde a tendance à avoir droit à une route pavée qui va jusqu’à sa porte. Dans les années 1980, ils se sont concentrés sur les lignes ferroviaires à grande vitesse (Hanovre-Würzburg), mais le processus était encore assez lent. La privatisation a été un tournant qui visait avant tout le statut des travailleurs.
Les économistes d’entreprise n’ont jamais compris qu’un réseau ferroviaire fonctionnel exige une certaine taille et une certaine flexibilité, du moins si l’on veut obtenir davantage du chemin de fer que juste des lignes ferroviaires à grande vitesse capables de concurrencer le trafic aérien. C’était la tâche de Mehdorn [ancien patron de la Deutsche Bahn], et il l’a remplie avec succès. Tout le reste n’était que du lest pour lui.
Les choses n’ont cessé de se dégrader depuis environ cinq ans. Actuellement, on peut clairement voir qu’ils investissent et que l’état des voies s’améliore. Ce qui manque encore, cependant, ce sont des voies supplémentaires qui élimineraient réellement les goulets d’étranglement. Il n’y a pas de progrès à ce niveau.
Comment tentent-ils de remédier à la pénurie de personnel ?
L’énorme problème de personnel est le résultat du manque de formation. Actuellement, ils essaient de recruter des personnes par le biais de formations courtes, par exemple en les formant à la conduite d’un seul type de locomotive. Mais ce personnel est donc très peu flexible car il n’a pas tout appris ! Il faudrait alors les envoyer en formation complémentaire, par exemple pour d’autres types de locomotives, mais ils n’ont pas le temps pour cela car on a besoin d’eux dans les opérations courantes. Je suis moi-même dans le métier depuis longtemps, mais j’ai perdu beaucoup de connaissances sur les trajets ces dernières années parce qu’ils ont constamment besoin de vous quelque part pour combler les lacunes et qu’il n’y a pas de temps pour la formation continue. [La formation continue consiste à parcourir le trajet accompagné par un formateur et ce à trois reprises durant le jour et trois fois pendant la nuit. Ce n’est qu’ensuite que vous êtes autorisé à parcourir cet itinéraire vous-même ; si vous n’avez pas parcouru l’itinéraire pendant deux ans, vous devez tout recommencer. Aujourd’hui, je n’acquiers la connaissance des itinéraires que « spontanément », en raison des nombreuses déviations dues à la fermeture des voies.
Le travail est-il devenu plus stressant ?
Dans l’ensemble, j’ai l’impression que depuis que la pénurie de conducteurs de train est devenue si évidente, la prolifération d’entreprises externalisées mal payées a considérablement diminué.
Par rapport aux camionneurs, nous avons un travail plutôt bien payé et peu de stress, même dans la société ferroviaire privée où je travaille. Ce qui ennuie le plus les gens, c’est que les horaires de travail sont si difficiles à planifier. Avec toutes ces annulations et ces reports, on peut difficilement savoir quand on sera de retour à la maison, il faut toujours tenir compte du jour et demi qui suit le travail.
En revanche, il est devenu beaucoup plus inefficace ! Le réseau est complètement occupé – même la nuit. Et les choses se passent souvent mal… Lorsque vous commencez à travailler, le train n’est pas là, soit parce qu’il n’a pas franchi la frontière, soit parce qu’il n’a pas terminé son chargement et doit attendre un conteneur important. Parfois, il manque aussi la locomotive. Je dirais qu’en ce moment, seule une équipe sur cinq fonctionne normalement.
A quoi ressemble de tels changements ?
Dès que le train arrive et que je me suis assuré que la locomotive est en état de marche, je me présente au dispatcher (l’organisateur des services et du flux). Il informe ensuite le centre d’exploitation. La plupart du temps, les horaires sont juste du papier brouillon ; les trains ne circulent pas selon l’horaire prévu. Si vous avez 23 heures de retard, vous pouvez encore rouler, mais si vous avez 24 heures de retard, vous recevrez un nouvel horaire. Ils font tout pour que vous partiez en premier, parce qu’ils veulent que vous sortiez de la gare et parce qu’il y a trop peu de voies. Si les choses se bloquent, ils vous mettent sur une voie d’attente sur la ligne. Mais une fois que vous êtes en marche, ils vous font généralement passer. Même en fonctionnement normal, il faut de temps en temps laisser passer un ICE [train à grande vitesse], et les endroits où il faut s’arrêter et attendre changent constamment. Il faut qu’il y ait un gros problème pour que vous deviez attendre plus d’une heure. En revanche, les arrêts et les départs sont monnaie courante, surtout aux carrefours ferroviaires importants.
Ce qui, bien sûr, est une catastrophe d’un point de vue écologique !
Bien sûr. On essaie de rouler peut-être à 40 km/h, pour que le train roule de manière constante, pour éviter les stop-and-go. J’aimerais avoir beaucoup plus d’informations : Qui se trouve devant moi ? Ainsi, je pourrais m’y adapter. Mais la DB-Netz (le gestionnaire de l’infrastructure) manque aussi de personnel ; elle a même un énorme problème de personnel. Ces derniers temps, cela se traduit de plus en plus par le fait que les horaires ne sont pas prêts – et sans horaire, nous ne pouvons pas partir, même si tout le reste est réglé !
Devez-vous souvent enfreindre les règles pour accomplir votre travail ?
On tente de plus en plus souvent de nous faire prolonger nos heures de travail au-delà des lois sur le temps de travail, déjà extrêmement flexibles, pour que le train puisse encore arriver. Les dispositions minimales de la loi sur le temps de travail sont elles-mêmes beaucoup très grossières : on peut nous demander des périodes de travail de 14 heures, dont 10 heures peuvent être du temps de conduite, et même ça pourra être prolongé s’il existe des accords d’entreprise à ce sujet. Il m’arrive de m’y plier lorsque cela me convient, par exemple lorsqu’une équipe de nuit devient une équipe de jour détendue en raison d’un retard. Dans ce cas, le poste initial est payé intégralement comme un poste annulé, même si vous attendiez en fait – endormi, mais avec votre téléphone à côté de vous.
Il y a beaucoup de collègues qui veulent accumuler des heures sans contrepartie. C’est une bonne idée si vous avez un travail à longue distance, car vous ne rentrerez pas chez vous de toute façon. Ce n’est pas le cas de la Deutsche Bahn, où les trains sont garés quelque part et où l’on appelle des taxis pour vous ramener chez vous. Ils sont généralement plus proches de chez eux que nous.
Et si quelque chose arrive, c’est toujours la faute des gens ! Comme à Garmisch [accident ferroviaire] – est-ce qu’il y une « culture de la peur » croissante à la Deutsche Bahn ?
Oui, mais c’est aussi pour cela que j’ai l’impression que les collègues sont assez prudents, car il est clair pour tout le monde qu’en cas de doute, vous serez rendu responsable des accidents. L’EBA (Autorité fédérale des chemins de fer) est également responsabilisée, mais elle manque cruellement de personnel. Dès qu’ils ont des informations, ils sont sur le dos des entreprises gestionnaires du transport.
Comment parlez-vous entre vous de ce chaos ?
Il s’agit plutôt d’une ambiance latente, d’un l’esprit. C’est rarement discuté politiquement.
Comment vos collègues réagissent-ils à la situation ? Est-ce qu’il y a des démissions, des collègues qui quittent leur emploi ?
Je constate que de plus en plus de collègues réduisent leurs horaires, d’autres se lancent dans le transport de passagers car c’est plus facile à planifier. Il est rare que les gens tournent directement le dos au chemin de fer. Certains essaient de s’éloigner des rails en devenant formateurs. Beaucoup, comme moi, viennent d’emplois plus minables et restent. Surtout dans le transport de marchandises, il est de plus en plus fréquent que des individualistes totaux exercent ce métier : ils n’ont pas de famille, à peine intégrés socialement…
Le point de vue d’une travailleur d’un centre de contrôle ferroviaire en Autriche
À quoi ressemble votre travail ?
Ce qui a été une grande surprise pour moi : nous avons une journée de douze heures. L’équipe de jour va de 6 heures à 18 heures et l’équipe de nuit de 18 heures à 6 heures. Il faut être très ponctuel, également pour des raisons de droit du travail ; un règlement stipule la responsabilité personnelle des équipes.
Je suis assis devant l’ordinateur avec onze écrans qui me montrent les voies, les aiguillages, les trains, les canaux de communication, etc. Je dois communiquer beaucoup. Je communique par radio avec les conducteurs de train. Ils m’informent en disant : « Prêt pour le shuntage[4] ! » Puis je dis : « OK, go ! » Le conducteur du train me contacte par radio : « Locomotive prête ! » J’appelle le coordinateur du fret : « J’ai la locomotive 55076. » Il dit : « Oui, entrez ! » Je dois régler les aiguillages et les signaux, c’est-à-dire le chemin de manœuvre. Les trains vont ensuite dans le bâtiment de réception de la gare de triage. Là, ils reçoivent d’autres ordres. Ensuite, je suis responsable de la coordination des manœuvres. Je dois me coordonner avec les zones voisines. Je guide les locomotives et je discute avec mes collègues pour savoir quelle locomotive va arriver.
Combien de fois faites-vous une pause ? Avec tous ces écrans devant soi, ne se fatigue-t-on pas plus vite ? Existe-t-il des périodes de repos prescrites par la loi dans un poste de douze heures ?
C’est une histoire amusante. En théorie, bien sûr. En pratique, non. Il y a des jours, par exemple lorsqu’il y a beaucoup de chantiers de construction, où vous travaillez de 6 heures du matin à 5 heures du soir sans pause. En fait, vous devez être au travail tout le temps. Il n’y a pas de pause-café ou repas.
Connaissez-vous des moments de pause et de décontraction ?
Non. La plupart du temps, cependant, comme vous avez des trous dans votre quart de travail – avec le temps, vous savez quand ils sont là et vous pouvez aller fumer, par exemple. De plus, nous ne faisons que trois quarts de travail par semaine par personne. Tout le monde apprécie le fait de ne travailler que trois fois par semaine. Lorsque nous disons que douze heures, c’est trop long, la seule chose qui vient à l’esprit de la direction est de passer à une semaine de cinq jours – et personne ne veut cela.
Qu’en est-il de l’automatisation ?
Il y a environ 15 ans, il a été annoncé que nous devions rationaliser et automatiser. Il y avait l’idée d’un système décentralisé. Cela ne s’est pas produit ; l’idée centralisée a prévalu. En Autriche, le trafic ferroviaire doit être contrôlé à partir de cinq sites – à partir des BFZ, les centres de contrôle des opérations. Le centre où je travaille a été reconstruit en 2008. Jusque-là, il y avait encore des aiguilleurs qui réglaient les aiguillages à la main. Le travail dans le département des manœuvres, que je fais maintenant seul, était effectué par cinq personnes jusqu’en 2008. Et dans le passé, vous n’étiez responsable que de votre propre gare. Aujourd’hui, votre collègue n’a pas qu’une seule gare sous sa responsabilité. S’il s’agit de grandes gares, il devra en gérer trois ; s’il s’agit de petites gares, il en aura cinq ou six. C’est à peu près la dimension de l’automatisation – cinq pour un.
Les ÖBB (chemins de fer autrichiens) sont-ils encore bénéficiaires ?
Tout le monde dit : « Nous sommes une entreprise d’État. » Si je compare ça à mon précédent emploi dans un entrepôt de vente : Quand ils ont commencé à faire des coupes, je pouvais facilement souligner la contradiction : ils avaient fait des bénéfices records l’année précédente et maintenant ils veulent supprimer des gens. Chez ÖBB, par contre, tout le monde dit que l’État paie de toute façon beaucoup d’argent et que cela n’a pas d’importance que nous fassions des bénéfices ou des pertes. Pour ainsi dire : « Nous sommes des infrastructures publiques, nous devons exister de toute façon ! Maintenant encore plus à cause de la crise climatique ». Mais cela ne se traduit pas par des revendications salariales plus exigeantes.
Ressentez-vous une pénurie de personnel ?
Lors de la vague Omicron, on était totalement à la limite, très proche du point de rupture. Un certain nombre de personnes ont fait des « équipes rouges » (d’urgence), ce qui a en quelque sorte sauvé la situation. Avec nos deux centres de contrôle, nous sommes maintenant neuf à travailler en deux équipes, mais il nous faudrait au moins être dix.
Quel était le taux d’absentéisme pendant la vague Omicron ?
C’était probablement 40 %. Il y a eu une semaine qui était juste dans les limites du droit du travail. Pendant une semaine, j’étais là tous les jours du vendredi au vendredi, travaillant 80 heures cette semaine-là.
Comment cela est-il compensé ?
Comme rémunération supplémentaire. Il y avait des heures supplémentaires il y a 20 ans. Les gens travaillaient beaucoup l’hiver pour récupérer ces heures supplémentaires pendant l’été, sous forme de jours payés. Dans le nouveau système, vous ne recevez qu’une rémunération supplémentaire. Ils veillent à ce que personne n’accumule trop d’heures supplémentaires. Ailleurs, des collègues s’organisent de manière assez astucieuse et parviennent à obtenir 500 à 600 euros de plus en primes par mois.
Quel est votre salaire ?
Je gagne 2 400 euros brut par mois, les plus anciens ont 3 800 Brut. Je suis dans la nouvelle convention collective, qui est bien car il y a bien pire. Ils l’ont introduite avec les grandes réformes d’il y a 20 ans. Les employés les plus âgés rejoignaient généralement le chemin de fer à l’âge de 18 ou 20 ans. Après 35 ans de service, ils pouvaient prendre leur retraite. C’est l’histoire célèbre de ces personnes ont pris leur retraite à 53 ans. C’était la motivation de certainement la moitié des personnes qui ont commencé alors.
Avant, vous gagniez très peu et vous preniez votre retraite avec tous les avantages. Un an avant votre départ à la retraite, vous étiez promu à la classe de salaire suivante et vous obteniez une pension plus élevée. Puis, sous le gouvernement ÖVP-FPÖ, au début des années quatre-vingt-dix, un changement est intervenu : vous deviez travailler jusqu’à l’âge de 61,5 ans.
Une forte grève contre cette nouvelle loi a eu lieu en 2003, en ayant débuté peu avant un week-end. Les trains étaient à l’arrêt de l’Italie jusqu’à Hambourg. Le lundi, les usines auraient été à l’arrêt. Puis des négociations ont eu lieu et la grève a été annulée par le syndicat. Comme c’est toujours le cas, bien sûr, l’ÖGB [confédération générale des syndicats] a proclamé que c’était une grande victoire. C’était le moment décisif. Les souhaits des travailleurs, qui avaient vu beaucoup plus loin, se sont effondrés. En parle-t-on encore aujourd’hui ?
Pas vraiment. La cogestion est extrêmement forte. Lorsque vous commencez, le responsable des ressources humaines vient et vous explique les choses de base. Ensuite, le comité d’entreprise vient directement et vous donne les formulaires d’adhésion au syndicat. Bien sûr, presque tout le monde signe. Le responsable du personnel et le comité d’entreprise sont totalement « copains ». Dans ma mémoire collective, la grève n’existe plus. La rupture au début des années 1990 est un sujet permanent, surtout chez les anciens.
Il n’y a pas eu de nouvelles embauches depuis longtemps.
Au total, l’ÖBB emploie un peu plus de 40 000 personnes. Comme les réductions de personnel ont continue pendant longtemps, les effectifs sont surchargés. Dans le même temps, on assiste à une expansion massive des recrutements. Sur le site karriere.oebb.at, on trouve 1 300 offres d’emploi dans toute l’Autriche. Pour certains emplois, ils recherchent cinq personnes au même endroit. Actuellement, ils recherchent probablement un total de 2 000 personnes. Les estimations prévoient environ 10 000 départs à la retraite dans un avenir proche. En même temps, ils veulent continuer à automatiser, à électrifier des lignes, à élargir l’offre. Il y a une pénurie massive de conducteurs de train en particulier. Ils chercheront à recruter encore plus de personnes à l’avenir[5].
Publié dans Wildcat (automne 2022) ; traduction Stephen Bouquin
Notes
[1] Peter Stäuber : “Mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet” [« Toute ma vie, j’ai attendu cela»] www.woz.ch, 16/06/2022.
[2] Il existe un pamphlet sur la grève des dockers en janvier 1978, réalisé par le groupe “Alternative”, que l’on peut trouver sur Internet à l’adresse suivante : www.mao-projekt.de
[3] Thiemo Heeg : Digitale Kupplung : Eine Revolution im Güterzugverkehr, [Couplage numérique : une révolution dans le transport des trains de marchandises], www.faz.net, 23.1.2022.
[4] Le shuntage est la mise en place d’un shunt sur un circuit électrique. En vocabulaire ferroviaire, le shuntage du circuit de voie est réalisé par la présence d’un essieu entre les deux rails. On peut ainsi détecter la présence d’un véhicule sur un canton à condition que l’essieu soit parfaitement conducteur électrique (formé de pièces métalliques en contact entre elles et sans isolant) et que le contact entre la roue et le rail soit effectif. Le shuntage des files de rails permet de prendre l’information de présence d’un train sur une portion de voie. Cette fonction est très sécuritaire car cette information sert à espacer correctement les trains ou à les arrêter devant des points singuliers (aiguillage par exemple).
[5] Au début du mois d’août, ÖBB a publié les chiffres : « Au total, 42 000 personnes travaillent pour Postbus et Bahn, dont un quart partira à la retraite dans les prochaines années, soit plus de 10 000. À cela s’ajoutent 2000 apprentis. Dans toute l’Autriche, 3 000 nouveaux employés sont donc nécessaires chaque année. … À Vienne, un total de plus de 6 500 nouveaux employés sera nécessaire d’ici 2027. En Haute-Autriche, il y en aura bien 2000 d’ici là (environ 340 par an), au Tyrol presque 2000 (environ 330 par an), en Styrie environ 1740 (290 par an), à Salzbourg 1440 (240), en Basse-Autriche 1380 (230), en Carinthie 1080 (180), au Vorarlberg 810 (135) et au Burgenland 66 (11). À l’échelle de l’Autriche, environ 600 nouveaux apprentis commencent chaque année.» ORF, 7.8.2022.