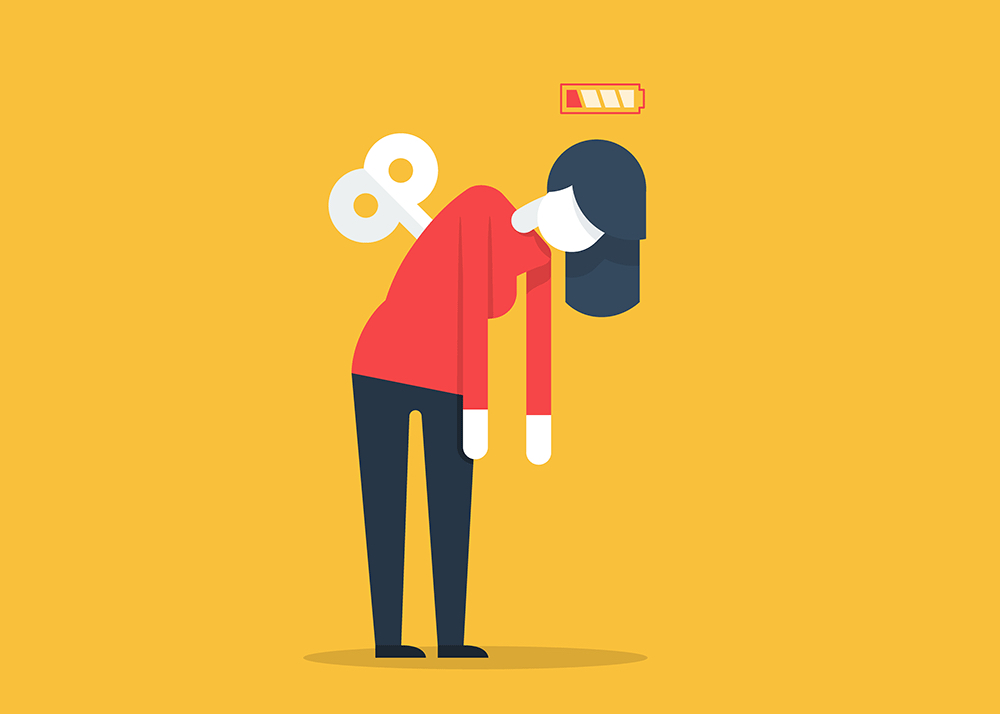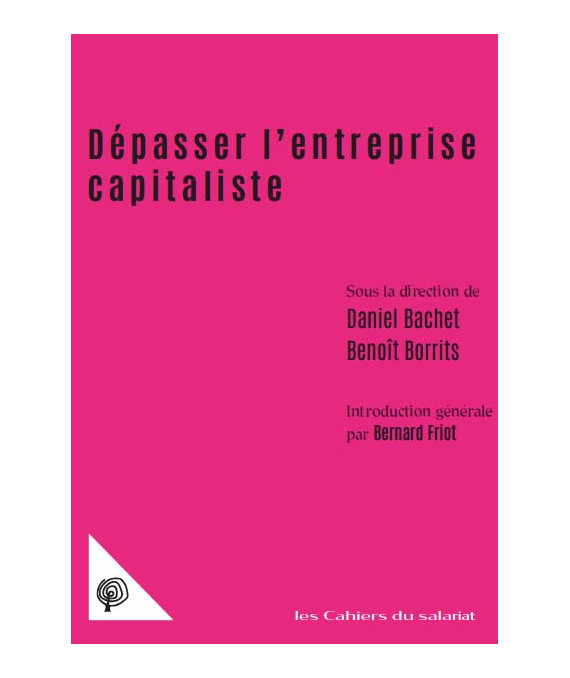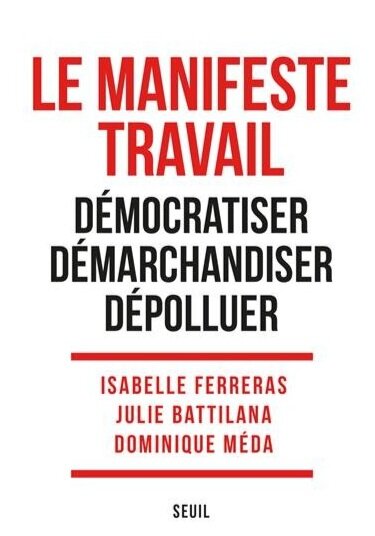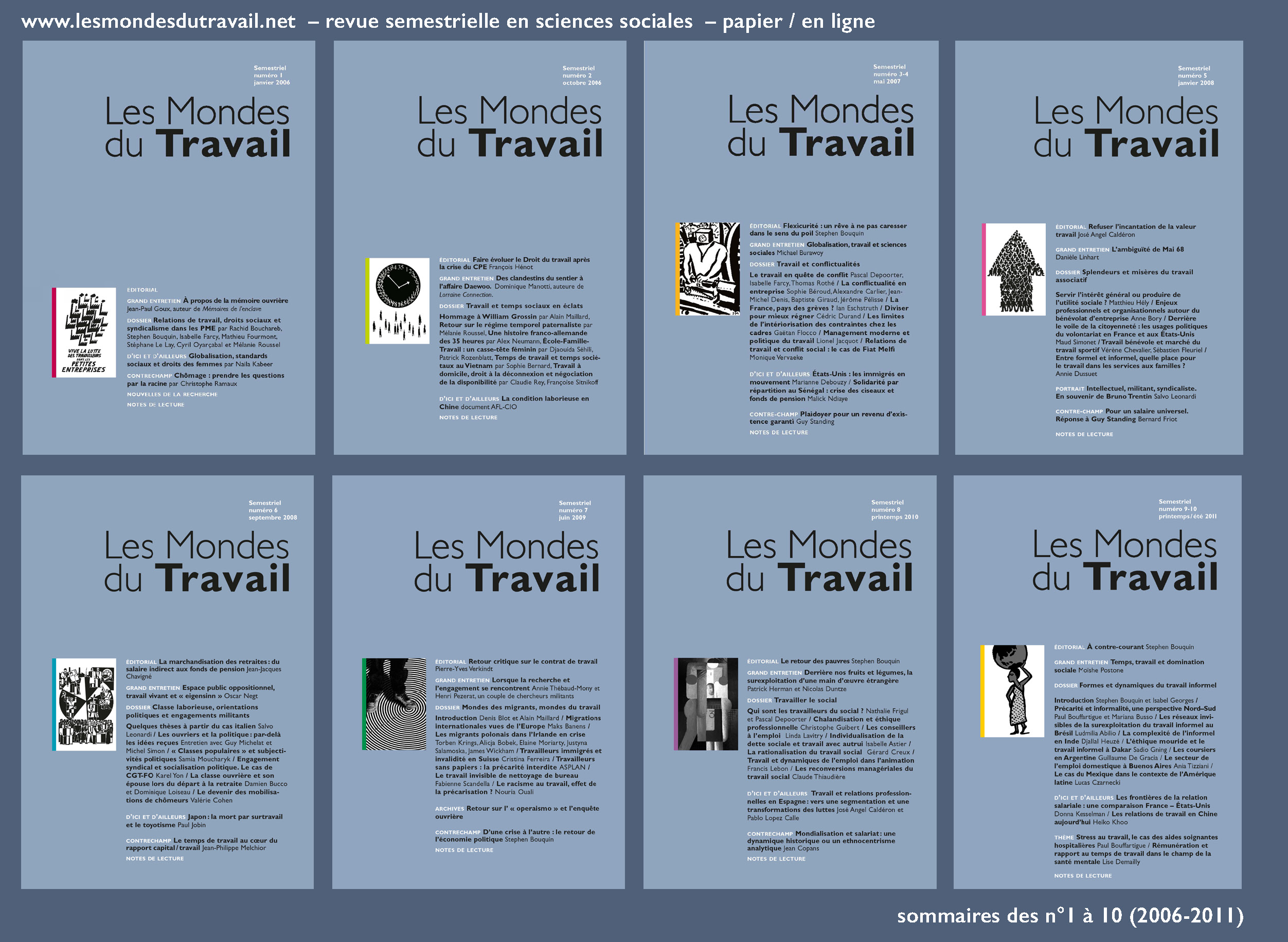par Denis Migot
L’agilité est devenue l’injonction du moment. La numérisation de l’économie et le développement du télétravail renforcent l’impératif d’agilité comme nouvelle norme comportementale et subjective. Mais l’agilité, à l’instar de Scrum, est aussi une démarche certifiée et certifiante dans le management de produits. Dans cet article, Denis Migot, consultant en management et organisation du travail, revient de manière critique sur la dernière mode managériale.
Le numérique semble avoir englouti le monde. Sa présence en tous lieux a d’abord questionné nos automatismes sociaux avant de les rendre désuets. Les modèles économiques, l’appréhension du travail [1] ou encore l’accès à l’information, aux connaissances, aux services se sont profondément transformés à un rythme effréné. L’Estonie, considérée comme comme le pays le plus numérisé au monde[2], rend compte [3] des impacts positifs de ce glissement. Seulement, derrière les traits avantageux de ce bouleversement se cache une part d’ombre. Pour les individus d’abord. En devenant une norme sociale, le numérique crée « une ligne de rupture symbolique » (Luc Vodoz, 2010) excluant socialement ceux qui se situent en dehors de cette frontière mais également les femmes, le numérique étant « massivement dominé par les hommes » (Isabelle Collet, 2019).
Pour les salariés ensuite : « La révolution numérique et la révolution managériale se sont développées en même temps » amenant comme lot de nouveautés une « culture de la haute performance » consistant à « augmenter la productivité tout en réduisant les effectifs » et reposant sur les salariés une tension permanente pouvant altérer « l’amour du travail bien fait » tout en générant « des troubles mentaux et des problèmes de santé » (Vincent de Gaulejac, Fabienne Hanique, 2015).
Pour les entreprises enfin. Elles doivent désormais intégrer significativement ce bouleversement dans leur modèle d’activité ou risquer de disparaître. Pour preuve, depuis 2000 et selon une étude de Constellation Research, 52 % des entreprises du classement réalisé par le magazine Fortune des 500 premières entreprises américaines ont fait faillite, ont été rachetées ou ont cessé d’exister, “la numérisation des entreprises étant un facteur clé de cette accélération”. Alors qu’au début des années 2000 le numérique était regardé de haut par Wall Street, il est aujourd’hui prépondérant [4] – la technologie étant devenu le secteur le plus important en termes de capitalisation boursière [5].
Face à ce dictat de l’adaptation, les entreprises apprennent souvent à leurs dépens que réussir dans le numérique exige une autre façon de penser leur organisation.
Il ne s’agit plus d’appliquer une logique prédictive, directive et de standardisation, typique des industries du vingtième siècle, mais, au contraire, d’intégrer dans leur quotidien une capacité à s’ajuster aux caprices d’un marché incertain.
S’adapter oui, mais comment ?
Selon Steve Denning, auteur, consultant et ancien Directeur Programme de la Banque Mondiale, la réponse évidente : « en étant agile » …. Un avis partagé et mis en pratique par un nombre croissant de grandes entreprises et startups comme en atteste le rapport State of agile : l’adoption de l’approche agile au sein des équipes de développement de logiciels est passée de 37 % en 2020 à 86 % en 2021, la croissance dans les secteurs d’activité non informatiques a également augmenté de manière significative en doublant son adoption depuis 2020. En conséquence, toujours selon Steve Denning, le monde semble entrer aujourd’hui « dans une nouvelle ère : l’ère agile » Du moins en apparence. Mais avant de détailler les limites et dérives de l’application actuelle de l’approche agile, commençons par définir et contextualiser ce terme.
Expliquer ce qu’est ou n’est pas l’approche agile c’est faire face à trois obstacles majeurs : l’absence de définition commune, la relative banalité de nombreux ouvrages spécialisés et l’approximation de certaines recherches sur le sujet. Ceci explique sûrement l’incompréhension générale autour d’un terme déjà souvent confondu ou associé à tort à ceux de la sociocratie, de l’halocratie ou de l’entreprise libérée. Même si l’approche agile a des points d’accroche avec ces derniers (principe de subsidiarité, autonomie de ceux qui font, importance du collectif), elle n’en reste pas moins différente dans ses origines (le développement logiciel) et sa volonté (elle vise l’auto-organisation et non l’auto-gestion des équipes, par conséquent, elle ne s’inscrit pas en faux avec la fonction managériale).
Alors, de quoi parle t-on ? L’approche agile serait une culture permettant à un collectif de prospérer dans un environnement changeant. Ce qui amène trois précisions. D’abord, la culture se définit comme un ensemble de croyances, de valeurs, de pratiques et de comportements spécifiques à un groupe. Le terme culture semble donc pleinement approprié pour définir l’agilité dont le point de départ de la popularité tient à l’écriture en 2001 par dix-sept consultants en développement logiciel d’un manifeste détaillant quatre valeurs et douze principes propres à l’approche agile. Ensuite, par collectif s’entend aussi bien une équipe qu’une entreprise, car l’entreprise n’est rien d’autre, pour citer Dominique et Alain Schnapper, qu’un «collectif d’actions et d’innovations » (Puissante et fragile, l’entreprise en démocratie, 2021). Enfin, la démarche agile est une démarche empirique, c’est-à-dire basée sur l’expérimentation lors d’itérations courtes et sur l’apprentissage lié à cette expérimentation. Cette façon d’appréhender le travail, en rupture avec le paradigme mécanique et prédictif des industries du vingtième siècle, permet de rester efficace face aux montées de la complexité, de l’interdépendance, de l’incertitude et de l’individualité, toutes étant inhérentes à « l’avènement de la société informationnelle » (Jérôme Barrand, 2009).
Et qu’est-ce qu’une entreprise agile ?
« L’entreprise agile se caractérise par la coordination horizontale, le partage de l’information et une grande flexibilité à court terme » (Olivier Badot, 1998). Elle suppose « l’adoption de principes managériaux complémentaires comme la capacité d’anticipation des ruptures de son environnement mais aussi des conséquences de ses propres décisions et actions ; la coopération, tant en interne qu’en externe; l’innovation permanente dans son offre client ; une offre globale s’appuyant bien sûr sur des produits toujours plus performants mais aussi sur des offres de services et une relation personnalisée avec chaque client; une culture client généralisée dans une organisation où chacun est client de l’autre et réciproquement; une complexité à échelle humaine visant à favoriser la reconfiguration des équipes ou des services ou encore une culture du changement faisant de celui-ci un allié souhaité plutôt qu’un ennemi craint. » (Jérôme Barrand, 2009).

L’entreprise agile s’inscrit en continuité des démarches d’organisations matricielles apparues dans les années 1960 et qui furent « l’un des exemples les plus clairs d’une orientation de design structurel selon laquelle la complexité des structures organisationnelles doit suivre la complexité de l’environnement » (Flavio Carvalho de Vasconcelos, 1998). Elle s’inscrit enfin en continuité de la coordination transversale des entreprises fondée sur « la création de connections latérales et une décentralisation du processus de décision » ainsi que sur une « incomplétude des règles et du contrôle » (Catherine Thomas, 2003). L’entreprise agile partage notamment avec ces démarches une volonté de casser les silos, de créer des groupes résumant en leur sein toutes les étapes de production et de faciliter la coopération. La différence fondamentale tient dans l’approche produit des entreprises agiles à contre-courant de l’approche projet des organisations matricielles ou transversales.
Enfin, impossible de définir l’approche agile sans évoquer ce qui a largement contribué à son succès : les frameworks agiles. Ces cadres de travail listent un ensemble de valeurs, de règles, de rencontres et de rôles à respecter pour mobiliser, dans un contexte d’environnements instables, des compétences pluridisciplinaires afin de mener à bien des missions précises.
Contrairement à ce que l’immense majorité de la littérature généraliste, spécialisée ou universitaire affirme, les frameworks agiles ne sont pas des méthodes.
Ils ne préconisent pas un ensemble de démarches à suivre mais une pluralité de contraintes à instaurer afin de révéler les difficultés à surmonter. La différence est fondamentale car, une fois la difficulté mise à jour sous l’effet de la contrainte, les personnes sont libres d’expérimenter l’hypothèse qu’elles jugent la plus juste pour limiter ou éradiquer le problème. Les frameworks ne fournissent donc pas, contrairement aux méthodes, une démarche à suivre, aux personnes de les trouver dans le respect des contraintes du cadre.
Le premier framework agile est celui inventé en 1986 par l’ingénieur américain Barry W. Boehm. Il repose sur une structure commune itérative, incrémentale et adaptative dont le fil conducteur consiste à découper la réalisation d’un besoin “en plusieurs objectifs plus petits afin d’obtenir plus sûrement et rapidement un résultat” (Alain Collignon, Joachim Schöpfel, 2016). Si ces frameworks agiles sont multiples (Scrum, SAFe, Scrum of Scrum, LeSS, Nexus, Crystal Clear, pour ne citer qu’eux), s’ils s’adressent tantôt à une équipe, tantôt à un ensemble d’équipes, tantôt à une entreprise dans sa globalité, tous ont pour principes communs le travail sur un périmètre limité en taille, en nombre de personnes et en temps, l’anticipation, l’auto-organisation, le feedback et la collaboration. Tous partagent également une influence assumée du Lean. Ainsi, le guide présentant le framework Scrum indique, dès sa première page, que ce dernier est fondé “sur l’empirisme et la pensée Lea ». Scrum n’est au final, selon les propres mots de son co-créateur Jeff Sutherland, « qu’un dérivé du lean product development de Toyota ».
Enfin, si les frameworks agiles sont aussi semblables que nombreux, deux sont particulièrement populaires[6]. Scrum est utilisé par 66% des équipes travaillant dans un cadre agile. Ce chiffre monte à 81% si l’on prend en compte les dérivés de Scrum que sont ScrumBan (mixant Scrum et Kanban) et Scrum/XP (mixant Scrum avec l’extreme programming). Scrum a été inventé au début des années 1990 par Ken Schwaber et Jeff Sutherland, tous deux signataires en 2011 du manifeste pour le développement agile de logiciels. Son nom est une référence à l’article The New New Product Development Game de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka. Scrum se définit comme un cadre de travail léger visant à générer de la valeur sur des itérations courtes et à résoudre des problèmes complexes. Il est constitué d’une liste de valeurs (engagement, focus, ouverture, respect et courage), de rôles (developers, scrum master, product owner), d’évènements (sprint, sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective) et d’artefacts (product backlog, sprint backlog, definition of done).
SAFe (Scaled Agile Framework) est utilisé par 37% des entreprises s’appuyant sur un cadre agile pour transformer tout ou partie de leur structure et organisation. SAFe a été formalisé par Dean Leffingwell et Drew Jemilo, sa première version est sortie en 2011. SAFe promeut l’alignement, la collaboration et la livraison régulière au sein des équipes avec la mise en place de cadence, de planification et de réflexion à tous les niveaux de l’organisation.
Il est à noter que malgré un succès commercial fulgurant, SAFe est l’objet de nombreuses critiques au sein de la communauté des professionnels de l’approche agile, c’est à dire par celles et ceux agissant dans la mise en mouvement et-ou dans la diffusion de l’agilité : cabinets de conseils, entreprises de services du numérique (ESN), sociétés de service et d’ingénierie informatique (SSII), organismes de formation et-ou de certifications, experts, coachs, conférenciers, consultants et formateurs. Tout d’abord car Dean Leffingwell fut, avant SAFe, impliqué dans le déploiement commercial du framework Rational Unified Process (RUP) dont il a calqué le modèle économique déjà décrié à l’époque. RUP, malgré une approche itérative et incrémentale chère à la démarche agile, était dans les années 1980 et 1990 pointé du doigt pour avoir transformé un cadre potentiellement efficace en un produit et une licence vendant des outils au service d’une méthode formelle, prescriptive, lourde et peu adaptative.
Ainsi, Ken Schwaber écrit sur son blog en 2013 :
« Les personnes derrière RUP sont de retour. S’appuyant sur le profond échec de RUP, elles poussent maintenant le Scaled Agile Framework comme une approche simple et universelle de l’organisation agile. Lorsque les signataires du manifeste agile se sont réunis en 2001, nous voulions partager nos idées sur le développement de logiciels, une discussion qui a abouti au manifeste agile. Nous voulions réparer les dommages que le Waterfall avait fait à notre profession, et nous espérions également faire en sorte que RUP ne soit pas considéré comme un successeur viable. »
Mais ce n’est pas le seul reproche formulé à l’encontre de SAFe. Pour ne citer que lui, Ron Jeffries, signataire lui aussi du manifeste en 2001, affirme en 2014 sur son blog que malgré plusieurs bonnes idées et références « SAFe met en danger la progression d’une organisation vers un fonctionnement performant ». Sont mis en cause son approche descendante, son manque de flexibilité ou encore son management par l’imposition.
Scrum, SAFe, et l’approche agile de manière globale, sont aujourd’hui des succès commerciaux incontestables. Cette popularité s’explique en grande partie par la vente de certifications. Pour preuve, en 2021 plus de 1,5 millions de certifications payantes à Scrum et ses dérivés [7] ont été délivrés par les seuls organismes Scrum Alliance (fondé en 2002 par Mike Cohn, Esther Derby, et Ken Schwaber) et Scrum.org (fondé en 2009 par Ken Schwaber suite à son désaccord avec les autres membres de Scrum Alliance). S’ajoutent à cela les certifications également payantes à Scrum et ses dérivés délivrés par des sociétés telles que Scrum Inc (fondée en 2006 par Jeff Sutherland), Exin, Scrum Institute ou encore Scrum Study, pour ne citer qu’elles. SAFe n’est pas en reste avec en 2018 plus de 200 000 personnes formées au framework. Les certifications, bien plus que les formations, ont été un élément déterminant dans la popularité de ces cadres de travail. Des propres mots de Mike Cohn, sans elles, « Scrum n’aurait jamais eu le succès qu’il a eu » (2019). Elles sont devenues une source de revenus pour bon nombre de personnalités du secteur. Ainsi Lyssa Adkins a participé à la création d’ICAgile, organisme de certifications à l’approche agile. Il en est de même avec Alistair Cockburn, signataire du manifeste en 2001 mais aussi créateur du framework Crystal Clear, et son lancement des certifications de la Heart of Agile academy ou encore avec Daniel Mezick et sa vente de formations certifiantes à l’Open Space Agility. Cette manne financière explique pourquoi nous comptons en 2017 près de 300 certifications différentes sur l’approche agile ou encore pourquoi Project Management Institute, le géant américain de certifications en gestion de projets dénombrant plus de 600 000 membres et plusieurs millions de personnes certifiées, vend aujourd’hui des certifications sur l’approche agile et fait l’acquisition en 2019 de la boîte à outils Disciplined Agile.
Cette situation s’accompagne malheureusement de dérives particulièrement néfastes : l’accès limité à certaines offres d’emplois aux seuls détenteurs de certifications, l’exclusion de personnes n’ayant pas les moyens de s’offrir une certification, la course à la certification plutôt qu’à l’apprentissage, la valorisation de la certification plutôt que de l’expérience, la guerre de chapelles entre organismes de certifications mais surtout et avant tout, la prédominance d’une approche agile stérile guidée par le seul prisme des frameworks.
Mais les certifications ne sont pas les seules raisons expliquant le succès commercial de l’agilité. L’écriture du manifeste pour le développement agile de logiciels a sans nul doute joué un rôle prépondérant. D’abord car il a été porté et signé par des figures emblématiques du développement logiciel telles que Kent Beck, Martin Fowler, Robert C. Martin et Dave Thomas. Ensuite car il est sorti en 2001 dans un contexte favorable, au carrefour entre «l’institutionnalisation de politiques de qualité de vie au travail » (Pascal Ughetto, 2021), le développement massif d’Internet et l’arrivée des premières vagues de changements profonds des entreprises. Cette période se caractérise en effet par une redéfinition des processus des entreprises « sur la base de ce que permet l’informatique » (Philippe Silberzahn, 2021) mais aussi par une refonte de leur façon de satisfaire leur client. En proposant une culture centrée sur le client, les interactions humaines, la valeur délivrée et l’efficacité organisationnelle dans des contextes complexes, l’approche agile défendue par le manifeste semble répondre aux grandes préoccupations des entreprises du début du vingt-et-unième siècle.
Enfin, l’apparition des premiers frameworks agiles dans les années 1980 et 1990 est concomitante à l’avènement de la DSI (Direction des Systèmes d’Information) en lieu et place du rôle de responsable informatique. Celui-ci s’est vu attribuer de nouvelles fonctions telles que la planification stratégique et la gestion des technologies, la gestion des infrastructures, le développement de règles et la gestion des ressources humaines (Applegate et Elam, 1992; Feeny et al., 1992). Ces DSI intègrent « de plus en plus souvent des pratiques agiles, qui incluent par exemple un développement et une validation des idées itératives. Les technologies numériques vont faciliter ce virage vers l’agilité car le coût de l’innovation a diminué, grâce aux technologies telles que l’Internet et le Cloud » (Yves Barlette, 2014).
Si ce succès commercial est indéniable, et qu’il s’amplifie avec l’arrivée d’entreprises lançant la démarche par imitation ou guidées par la peur d’être dépassées, l’approche agile s’inscrit-elle pour autant dans la durée ou n’est-elle qu’un épiphénomène de plus ? Si l’on en croit les théoriciens des modes managériales que sont Eric Abrahamson et Gregory Fairchild [8], l’approche agile ne remplit que trois des quatre critères pour être considérée comme telle. Si en effet elle est perçue comme « un moyen moderne et rationnel d’obtenir de meilleurs résultats », si elle a envahi « rapidement l’environnement des managers », si elle résulte bien « d’une croyance », sa mise en pratique ne fait toutefois pas l’objet « d’un cycle de vie court » ni d’une « baisse de popularité » (Romain Zerbib, Ludovic Taphanel, 2017) comme en témoignent les « 10 000 articles publiés en anglais sur l’agilité, dans des revues d’économie, d’ingénierie de production, d’informatique » entre 2006 et 2016 (Anca Boboc, Jean-Luc Metzger, 2020).
Toutefois, l’approche agile, si l’on fait fi de sa longévité, reprend tous les éléments constituant une mode managériale :
« l’invention d’un nouveau produit sur le marché du management sur la base d’une critique des précédentes modes managériales; la vente de ce produit avec des arguments marketing usuels (nouveauté, efficacité, lave plus blanc que blanc, etc.); la déception quant aux effets réels puis l’ouverture vers de nouveaux produits qui viendront corriger les défauts de ce dernier modèle managérial et ainsi renouveler le marché, en toute indifférence pour les effets de ce produit sur le monde – la santé, le stress» (Marie-Anne Dujarier, 2021 [9])
Que l’approche agile soit ou non un énième accessoire managérial jetable, les professionnels du secteur usent et abusent des modes managériales. OKR (Objective & Key Results), Liberating Structures, bienveillance, sketching, leadership,… sont autant de phénomènes de mode envahissant les conférences spécialisées ainsi que les offres commerciales des cabinets de conseils et de formations.
Ce succès commercial a le mérite de faire ressortir les nombreuses errances du management moderne. Malheureusement, il est également à l’origine de la propension de l’approche agile à être galvaudée. Source de moqueries, de rejet massif et de souffrances [10], l’agilité est aujourd’hui mal comprise, mal instaurée, mal pratiquée, mal vécue, mal perçue. Ainsi, derrière l’agilité salvatrice promue et vendue par les experts, formateurs et autres consultants se cache un terme transparent dont la signification a été gommée par une mise en musique aux faux airs de taylorisme. Cela s’explique en premier lieu par le postulat de Steve Denning évoqué précédemment. En expliquant que nous entrons dans l’ère agile, en affirmant que les entreprises se doivent d’être agiles, Steve Denning défend une position manichéenne selon laquelle il n’existe que deux options : être agile ou mourir. Cette opinion est aujourd’hui largement répandue au sein des professionnels du secteur qui ont cette fâcheuse tendance à s’enfoncer dans le fatras d’une vision binaire : bien (agile) / mal (pas agile), loin, très loin de la réalité complexe des entreprises. Ils dépensent ainsi “leur temps et leur énergie [ainsi que l’argent des entreprises faisant appel à leurs services] dans la construction d’une situation en apparence inébranlable, qui ne laisse que deux possibilités, deux ultra solutions», c’est à dire deux « solutions qui se débarrassent non seulement du problème, mais aussi de tout le reste» (Paul Watzlawick, 1986). Constat que partage le sociologue François Dupuy qui, dans son ouvrage On ne change pas les entreprises par décret, explique que l’approche agile propose de résoudre des problèmes que l’on ne connaît pas et qu’il manque à celle-ci un « investissement dans la connaissance, première phase de tout processus de changement.» Plutôt que d’opter pour une approche solution, François Dupuy conseille d’investir dans la connaissance du problème, dans l’appréhension du collectif et « d’utiliser cette compréhension pour agir de façon raisonnée, construite et, si possible, maîtrisée». Toute la difficulté à sortir de cette approche solution tient dans le fait qu’elle représente aujourd’hui pour les professionnels du secteur un business juteux tant elle joue sur la paresse managériale voyant en l’agilité une solution unique et simple à des problèmes multiples et complexes.
La dérive de cette posture tient dans le fait qu’elle justifie à elle-seule l’imposition de l’approche agile par des dirigeants, consultants ou managers auprès des équipes opérationnelles. Après tout, à quoi bon tenir compte de l’avis et l’envie de ceux qui font puisque l’agilité est la seule solution valable. Une dérive qui est aujourd’hui une norme comme en atteste le consultant et auteur Daniel Mezick : « Dans le monde entier, l’agilité est imposée. L’industrie agile a totalement échoué dans l’éducation des cadres. Des cadres bien intentionnés croient qu’ils peuvent déployer l’agilité comme un processus défini. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas de cette façon. Et personne ne leur dit le contraire.» [11]
Comment ne pas y voir un parallèle avec ce que le psychologue Yves Clot nomme le « travail empêché», source de “mauvaise fatigue” et de souffrance, pour qualifier cette situation où les salariés, ne participant pas aux décisions impactant directement leur quotidien, ne peuvent ni agir sur leur environnement ni expérimenter leurs hypothèses. Ils se retrouvent enfermés dans des process, des cadres, des pratiques définis par des personnes extérieures persuadées qu’il n’existe qu’une seule bonne manière de faire : la leur.
Au-delà du fait d’être trop souvent présentée et vendue comme une ultra-solution, l’approche agile, que cela soit dans son interprétation ou sa mise en action, comporte des limites aux conséquences négatives.
D’abord l’approche agile contribue fortement au changement permanent, source de mal-être au travail, en accompagnant sa mise en place par l’instauration d’un nouveau langage, de nouveaux métiers ou outils. Toutes ces modifications déstabilisent et fragilisent certains salariés qui perdent leurs repères et se retrouvent ballotés d’un changement à un autre. Ce changement permanent est légitimé par une soit disante nécessité absolue de s’adapter aux mouvances continues d’un marché incertain, seulement, pour paraphraser l’économiste Thierry Ribault, cette adaptation perpétuelle se fait au détriment de la remise en cause des conditions de la situation. L’approche agile tient sa part de responsabilité dans cet état de fait que la sociologue Danièle Linhart qualifie de « précarité subjective ». Cela se traduit par le déploiement de nouvelles pratiques, de nouveaux process, de nouvelles dénominations, de nouvelles formations, de nouveaux rôles qui donnent le sentiment aux salariés d’être en permanence sur le fil du rasoir. Ce déploiement, sans fond, de nouveautés représente l’essentiel de l’activité de l’approche agile, celle-ci se matérialisant principalement par l’enseignement et la mise en œuvre de nouvelles pratiques et procédures.
Ensuite l’approche agile contribue à une tyrannie de l’urgence, particulièrement destructrice, en se présentant comme un moyen permettant l’hyper productivité. En témoignent deux livres références dont les titres (en français « accélérer» et « faire deux fois plus en deux fois moins de temps») prêtent à confusion et laissent faussement entendre que l’agilité signifie tout simplement faire plus et plus vite. Cet amalgame se retrouve dans la terminologie de certains process présentés comme agiles (FAST agile) ainsi que dans les termes utilisés au quotidien par les professionnels du secteur comme un sprint, soit une course de vitesse pour désigner une itération et une « vélocité», soit la rapidité dans le mouvement pour désigner la production d’une équipe. Cette méprise amène aujourd’hui grand nombre de décideurs à recourir à l’agilité dans l’espoir de voir les équipes produire plus et plus vite. Cela se vérifie dans l’Annual State of Agile Report de 2020 où 71% des sondés ont expliqué avoir mis en place une démarche agile dans leur entreprise afin d’aller plus vite. Sauf que cette course à l’immédiateté ne permet pas de se projeter, de réfléchir ou de comprendre. Couplée à l’accélération et l’augmentation des exigences des clients, elle présente un risque psychosocial fort en raréfiant le temps et en générant du stress. À ce sujet, selon l’Organisation mondiale de la santé, le stress est devenu l’un des principaux problèmes de santé au travail. Mais le stress professionnel ne fait pas mal qu’aux individus, il fait aussi mal aux entreprises qui les emploient avec un coût économique estimé entre 3 et 5 % du PIB.
De plus, les frameworks agiles instaurent dans leur immense majorité une agitation en lieu et place d’un changement profond et ce en se concentrant sur la structure et non l’organisation des entreprises, le tout en évitant soigneusement de considérer ce qui permet de susciter une adhésion collective.
Le sociologue François Dupuy au sein de son ouvrage La faillite de la pensée managériale détaille les différences entre structure et organisation ainsi que l’importance de les distinguer. La structure d’une entreprise relève de sa connaissance ordinaire, il s’agit par exemple de son organigramme, de ses rôles, de ses process ou de ses règles. Il s’agit au final de sa représentation formelle. L’organisation correspond quant à elle à une connaissance élaborée, qui n’est pas immédiatement perceptible. L’organisation n’est pas dans les procédures ou les règles mais dans l’utilisation que les salariés vont en faire. «Pour le dire autrement, la théorie c’est la structure, l’organisation c’est la réalité ». C’est pourtant ce changement structurel qui est privilégié par les professionnels de l’agilité à travers la vente et la mise en place de cadres de travail se concentrant quasi exclusivement à la mise en place de nouveaux rôles, de nouvelles règles et de nouveaux process. Seulement, pour citer François Dupuy :
“Ce faisant, a-t-on vraiment changé quelque chose ? En ce qui concerne les effectifs, certainement. Mais qu’en est-il de la réalité de ce que font les salariés, de la façon dont ils travaillent, dont ils résolvent leurs problèmes ? Rien n’est moins sûr, car le changement des structures n’a pas mécaniquement remis en cause l’organisation, c’est-à-dire, répétons-le, ce que font les acteurs”.
Ce point de vue est partagé également par GeePaw Hill, coach américain en développement logiciel. Dans un article publié sur son blog en avril 2021, il affirme ceci :
« Chaque installation SAFe que j’ai vue, et il y en a eu pas mal, et j’utilise le mot “installation” à bon escient, est profondément attachée à une approche hiérarchique de contrôle. […] Les [frameworks agiles] concentrent leur attention et leur raisonnement presque entièrement sur les processus, règles, formulaires, procédures.»
Enfin, les professionnels du secteur ont fréquemment recours à des injonctions mettant sous tension ceux qui les reçoivent. Quatre sont particulièrement courantes : l’injonction au sens, l’injonction au langage positif, l’injonction au ludique et l’injonction à l’autonomie.
Largement influencée par les platitudes du gourou en management Simon Sinek, la communauté de l’approche agile rend souvent impérative la question du sens. Si, évidemment, pour viser l’épanouissement personnel, la quête de sens peut être utile, transformer celle-ci en injonction s’avère un énième recours vain à l’ultra-solution. L’erreur est de considérer qu’il suffit d’exercer un métier disposant d’une utilité – au sens social, sociétal ou environnemental – pour trouver du plaisir au travail. Différents sondages témoignent du contraire. Ainsi une consultation menée en mai 2021 par l’Ordre des infirmiers montre que suite à la crise sanitaire du Covid-19, 40% des infirmiers ont “envie de changer de métier”. Difficile pourtant de trouver un métier ayant plus de sens que celui d’infirmier. Une autre enquête, menée par Manpower en 2016 auprès de personnes nées entre 1980 et 1995, explique que 33% des sondés souhaitent travailler avec des collègues inspirants alors que seulement 20% aspirent à apporter une contribution positive à travers leur travail.
L’injonction au langage positif – qui se manifeste par la prolifération obligatoire de la psychologie positive – et l’injonction au ludique – expliquant que tout doit être drôle, amusant et divertissant – sont aussi monnaies courantes au sein des professionnels de l’approche agile. Cela se manifeste notamment par la prolifération en réunion des ice breakers et autres energizers [12] ou encore par la suppression de certains mots jugés trop négatifs. Ces deux injonctions présentent le danger de laisser croire que tout va bien, la preuve tout le monde s’amuse, tout le monde a le sourire. Elles gomment toute contestation et rendent tabou les conflits alors même, pour paraphraser Yves Clot, qu’il est indispensable de les réhabiliter pour améliorer la qualité du travail. Dans son ouvrage Le prix du travail bien fait, Yves Clot précise d’ailleurs l’importance d’une «coopération conflictuelle » pour restructurer le «dialogue social» et pérenniser une organisation dans le temps.
Enfin, sous couvert d’une volonté de favoriser l’auto-organisation des équipes, les professionnels de l’approche agile, fortement influencés par les écrits de Dan Pink et les conférences de Jean-François Zobrist, exhortent à une autonomie parfois éloignée des pratiques réelles de travail.
Seulement, l’autonomie ne se décrète pas et, comme l’indique le professeur Pascal Ughetto au sein de son livre Organiser l’autonomie au travail, une injonction à l’autonomie sans régulation et sans discussion peut être un facteur d’isolement et de fragilisation. Il préconise une réflexion sur les conditions de la mise en place de l’activité autonome et indique que «les salariés devront toujours déployer de l’activité, gérer des tensions et des contradictions. Il ne faudrait pas que l’autonomie décrétée conduise à laisser les individus se débrouiller avec ces difficultés».
Conclusion
Un contexte favorable allié à un marketing malin ont permis à l’approche agile de dépasser le statut de simple recommandation d’expert en développement logiciel pour acquérir celui illusoire de condition indispensable à la survie des entreprises. Une évolution positive tant cette approche présente, au sein d’environnements de travail marqués par leur incertitude, un potentiel de rupture efficace face aux démarches prédictives. Ainsi, l’agilité peut avoir un impact positif sur la qualité et la productivité du développement des logiciels, sur le time to market (Reiffer, 2002 ; Li et al. 2010 ; Cardozo et al. 2010) ou encore sur la satisfaction du client (Boehm et Turner, 2003). Elle peut également faciliter la coopération au sein des équipes tout en leur permettant de « gérer l’inconnu correctement » (Marie Benedetto-Meyer, Nathalie Hugot, Pascal Ughetto, 2021).
Seulement la réalité du travail a révélé les limites et dérives d’une approche qui a pour ambition d’impenser les rapports sociaux. Elle rappelle également toute l’importance de ne pas se laisser enfermer dans un seul et même cadre bornant l’horizon et se nourrissant du mensonge de l’ultra-solution. La démarche agile, plutôt que de se concentrer vainement sur la structure des entreprises et de reproduire un schéma taylorien consistant à imposer unilatéralement une façon de faire, gagnerait à agir sur l’organisation des entreprises, à intégrer les conditions nécessaires au travail bien fait, à travailler sur le modèle mental de l’entreprise, et, enfin, à s’inspirer des théories du changement organisationnel participatif recommandant la prise en compte du système dans sa globalité, la mise en place d’un processus de changement des comportements, l’élaboration et le contrôle du changement par ceux concernés ou encore l’implication de la direction.
En l’état, en étant trop éloignée de la réalité du changement organisationnel ou encore trop souvent menacée par les dérives des professionnels du secteur, l’agilité sonne souvent creux face à l’exigence des réalisations et n’est, pour paraphraser Jean-Jacques Rousseau, qu’une « guirlande de fleurs sur des chaînes de fer ».
Denis Migot
@denis-migot
[Lisez ici une présentation de l’approche agile du framework scrum. Pour une introduction synthétique des principes de base cet article ]
Bibliographie
– Anca Boboc et Jean-Luc Metzger, « Les méthodes agiles et leurs contradictions », SociologieS [En ligne], http://journals.openedition.org/sociologies/12471 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.12471
– Badot O. (1998), Théorie de l’entreprise agile, l’Harmattan, 296p.
– Barlette Y. (2014), Evolution of CIO’s ROLE: a state of the art (disponible sur ResearchGate)
– Barrand, J. (2009). Etre agile… le destin de l’entreprise de demain. L’Expansion Management Review, 132, 118-129. https://doi.org/10.3917/emr.132.0118
– Carvalho De Vasconcelos F. (1998), La formation des problématiques dans les organisations : une analyse des structures matricielles.
– Clot, Yves. Le prix du travail bien fait. La coopération conflictuelle dans les organisations, avec Bonnefond Jean-Yves, Bonnemain Antoine, Zittoun Mylène. La Découverte, 2021
– Collet, I. (2009), Les oubliées du numérique, Liens socio, https://doi.org/10.4000/lectures.42353
– Collignon, A. & Schöpfel, J. (2016). « Méthodologie de gestion agile d’un projet. Scrum – les principes de base », in I2D – Information, données & documents, 53, 12-15. https://doi.org/10.3917/i2d.162.0012
– de Gaulejac V., Hanique F. (2015), Le Capitalisme paradoxant : un système qui rend fou, Seuil, 2015, 288 p
– Dupuy F. (2016), La faillite de la pensée managériale, éd. Seuil, Paris.
– Dupuy F. (2020), On ne change pas les entreprises par décret, éd. Seuil, Paris, 240p.
– Fracture numérique, fracture sociale : aux frontières de l’intégration et de l’exclusion, 2010
– Linhart D. (2021), L’insoutenable subordination des salariés, éd ; ERES, 288p.
– Pink D. (2009), La vérité sur ce qui nous motive, Ckefs-Champs, 180p.
– Schnapper D., Schnapper A. (2020), Puissante et fragile, l’entreprise en démocratie, Odile Jacob, 256p.
– Thomas C. (2003), Organisation matricielle et coordination transversale : le budget demeure l’outil privilégié. In : Comptabilité – Contrôle – Audit. 9. 169. 10.3917/cca.093.0169.
– Ughetto P. (2018), Organiser l’autonomie au travail, FYP édition, 160p.
– Watzlawick P. (1986), Comment réussir à échouer, réédition du 15 février 1991, éditions du Seuil, 117 pages, (ISBN 2-02-012942-6)
– (2021). Point de vue d’un manager à propos des méthodes agiles. Sociologies pratiques, 42, 101-106. https://doi.org/10.3917/sopr.042.0101
Notes
[1] Selon la Commission Européenne, en 2017, 90 % de l’ensemble des emplois requièrent “un minimum de compétences numériques”.
[2] 94 % des habitants de l’Estonie utilisent une plateforme d’identification numérique pour accéder aux services en ligne de l’administration.
[3] Données partagées par le groupe des employeurs du Comité économique et social européen lors d’une conférence tenue à Tallinn en octobre 2017.
[4] Les surprises de la capitalisation boursière des géants du numérique.
[5] Global Top 100 companies – March 2021.
[6] State of agile report, juillet 2021.
[7] Sources : Scrum.org, Scrum Alliance. Le coût de la certification varie selon les organismes et la certification. A guise d’exemple, le coût de l’examen de la certification Scrum Master de Scrum.org est de 150 dollars. Pour Scrum Alliance, une certification Scrum Master nécessite une formation préalable à l’examen dont le prix est à la discrétion des organismes de formation. En France, il se situe généralement autour des 2000 euros. La certification est ensuite à renouveler tous les deux ans.
[8] Management fashion: Lifecycles, triggers, and collective learning processes.
[9] Propos recueillis par courriel en août 2021.
[10] Souffrance au travail – comment l’industrie agile y contribue, conférence donnée par mes soins le 18 juin 2021 au salon Agi’Lille dont la vidéo n’est pas encore disponible à l’heure de l’écriture de cet article.
[11] Propos recueillis par courriel en février 2021.
[12] Les icebreakers et energizers sont des techniques d’animation d’un événement collectif. Elles visent à insuffler de l’énergie aux participants et à créer un climat à la fois positif et ludique. Exemple : l’icebreaker dit de la couverture où l’on demande à deux personnes de se mettre face-à-face puis de trouver le plus rapidement possible le prénom de l’autre. Utilisées dans un contexte professionnel ces techniques peuvent être vécues par les participants comme des techniques infantilisantes et gênantes.